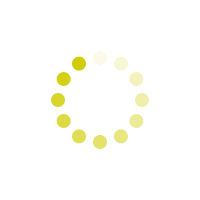OBSERVATOIRE
25 - Besançon
La Bouloie - Observatoire - 34, 36, 41 à 43 avenue de l' Observatoire
- Dossier IA25000379 réalisé en 2002 revu en 2005
- Auteur(s) : Laurent Poupard, Patrick Blandin

Présentation
Les raisons d’une création
En 1867, la Franche-Comté concentre 80 % de la production d’horlogerie française, Besançon détenant un quasi-monopole pour la fabrication des montres et chronomètres.Une quinzaine d’années plus tard, en 1880, la valeur de sa production horlogère place la France au premier rang mondial. Mais cette position est sérieusement menacée par la Suisse et les Etats-Unis, qui ont résolument pris le cap de la mécanisation et de la production de masse. Ainsi, la Suisse fabrique-t-elle cette année-là 1 500 000 montres, pour 500 000 en France et 350 000 aux Etats-Unis.
Pour faire face à cette concurrence, les contemporains préconisent, tout en perfectionnant l’outillage et en augmentant la part de la production mécanisée, de miser sur la qualité et de favoriser la formation des ouvriers, ce à quoi s’applique déjà l’école municipale d’horlogerie ouverte à Besançon le 1er janvier 1862.
Une autre demande est émise dès le lendemain de l’Exposition universelle de 1867, à Paris : la création d’un observatoire chronométrique à Besançon.
Cette demande est portée par le colonel Aimé Laussedat, professeur à l’Ecole polytechnique, et par Georges Sire, directeur de l’Ecole d’horlogerie de Besançon. Tous deux font valoir les avantages apportés à l’industrie suisse par la création de tels établissements, à Genève en 1772 et à Neuchâtel en 1860. Ainsi, à Genève, des épreuves chronométriques sont organisées dès 1790 et font l’objet d’un concours à partir de 1816. De même, l’observatoire de Neuchâtel a dès l’origine pour mission de déterminer et transmettre l’heure exacte, mais aussi de contrôler les chronomètres issus des fabriques locales ; il organise d’ailleurs, à partir de 1866, des concours de chronométrie.
En 1868, Laussedat écrit : « Dans notre opinion, et après ce que nous avons déjà vu réalisé dans le canton de Neufchâtel, si les horlogers franc-comtois veulent soutenir dignement la comparaison, il faut qu’ils se mettent résolument à construire des chronomètres ; mais pour qu’ils puissent lutter avec les mêmes chances de succès que leurs rivaux, il est indispensable qu’ils aient les mêmes moyens d’étudier la marche de ces instruments de précision, d’où la nécessité, j’oserais dire impérieuse, d’établir un observatoire astronomique à Besançon. » Et de s’étonner : « Il est assurément extraordinaire et à peine croyable que dans l’état actuel des choses, on ne sache pas l’heure exacte dans une ville où l’on fabrique un millier de montres par jour. » Notant qu’à Neuchâtel l’établissement a été construit par l’administration cantonale sur un terrain fourni par la ville, il préconise que cette création relève de l’Etat : « Enfin un observatoire est un établissement scientifique d’un ordre supérieur qui, dans notre pays, doit relever du ministère de l’instruction publique. »
Toutefois, ainsi que l’expose Adolphe Hirsch, fondateur de celui de Neuchâtel, il n’est pas souhaitable qu’un observatoire chronométrique ne soit astreint qu’à la production du temps et au contrôle de montres et chronomètres : un tel utilitarisme se révèlerait sclérosant à terme. Le succès de Neuchâtel est donc, pour lui, en partie dû au fait que cet établissement a aussi une activité astronomique et météorologique qui, par ailleurs, doit lui permettre de « pouvoir prendre un rang parmi les Observatoires connus dans le monde scientifique et [de] pouvoir assurer aux bulletins de marche délivrés aux chronomètres, une autorité suffisante auprès de l’acheteur »
Treize ans plus tard, en 1881, alors que le projet est en bonne voie, Maurice Loewy reprendra les arguments de Laussedat dans son rapport sur les observatoires de province.
« Le Gouvernement a bien voulu, de concert avec la ville de Besançon, décider la création d’un observatoire destiné à provoquer et à constater les progrès de l’industrie horlogère locale et à lui venir en aide.
L’urgence de cette création s’impose chaque jour davantage. La concurrence étrangère devient en effet redoutable. Les Américains particulièrement, dans leur ardeur universelle d’entreprise, ont, depuis quelques années, fondé des fabriques d’horlogerie où, par le concours de capitaux considérables et par la centralisation du travail, on a pu simplifier les procédés de construction et réaliser ainsi une économie sérieuse sur le prix de revient. Il en résulte que les Etats-Unis offrent au commerce leurs produits à des prix inférieurs à ceux des autres pays. La Suisse, menacée, comme la France, par le travail américain, s’est mise en devoir de résister le plus tôt possible. La République helvétique, depuis plusieurs années déjà, a créé des observatoires chronométriques à Neuchâtel et à Genève, afin de donner un nouvel essor à son industrie horlogère et de lui assurer la suprématie dans le monde au point de vue de la précision des produits ; aussi la fabrication suisse a-t-elle fait des progrès sérieux et constants, et elle peut ainsi lutter avec succès et se maintenir au rang élevé qu’elle occupait jadis.
Nous nous trouvons donc aujourd’hui en face d’une double rivalité, celle de la perfection du travail et celle du bon marché des produits. Il est par suite urgent, Monsieur le Ministre, de prendre immédiatement des mesures pour le prompt développement de l’observatoire chronométrique de Besançon.
Il ne s’agit pas seulement de sauvegarder les intérêts légitimes d’une industrie qui constitue une des principales branches de l’activité nationale en Franche-Comté ; il faut considérer encore que la France est une grande nation maritime et qu’il convient d’assurer par tous les moyens possibles la sécurité de la navigation.
Or, l’un des éléments les plus importants sur lesquels s’appuient les marins dans la détermination de leur route est la connaissance exacte de l’heure.
Cet élément s’obtient à l’aide de chronomètres, et il sera naturellement d’autant plus précis que la construction de ces appareils sera plus parfaite et leur marche plus régulière.
Ce sont ces deux ordres de considération, Monsieur le Ministre, qui font au Comité consultatif un devoir de vous signaler l’urgence des mesures à prendre. »
Un projet long à se mettre en place
La demande de Laussedat et Sire ne semble pas avoir eu d’écho immédiatement et ce n’est qu’en 1871 que la municipalité la reprend à son compte, l’appuyant par un vœu solennel. La période est favorable : l’astronomie, fortement centralisée sous l’autorité d’Urbain Le Verrier, directeur de l’observatoire de Paris depuis 1854, admet alors une certaine décentralisation.Le 22 février 1872, le nouveau directeur de cet observatoire, Charles-Eugène Delaunay, transmet au maire de Besançon les éléments d’une réponse faite au ministre de l’Instruction publique « sur les conditions dans lesquelles cet Observatoire pourrait être établi, ainsi que quelques autres en divers points de la France ». Il propose :
– la constitution d’un budget annuel de 20 000 F, apporté moitié par la ville et moitié par l’Etat, suffisant pour un astronome directeur et ses deux aides ;
– la fourniture du terrain et des bâtiments par la ville ;
– la fourniture des instruments par l’Etat.
Il précise que la maison d’habitation « devra être complètement distincte et séparée des constructions destinées à recevoir les instruments. Quant à ces dernières constructions, elles dépendent naturellement des instruments qu’elles doivent renfermer, mais l’expérience a montré qu’elles doivent se réduire autant que possible à de simples abris destinés à garantir les instruments, installés directement sur le sol, abris suffisamment solides, bien entendu, pour résister aux intempéries de toute nature. »
Cette même année 1872, l’ingénieur Résal, qui connaît bien Besançon, a une mission officieuse relative à l’établissement d’un observatoire dans cette ville. Il situe ce projet en relation avec l’horlogerie et en comparaison avec l’observatoire de Neuchâtel. Il reprend une partie des propositions de Delaunay et envisage une répartition des charges entre la commune (terrain et construction, moitié des frais annuels de fonctionnement) et l’Etat (instruments, fonctionnement, directeur pris dans le corps des astronomes). Il émet en outre l’hypothèse d’une implantation à Montfaucon, sur l’un des points hauts dominant la ville à l’est, ou dans le quartier de Saint-Claude.
De fait, l’avant-projet rédigé en 1877 par Rouzet, ingénieur voyer de Besançon, stipulera : « Cet observatoire, dont le but est d’assurer l’avenir de l’industrie horlogère, doit être avant tout chronométrique. Mais il doit être aussi astronomique, à cause des élèves de la Faculté des Sciences. Enfin, on doit y faire un peu de météorologie, celle de la région jurassique de l’Est » […] Il note en outre que l’observatoire sera « indispensable pour la fabrication des pièces de précision et nécessaire pour compléter l’éducation des élèves de l’Ecole d’Horlogerie, que la ville entretient à grand frais ». L’ensemble du programme de l’établissement se trouve énoncé là, quand bien même le projet se révèle fort modeste : un seul bâtiment réunissant au rez-de-chaussée « vestibule de la méridienne, salle des chronomètres, cabinet météorologique, cabinet du directeur, suivi d’une chambre à coucher, loge du concierge » et, à l’étage, « logement de l’aide, coupole équatoriale et terrasse » ; les instruments réuniraient dans un premier temps « lunette méridienne, horloge sidérale, pendule de transmission, étuves, enregistreurs météorologiques », à compléter ensuite avec « un équatorial, une deuxième pendule sidérale et un cercle pour l’astronomie » .
En fait, rien ne se passe entre 1871 et 1877, date à laquelle le sénateur-maire de Besançon, Gustave Oudet, réitère la demande.
Dans les tractations de cette année 1877, Jules-Antoine Lissajous, nommé recteur de l’Académie de Besançon en 1875, a un rôle important. Correspondant du ministère, il visite les observatoires de Genève et Neuchâtel avant d’adresser au maire un rapport détaillé, en date du 5 octobre, proposant un partage des contributions de chacun. Il envisage que la ville fournisse un terrain de 50 ares au moins, clos de murs, sur lequel seraient construits un bâtiment réunissant les services de la méridienne et de la chronométrie, une tourelle pour un équatorial et deux petits pavillons pour loger l’un « l’astronome directeur », l’autre « l’aide astronome et le concierge ». Avec les instruments, le montant total serait de 140 000 F, payés par moitié par la ville et par l’Etat : ce dernier donnerait 50 000 F pour les instruments, « dont il resterait propriétaire », et une subvention de 20 000 F pour les bâtiments, qui seraient propriété de la ville ; celle-ci prendrait en charge le matériel chronométrique et les frais de construction des bâtiments. Les frais de fonctionnement annuels se répartiraient en 10 000 F pour l’Etat et 3 700 F pour la ville. Lissajous propose en outre que le service météorologique soit soutenu par le Conseil général. Le Conseil municipal approuve ce projet lors de sa séance du 20 octobre 1877.
Finalement, le 11 mars 1878, par décret présidentiel, le maréchal de Mac Mahon crée « l’Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique » de Besançon.
Un terrain est acheté par la municipalité dans le quartier des Cras dès octobre 1878. Toutefois, Lissajous signale, au début décembre, que l’établissement des plans a été retardé par le décès de l’architecte municipal, Alphonse Delacroix.
Un nouveau blocage intervient alors, du fait d’un désaccord entre la ville et l’Etat. Par l’arrêté ministériel du 16 janvier 1879, ce dernier nomme au poste de directeur de l’observatoire Jean-François Saint-Loup (1831-1913), professeur de mathématiques à l’université de Besançon. Cette nomination remet en cause la création du cours d’astronomie demandé par la ville et, facteur aggravant, Saint-Loup revoit à la baisse le projet, notamment pour ce qui concerne l’instrumentation : il écrira d’ailleurs à l’automne 1881 « qu’un simple télescope suffit pour tout matériel, l’Astronomie étant une activité accessoire à l’Observatoire » . Dans une lettre au ministre de l’Instruction publique, le recteur Lissajous explique : « La ville espérait que la direction de l’observatoire serait confiée à un astronome de profession ; elle le désirait d’autant plus que l’observatoire de Besançon doit être, dans un intérêt national, opposé à celui de Neufchâtel et lui être de tous points comparable. Or le directeur de cet observatoire Monsieur Hirsch, membre de la Commission internationale du Mètre, est un spécialiste des plus distingués […] Opposer à Monsieur Hirsch Monsieur Saint-Loup mathématicien distingué mais n’ayant aucune notoriété astronomique, c’était placer l’observatoire de Besançon dans des conditions manifestes d’infériorité. »
Exacerbé par la presse, le blocage est total pendant plusieurs mois jusqu’au départ de Saint-Loup, remplacé le 16 octobre 1881 par un astronome, Louis-Jules Gruey (1837-1902), alors doyen de la faculté de Clermont. Celui-ci louera d’ailleurs en 1883 « la hauteur et la sagesse des vues du Conseil municipal en matière d’enseignement », préconisant le maintien de la chaire d’astronomie en liaison étroite avec l’observatoire : « Un cours d’astronomie ne peut produire ses meilleurs fruits qu’à l’ombre d’un Observatoire, muni des principaux instruments. » La chaire est effectivement créée le 15 octobre 1883.
En juin 1881, à la demande du ministère, MM Hervé Faye et Maurice Loewy, membres de l’Académie des sciences et du Bureau des longitudes, viennent à Besançon examiner l’emplacement choisi.
Le terrain acquis est alors abandonné car trop exigu et trop proche de la gare, génératrice de vibrations importunes. Ils choisissent donc un autre emplacement à la Bouloie, d’une superficie de 7,5 hectares, traversé par la route de Besançon à Gray. Cette dernière caractéristique ne parut pas outre mesure handicapante : « Cette route à pentes raides n’est guère fréquentée que par quelques rares piétons ; elle n’apporte aucun trouble à l’isolement et au silence qui doivent régner dans un observatoire. »
Ils en font déterminer par les lieutenants de vaisseau Barnaud et Leygue la latitude et la longitude. Celle-ci est matérialisée par la construction, par l’entrepreneur Flitsh, d’une petite cabane méridienne reliée à la ville par des fils télégraphiques. Ce bâtiment, de 6 mètres sur 4,50, en briques, est édifié en moins de 20 jours sur 4 piliers fondés à 3 mètres sous le niveau du sol (il s’agit probablement de celui qui figure au sud-ouest de la bibliothèque sur un plan de 1892 et qui, vraisemblablement intégré dans une bâtisse en longueur utilisée par le service de la météorologie, a été démoli en 2003).
Le 27 mars 1882, un décret de Jules Grévy déclare d’utilité publique la construction de l’observatoire et autorise la ville à acquérir le terrain.
Finalement, le 31 mai 1882, une convention est signée entre le maire de Besançon, Victor Delavelle, et le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Jules Ferry.
Elle stipule dès son premier article que l’observatoire est rattaché à la Faculté des Sciences puis, dans les deux articles suivants, entérine la répartition du financement. La ville fournit le terrain, se chargera de construire les bâtiments (pour un coût estimé à 190 000 F) et s’engage à verser une subvention annuelle de 4000 F destinée au service de chronométrie. De son côté, l’Etat participera à la construction par une subvention (de 30 000 F), achètera les instruments nécessaires aux études chronométriques et astronomiques (130 000 F) et allouera un crédit annuel de fonctionnement de 20 000 F. Quant au service météorologique, il sera financé par le Conseil général.
Quelques années après, Gruey pourra écrire : « Ce traité faisait enfin sortir l’Observatoire de la région des nuages et l’établissait sur des bases aussi larges que solides. » Félicitant le maire de l’accord trouvé, il notera : « L’observatoire de Besançon se distingue profondément des autres par son rôle industriel » .
Un programme complexe
La définition du programme
Le 22 novembre 1881, le maire écrivait au préfet : « La nomination d’un directeur en titre pour notre futur observatoire, avec création d’un cours d’astronomie à la faculté des sciences et promesse de la part de Mr le ministre de convertir bientôt ce cours en une chaire magistrale, a fait cesser toutes les incertitudes qui planaient depuis trois ans sur cet important projet ».Dans son courrier, il signale que Louis-Jules Gruey « a fait la reconnaissance du terrain déjà précédemment adopté par MM Faye et Loevy » et projette de visiter divers observatoires en France et en Suisse. Gruey souhaite d’ailleurs être accompagné par l’architecte de la ville, Edouard Bérard, « afin que celui-ci pût se rendre compte des conditions spéciales de la construction à édifier, au point de vue principalement de l’aménagement intérieur et des dispositions des instruments ».
En effet, le programme de l’observatoire est défini conjointement par ces deux hommes. Peu de références existent alors en France : l’observatoire de Toulouse vient d’être réorganisé en 1872, ceux de Bordeaux et Lyon sont créés la même année que Besançon. Le manque de référence est plus criant encore pour la partie chronométrie, où les exemples sont à chercher à l’étranger.
Dans le compte-rendu de son périple, adressé au ministre de l’Instruction publique puis publié en 1883 dans les Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, Gruey écrit : « J’ai désiré visiter les observatoires de la Suisse, cette terre classique de l’horlogerie, avant de soumettre à M. le Ministre de l’Instruction publique le programme du service le plus important de l’observatoire de Besançon, le service chronométrique. »
De fait, il visite, du 24 novembre au 5 décembre 1881, les observatoires et écoles d’horlogerie de Neuchâtel, Zurich, Le Locle, Berne (observatoire météorologique), Genève et Lyon, « déjà construit en très grande partie ». Il en revient « chargé de renseignements, de notes et de croquis précieux ». L’observatoire de Neuchâtel - le modèle - l’intéresse particulièrement, notamment par sa salle des chronomètres (« C’est la salle vraiment originale et intéressante pour nous ; nous y restons longtemps, examinant tout en détail. ») et son système de distribution de l’heure en ville. Pour celui de Lyon, « disposé d’après les idées nouvelles », il note la répartition en pavillons distincts et le toit ouvrant de la méridienne.
Gruey va encore faire deux voyages, en 1882 et en 1883, afin d’affiner son projet pour la chronométrie.
Le 12 juin 1882, il est autorisé par le Ministre de l’Instruction publique « à visiter les observatoires chronométriques de Hambourg et Liverpool, pour étudier l’organisation intérieure de ces établissements et recueillir tous les renseignements possibles sur la fabrication des chronomètres dans les deux grandes villes maritimes de l’Allemagne et de l’Angleterre ». Du 5 au 30 août, il examine les observatoires de Strasbourg, Berlin, Hambourg, Bruxelles, Greenwich et Liverpool, et visite quelques ateliers d’horlogers.
Nouvelle autorisation l’année suivante pour « visiter, surtout au point de vue chronométrique, l’exposition électrique internationale de Vienne de 1883 ». Son périple, qui débute le 4 septembre, passe par les observatoires de Bâle, Munich et Vienne. Il en retient, pour Bâle et pour Vienne, divers défauts qui « auraient été évités si, au lieu de construire un monument considérable d’un seul bloc, on avait adopté le système des pavillons isolés et séparés suivant la nature des services ». Et de s’emporter contre la disposition de l’équatorial à Bâle : l’instrument y est installé « sur un énorme pilier carré qui traverse l’Institut de bas en haut et qui a dû coûter à lui seul une grosse somme, suffisante peut-être pour bâtir isolément, de plain-pied, une salle méridienne, plus une salle équatoriale, où les instruments eussent été cent fois mieux. Mais il eût fallu renoncer au couronnement de l’édifice par une coupole et sacrifier un effet architectural aux besoins de la science ! » Même observation à Vienne, où il qualifie l’édifice de « palais à quatre coupoles au milieu d’un grand jardin ».
Souhaitant un observatoire qui ne sacrifie pas le fonctionnel au paraître, il veut donc tirer parti des réflexions engagées depuis 1839 - avec la création de l’observatoire de Pulkovo, en Russie - sur les conditions optimales d’implantation de ce type d’établissement : milieu environnant, stabilité du sol et des instruments, séparation des fonctions en pavillons distincts, etc.
Dans son Rapport pour l’année 1881, rédigé en fin d’année, Gruey rappelle le programme de l’observatoire, donne une liste des constructions prévues et des instruments nécessaires, et établit un budget prévisionnel.
Le directeur affecte trois missions au service chronométrique :
- la « détermination de l’heure par les observations astronomiques », à l’aide d’une lunette méridienne suppléée, en cas de mauvais temps prolongé, par une lunette altazimutale ;
- la « comparaison des chronomètres des horlogers aux pendules de l’observatoire », nécessitant pendule, chronomètre, chronographe et étuves ;
- la « distribution de l’heure de l’observatoire à Besançon et ses environs » au moyen de lignes télégraphiques, anticipant en outre une demande future des horlogers d’autres villes : Montbéliard, Seloncourt, Beaucourt, etc.
Résolument modeste pour l’astronomie - il reconnaît que Besançon ne peut pas « prétendre à aller de pair […] avec les autres observatoires de province » -, il souhaite tout de même que l’établissement puisse « concourir à l’ensemble du grand travail astronomique français ».
Quant au service météorologique, il fonctionne déjà, avec des instruments achetés par le Conseil général (le vote favorable à leur acquisition date d’avril 1878) et un réseau de 30 observateurs. Gruey précise : « Il s’est borné et se bornera toujours, à l’avenir, aux observations ordinaires de pression, température et état hygrométrique. Ces observations, réunies à celles de quelques observateurs disséminés dans le département du Doubs, sont transmises régulièrement, à la fin de chaque mois, au bureau central météorologique de France. »
Finalement, il hiérarchise les priorités : « En résumé, l’observatoire de Besançon doit avant tout offrir aux horlogers et fabricants de la Franche-Comté un service chronométrique complet, réunissant les moyens de contrôle les plus délicats et les plus perfectionnés. Il doit prendre part au travail astronomique, dans une certaine mesure et dans un ordre déterminé de recherches. Il doit se borner, pour la météorologie, aux observations directes les plus simples et à l’emploi des enregistreurs les plus élémentaires. »
Le projet architectural
Edouard Bérard avait, le 25 janvier 1879, dessiné un premier projet pour le site. Il y privilégiait la chronométrie en plaçant au centre de la composition le bâtiment de la lunette méridienne qu’un portique en fer à cheval devait relier à la tour de l’équatorial et au bâtiment du directeur, disposés de part et d’autre.Le blocage intervenu entre la ville et l’Etat ne permit toutefois pas d’aller plus loin pendant plus de deux ans et demi et ce n’est que le 12 novembre 1881 que le Conseil municipal adopte l’avant-projet de Bérard, d’un montant de 140 500 F.
Louis-Jules Gruey, dans son Rapport pour l’année 1881, insère un plan général du site, différent de celui de 1879 et donnant à peu près la disposition générale qui sera adoptée ensuite : l’équatorial est placé au centre des bâtiments scientifiques (dans une tour), encadré à droite par le pavillon de la méridienne et des chronomètres et, à gauche, par celui de la bibliothèque. Quoique très schématique, ce document introduit des différences avec le projet de 1879 : isolement total des pavillons, place centrale donnée à l’astronomie (équatorial) dans la composition, rejet des édifices d’habitation au sud de la route.
Cependant, pour une raison que l’on ignore (sa nomination comme architecte diocésain en juin 1882 ?), ce n’est plus Bérard qui poursuit le projet : en octobre 1882, Etienne-Bernard Saint-Ginest (1831-1888), architecte du département depuis 1861, est chargé par la ville de la direction des travaux de l’observatoire. Achevé en décembre, son projet, d’un montant de 143 685 F, est adopté le 16 janvier 1883 par le Conseil municipal.
Les 6 et 20 mars, il est présenté devant le Conseil des Bâtiments civils, qui l’approuve moyennant un certain nombre de modifications : abaissement des corps secondaires et rehaussement du corps principal des pavillons de la bibliothèque et de la méridienne, suppression des pilastres intérieurs de la bibliothèque, augmentation de l’épaisseur des murs du bâtiment de l’équatorial coudé et construction d’une terrasse dans son prolongement - « L’architecte, M Saint-Ginest, expose d’ailleurs que cette disposition résulterait des prescriptions de Mr Loewy, et il ajoute que l’emploi de la brique pour ce bâtiment lui a été demandé afin de ne pas conserver trop longtemps la chaleur, surtout en été. » -, changements à la forme et à la distribution des logements du directeur et des aides, etc. Le 6 mars, l’inspecteur général Diet, rapporteur, note que le devis ne prévoit pas de clôture : « Il est difficile d’admettre cependant que des bâtiments destinés à contenir des instruments précieux ne soient pas enfermés dans une enceinte défendue par des murs d’une hauteur suffisante. » L’explication est fournie le 20 mars par le rapporteur financier, Phily, qui précise que, bien que les moyens manquent actuellement, la ville désire à l’avenir clore le site par des murs et pour le moment prévoit de poser « une barrière dite de chemin de fer ». Il note aussi que les travaux de terrassement et de jardinage seront effectués par le personnel municipal, que le mobilier sera fourni par l’Etat et que le montant total des travaux s’élèvera à 147 069,70 F et non 143 685 F.
Le 10 avril 1883, le Conseil municipal adhère aux modifications faites au projet et autorise la mise en exécution des travaux.
Les travaux
Le 28 avril 1883, les travaux sont adjugés à Théodore Sauvanet, entrepreneur à Besançon, à Champ Forgeron, associé à Joseph Simplot, autre entrepreneur bisontin. Par la suite, Sauvanet et Simplot soumissionneront pour divers travaux complémentaires : le 16 juin 1884, en 1885…Un an après sa délibération du 10 avril 1883, dans celle en date du 15 mars 1884, le Conseil municipal constate que le gros œuvre est à peu près terminé : il reste seulement à établir des voies provisoires pour relier les bâtiments et à réaliser la clôture définitive du terrain avec une haie d’épines blanches, dont la plantation sera soumissionnée le 25 novembre 1885 par Georges Calame, horticulteur à Besançon, moyennant 595 F (réception provisoire le 24 décembre 1885, définitive le 15 octobre 1886). La ville estime avoir rempli ses engagements, avec des dépenses se montant à 161 290,25 F de 1882 à 1884, et attend la réalisation de ceux de l’Etat, qui s’était engagé à participer à la construction par une subvention de 30 000 F. Par ailleurs, Saint-Ginest présente un devis supplémentaire de 14 018,92 F pour tenir compte de l’approfondissement des fondations, à cause de la nature du sol, et de diverses modifications demandées par le directeur de l’observatoire.
L’établissement est inauguré officiellement le 16 août 1884 à 14 heures.
En fait, les travaux ne sont pas terminés, d’autant que des malfaçons graves - pierre gélive en façade, joints réalisés au plâtre et non au ciment, etc. - sont constatées ce qui va conduire à un procès et une situation de crise.
Les rapports annuels de la « Commission de l’Inspection de l’Observatoire » permettent d’en suivre l’évolution. Celui du 18 mars 1885 constate que sont achevés les pavillons d’habitation et la coupole de l’équatorial d’Eichens (équatorial droit) et que les travaux sont relativement avancés pour la bibliothèque ; il note déjà des problèmes d’humidité. Le rapport du 12 février 1886 mentionne une humidité terrible rendant les logements inhabitables. Les façades sud et ouest du bâtiment du directeur et de celui des aides et du concierge sont alors recouvertes d’un enduit par Bernard Franchetti (soumission du 20 février 1886, réception définitive le 15 mars 1887). En vain. Le rapport de mars 1887 précise : « Le spectacle est lamentable ; tout menace ruine » et Gruey attire l’attention du maire sur l’état du pavillon de la chronométrie, lézardé. Même constat l’année suivante.
Faute de réaction, le directeur en appelle à la préfecture. Le 1er avril 1888, il envoie un courrier au ministre : « Je viens d’écrire à Saint-Ginest, architecte de la ville, et à M le maire pour leur demander si le jugement du Conseil de Préfecture que j’ai eu l’honneur de vous communiquer est accepté ou bien s’il est frappé d’appel devant le Conseil d’Etat. » Si tel était le cas, il préconise que le contrat avec la ville soit dénoncé, que ne soit fondé à Besançon qu’une simple station chronométrique et que le matériel et le personnel soient transférés dans un grand centre universitaire de l’est de la France qui accueillerait l’observatoire. Deux jours plus tard, nouvelle lettre dans laquelle il précise que l’architecte s’engage enfin à faire les réparations, d’ici la fin de l’année (en fait, cette question ne sera réglée qu’à la fin de 1892, après que le Conseil d’Etat ait tranché dans le différend opposant la ville à l’architecte).
De fait, dans son rapport annuel pour 1888, publié dans les Rapports sur les observatoires astronomiques de province, Gruey écrit : « La réfection des bâtiments est terminée. Les façades sud de la bibliothèque et du pavillon méridien ont été abattues entièrement et relevées en bonne pierre dure. La face ouest du pavillon de l’équatorial coudé a été doublée et renforcée. La tourelle qui porte l’équatorial ordinaire a été restaurée de haut en bas. Tous ces travaux ont été exécutés, avec des matériaux de première qualité, pendant le printemps et l’été. Ils ont duré environ cinq mois. »
Finalement, le rapport de la Commission de février 1889 constate : « Les réparations les plus urgentes ont été faites ; sur les façades sud la pierre a été remplacée ; on n’a plus comme les années précédentes l’impression de se trouver au milieu de ruines. » L’une des conséquences les plus visibles de ces travaux est la disparition de la décoration extérieure de la bibliothèque : fronton triangulaire brisé et son amortissement, médaillons encadrant la baie centrale.
Indépendamment de ces problèmes d’humidité, l’avancement des travaux peut aussi être suivi à l’aide des Rapports sur les observatoires astronomiques de province (où il est présenté sous une forme plus neutre).
Ainsi, en 1885, le pavillon de la bibliothèque est dit en bon état et nanti d’un sous-sol considéré comme « très beau » ; deux escaliers d’accès à l’objectif de l’instrument manquent au pavillon de l’équatorial coudé, jugé humide ; le pavillon de la méridienne est en bon état et « [son] toit roulant, achevé seulement dans le courant de l’année, fonctionne jusqu’ici d’une manière satisfaisante ». Auguste Bétard l’a construit suivant le système qui avait frappé Gruey à Lyon en 1881 et qu’il avait ainsi décrit : « Ici, pas de trappes ; les versants du toit s’ouvrent entièrement et d’une seule pièce de part et d’autre de la ligne méridienne. Ils roulent sur un bon système de galets et la manœuvre est très facile. »
Le rapport de 1888 signale la pose de deux mires nécessaires pour la grande lunette méridienne - au nord (à une distance de 47 m) et au sud (à une distance de 100 m) -, établies sur des piliers « en grosse pierre de taille, dure et non gélive, du pays ». Cette question avait fait l’objet de réclamations de sa part. Le 8 juillet 1887, il écrivait au maire que les quatre piliers des mires n’avaient jamais été construits : « Je n’ai cessé d’en signaler l’urgence et l’importance à Mr Bérard d’abord, à Mr Saint-Ginest ensuite. Ils n’ont pas pu les oublier dans leurs plans et devis définitifs qui n’ont d’ailleurs jamais passé sous mes yeux. » Cette intervention s’est donc avérée efficace : le 9 septembre 1887, Delphin Obscur s’est engagé à exécuter ces piliers pour 2300 F et les travaux ont été achevés début novembre (réception provisoire le 5 novembre 1887, définitive le 25 novembre 1888).
Le 11 avril 1889 est prononcée la réception provisoire des bâtiments (leur réception définitive ayant lieu le 11 avril 1890).Le rapport de cette année 1889 constate l’exécution par la ville de presque tous les travaux d’achèvement : trottoirs, pose de persiennes et volets, réparation de la glacière - est-ce celle de 20 m3 que les frères Burgart se sont engagés le 20 août 1886 à creuser derrière le bâtiment de l’équatorial coudé et qui n’est toujours pas réalisée en octobre 1889 ?-, mise en place (par François Gros et Théodore Burgart ?) d’une cabane en bois revêtue de zinc pour protéger l’extrémité de l’équatorial coudé à laquelle on accède par un escalier en fonte et une plate-forme en tôle, etc. Cette cabane sera remplacée dès 1890 par un abri métallique, commandé en janvier à l’industriel bisontin Douge (établi 6 faubourg de Tarragnoz), alors que seront construits un deuxième escalier en fonte et sa plate-forme.
Malgré toutes les péripéties liées à la construction, Louis-Jules Gruey doit prévoir et contrôler la fourniture des instruments et du mobilier.
Avant même le début des travaux, il avait préparé fin 1882 la commande de certains d’entre eux afin d’en soumettre les marchés au ministère, qui avait donné son accord le 20 août 1883. Dans un courrier au maire le 10 mai 1883, il signale la possibilité d’acquérir pour 3000 F une « coupole qui est à Nancy, faite solide et élégante sur le modèle de celle de Paris », en tôle galvanisée, de 5 m de diamètre. En décembre, il demande la concession d’une des petites lunettes équatoriales alors disponibles, provenant des deux expéditions pour le passage de Vénus. Le 7 février suivant, dans une nouvelle lettre au maire, il lui signale que la Commission du Passage de Vénus a décidé de lui attribuer cet instrument, un équatorial de 8 pouces, non prévu dans la convention de 1882, et propose de l’abriter dans la coupole de Nancy (montée à l’entrée de la partie nord du site, à gauche). C’est la seule lunette installée et fonctionnelle en 1884 mais elle est complétée, l’année suivante, par la grande lunette méridienne de Gautier, posée en septembre.
Une nouvelle coupole est prévue, dont une description est donnée le 16 avril 1885 au directeur de la société des Forges de Franche-Comté. En novembre, les entrepreneurs bisontins Théodore Sauvanet et Joseph Simplot soumissionnent pour un devis de 4390 F concernant cette coupole, la cabane roulante de l’équatorial, le dôme en zinc de l’équatorial et les persiennes du logement du directeur. Le même mois, Auguste Bétard soumissionne lui aussi pour une coupole et le toit ouvrant du pavillon méridien (réception définitive le 17 août 1887).
En décembre est traitée la question des meubles de bibliothèque réalisés l’année précédente (1884) par A. Charité, rue des Granges à Besançon ; d’autres meubles seront fournis par la maison Burgart pour la bibliothèque en 1888 (une table et une armoire en chêne), en 1895 (des « buffets ») puis en 1900.
La lunette équatoriale coudée de 12 pouces (l’une des sept jamais construites) est installée en décembre 1888 et janvier 1889. A la même période, il est question d’une coupole mobile en tôle qui doit être fabriquée pour l’altazimut, de retour de l’Exposition universelle : « Cette coupole provient de la réunion et de la transformation de deux grandes cloches à gaz dont l’emploi naturel avait été depuis longtemps reconnu ruineux et impossible. » Réalisée par la société Douge, elle est posée, à droite de l’entrée dans la partie nord du site, en 1890 de même que les deux piliers nécessaires pour les mires et l’instrument lui-même, mis en place en mai. D’autres piliers ont été réalisés cette année, vraisemblablement par Théodore Sauvanet qui en donne un devis le 16 janvier : un pour un héliographe (mis en place en juin) et un second - abrité sous une « ancienne coupole en tôle » - pour une lunette horizontale dite en cours d’exécution.
État en 1892 et fonctionnement les premières années
En 1892, Louis-Jules Gruey publie sur l’établissement une notice intitulée Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon. Description des terrains, pavillons, instruments et services. Il décrit les bâtiments - « orientés du nord au sud suivant la ligne méridienne » - et donne une liste des instruments qu’ils contiennent.Ainsi, le pavillon de la méridienne héberge :
– au rez-de-chaussée le bureau chronométrique dans l’angle nord-ouest (à gauche du couloir d’entrée) ;
– un bureau astronomique dans l’angle sud-ouest (à droite de l’entrée) ;
– la salle méridienne accueillant la grande lunette de Gautier, ses accessoires et une pendule Fénon ;
– à l’est la salle des contrôles chronométriques, équipée d’un baromètre, une étuve et une glacière ;
– au sous-sol, un laboratoire photographique installé dans l’angle nord-ouest et servant essentiellement « à fixer les courbes données par les enregistreurs de l’électricité atmosphérique et du magnétisme terrestre » ;
– une pièce située à l’est et presque entièrement occupée par une chambre à température constante.
La chronométrie dispose donc d’un chronomètre de temps moyen, deux chronomètres sidéraux, une grande glacière de 20 m3, deux petites glacières, deux étuves et « un coffre-fort pour déposer les montres des fabricants ». A ce matériel se rattachent les pendules du coudé, celles de la petite méridienne et de l’altazimut, et celle envoyant l’heure à l’hôtel de ville.
Le bâtiment du coudé se compose d’un premier corps, à l’arrière, destiné à l’atelier de mécanique et d’horlogerie et comprenant un tour de mécanicien, un tour en l’air, un burin fixe, une machine à tailler les roues d’engrenage, deux pour les arrondir et une enclume. Le second corps, au centre, abrite au rez-de-chaussée trois pendules - directrice Fénon, moyenne et sidérale - et, à l’étage, la salle des observations à l’aide de l’équatorial coudé système Loewy dû, lui aussi, à Gautier. A l’avant, une terrasse soutenue par des arcades supporte l’instrument et sa cabane de protection.
Le pavillon de la bibliothèque accueille au rez-de-chaussée le bureau du directeur, à droite en entrant (angle nord-est), puis la grande salle de la bibliothèque et ses 2000 volumes et, à l’ouest, la salle météorologique surmontant, au sous-sol, celle des enregistreurs magnétiques et électriques (le reste du sous-sol étant libre). Principalement situés entre le pavillon de la méridienne et la route, les instruments à lecture directe utilisés pour la météorologie sont six thermomètres, un baromètre à mercure Tonnelot et son thermomètre attaché, un psychromètre (pour mesurer l’humidité), un pluviomètre, un neigeomètre, un anémoscope Redier (girouette) donnant la direction du vent et un anémomètre du même constructeur (moulinet de Robinson) pour en connaître la force (à 10 mètres du sol). Les appareils enregistreurs sont un thermomètre Redier et un thermomètre Richard, un baromètre Redier, un hygromètre Richard, l’enregistreur de l’anémoscope et de l’anémomètre, un héliographe Campbell et, dans la salle au sous-sol de la bibliothèque, les instruments construits par Mascart : un bifilaire, une balance, un déclinomètre et un électromètre.
L’entrée de la partie nord du site est encadrée, à l’ouest par la coupole photographique (de 3,80 m de diamètre) due à la société des Forges de Franche-Comté, à l’est par celle de l’altazimut (de même diamètre) réalisée par la société Douge et abritant, outre l’altazimut de Gautier, une pendule Fénon. Dans la partie sud du site, la coupole achetée à Nancy (5,80 m de diamètre) repose sur une terrasse maçonnée de 3 m de hauteur et protège l’équatorial droit de Gautier et Eichens.
Le pavillon d’habitation du directeur est situé dans la partie sud, à l’ouest de l’équatorial droit, celui des aides et du concierge étant à l’est de cet instrument. Le personnel scientifique se compose de 8 personnes, dont le directeur.
Chronométrie
. Contrôles chronométriquesL’inauguration du service chronométrique, le 4 août 1885, s’accompagne de la publication d’un Règlement pour le dépôt des chronomètres, dû à Gruey et approuvé par le ministère de l’Instruction publique.
Au début de l’année suivante, Maurice Loewy se félicite : « Plusieurs centaines de montres et chronomètres de poche ont déjà été soumis à l’examen de l’observatoire, et M. Gruey a pu constater le grand progrès réalisé dans cette importante branche de l’industrie nationale en Franche-Comté. La régularité de la marche de ces montres est telle qu’elle n’est dépassée nulle part. Les horlogers de Besançon auront donc désormais l’avantage de posséder un établissement qui leur fournira tous les renseignements pratiques et théoriques nécessaires pour porter la construction à un plus haut degré de perfectionnement, mais encore il leur rendra le service considérable de mettre en lumière d’une manière incontestable la valeur réelle de leur fabrication. » En fait, Loewy va un peu vite en besogne puisqu’un récapitulatif rédigé début 1889 ne dénombre que 15 montres déposées en 1885. L’impulsion est pourtant donnée : 179 montres sont déposées en 1886, 165 en 1887 et 263 en 1888. Cet ensemble de 623 montres sert de base pour le premier concours chronométrique, dont la remise des prix a lieu au théâtre de Besançon le 27 juillet 1889. L’année suivante, c’est le président de la République lui-même qui remet aux lauréats médailles et diplômes. Ces derniers sont dessinés par le bisontin Henri Michel et imprimés à Paris par la maison Lemercier (en couleur après 1903, les bulletins de marche de 1ère et 3e classes seront aussi l’œuvre d’Henri Michel, ceux de 2e classe étant dus à Bellat assisté de Janin ; l’architecte Marcel Boutterin donnera également des dessins de bulletins de marche, du diplôme de régleur, etc., imprimés à Besançon par J. Millot et Cie).
. Distribution de l’heure
D’autre part, depuis 1886, le service chronométrique délivre - manuellement via une ligne télégraphique - l’heure à l’hôtel de ville tous les jours à 11 h.
Astronomie
Le service astronomique ayant commencé fort modestement en 1884, avec la lunette équatoriale provenant du passage de Vénus, Gruey fait débuter son activité en septembre 1885 lorsque est mise en place la grande lunette méridienne. Mais ce service ne prend réellement de l’ampleur qu’à la suite de l’installation de l’équatorial coudé système Loewy en 1889. L’année suivante, outre la lunette méridienne sont mentionnés comme instruments le coudé, l’équatorial droit et l’altazimut, qui vient d’être installé par le constructeur Gautier.Météorologie
Le service météorologique commence ses observations dès 1881, avec les instruments payés par le Conseil général : un anémoscope, un anémomètre, un électromètre, deux baromètres et deux thermomètres. Le 25 août 1882, le Conseil général vote en outre des crédits supplémentaires pour acheter les enregistreurs magnétiques de Mascart.Le Rapport sur les observatoires astronomiques de province de 1888 explique le fonctionnement du service : « Les observations météorologiques se font régulièrement à 7 heures, 8 heures, 9 heures, midi et 3 heures, 6 heures, 9 heures et 12 heures du soir. Une dépêche est transmise chaque jour au Bureau central météorologique de France. » En fin de mois, aux observations de l’observatoire sont jointes celles réalisées par des bénévoles dans une trentaine de stations disséminées dans le département (leur nombre est fluctuant car dépendant de la bonne volonté et de la disponibilité de ces bénévoles). Le directeur de l’observatoire est d’ailleurs président de la Société météorologique du Doubs.
L’année suivante, le rapport stipule : « Ce service est devenu très important cette année […] On indiquera toute l’étendue du service, en disant que l’installation est à peu près complète, pour la météorologie pure, le magnétisme terrestre et l’électricité atmosphérique. » En effet, longtemps différée du fait des déboires liés à l’achèvement des bâtiments, l’installation des appareils magnétiques a enfin pu se faire dans le sous-sol de la bibliothèque. Par ailleurs, un « neigemètre » a été installé en septembre 1889.
En 1895, le service étudie « la pression barométrique, la température de l’air et du sol, l’humidité relative, la précipitation acqueuse, l’insolation, l’évaporation, la nébulosité, la direction et la force du vent, les orages, les phénomènes optiques de l’atmosphère, ceux de la végétation, etc. Il comprend 8 observations quotidiennes, faites à 3 h, 7 h, 9 h, 12 h, 15 h, 18 h, 21 h & 24 h. »
En 1889, l’observatoire est donc fonctionnel et doté de ses instruments. Il peut même commencer à publier ses bulletins, rendant compte des observations et des mesures effectuées depuis l’entrée en activité des différents services : Bulletin chronométrique (paru début 1889), Bulletin astronomique (les onze premiers seront publiés en 1900) et Bulletin météorologique (le premier est imprimé en 1890).
Aménagements et évolutions jusqu’à la première guerre mondiale
Louis-Jules Gruey dirige l’observatoire - qui se distingue à l’exposition universelle de 1900 par l’obtention d’un grand prix - jusqu’à sa mort, le 28 novembre 1902. Il est alors remplacé par Auguste Lebeuf (1859-1929), nommé par le décret du 23 janvier 1903 et qui fut aide-astronome à Besançon de 1887 au 1er juin 1898.Quoique bien atténués, les problèmes d’humidité sont toujours présents durant les premières années de fonctionnement de l’établissement. Il est donc décidé en 1892 de procéder au mantelage - c’est-à-dire à la pose d’un revêtement protecteur, en tôle galvanisée -, des façades ouest et sud des pavillons du coudé, de la bibliothèque et du directeur. Bien qu’ayant des effets secondaires inattendus - « il est à regretter que le mantelage des bâtiments n’ait eu pour effet de désorienter les boussoles magnétiques » (celle-ci seront de nouveaux utilisées à partir du milieu de 1905) -, les bons résultats constatés incitent le Conseil municipal à étendre la mesure aux autres bâtiments en 1896.
Sept ans plus tard, en 1903, le nouveau directeur écrit : « La rigueur du climat éprouve sérieusement les divers bâtiments. Des réparations importantes ont été faites au pavillon du directeur, à celui des aides et du concierge. Ceux qui abritent les divers instruments ont été maintenus en bon état. » En 1906, de nouveau : « Les bâtiments, édifiés sans tenir compte de la rigueur du climat, exigent constamment des réparations et une surveillance incessante. Faute de doubles fenêtres, les boiseries et les peintures sont rapidement endommagées ; des réfections très onéreuses s’imposent partout. Il en est de même des coupoles, formées d’une simple feuille de tôle, non boisées intérieurement ainsi que le toit de la Méridienne. » Il signale les travaux de restauration intérieure du coudé et de la bibliothèque, ainsi que la modification apportée à la toiture de la méridienne par Brugvin, l’architecte de la ville. Les années suivantes voient de nouvelles demandes de réparations différées, jusqu’en 1911 où les pavillons de la méridienne, du coudé et de la bibliothèque reçoivent des doubles fenêtres alors que le toit de la méridienne est doublé intérieurement avec du rubéroïde et qu’un petit bâtiment - à usage de buanderie et remise - est construit près de la maison du directeur par l’entrepreneur Bürtcher, établi avenue Fontaine-Argent à Besançon. En 1912, des travaux de réfection intérieure ont lieu à la bibliothèque, au bâtiment des aides et au sous-sol de la méridienne, dont deux salles voient leurs parois et leur plafond recouverts de boiseries (opération poursuivie en 1913). Cette mesure se double d’une seconde, d’importance, dont le devis préparé par Brugvin est approuvé par le préfet le 24 janvier 1914 : le creusement d’un fossé tout autour de la méridienne. Le dégagement de la base de ses murs, en juin et juillet 1914, permet enfin de lutter efficacement contre l’humidité et, en assainissant le sous-sol, de pouvoir y installer pendules et autres instruments délicats.
A côté de ces travaux liés à l’humidité et récurrents jusqu’à la première guerre mondiale au moins, d’autres sont nécessités par l’évolution des services et de leur instrumentation.
L’atelier de mécanique, horlogerie et menuiserie, établi sous le coudé, s’étoffe en 1894 avec l’acquisition d’un grand nombre d’outils, alors qu’un agrandisseur photographique est mis en place dans un sous-sol. En 1913, l’éclairage à l’acétylène est abandonné pour l’électricité, les installations étant réalisées de juillet à octobre gracieusement par la Compagnie du Gaz et de l’Electricité.
Chronométrie
. Distribution de l’heureEn 1892, le constructeur Auguste-Victor Fénon installe trois pendules - dans les salles du coudé, de la méridienne et de l’altazimut - synchronisées par une pendule sidérale directrice (n° 45) placée dans la bibliothèque. L’année d’après, une quatrième pendule est placée dans la coupole de l’équatorial droit. « Une dernière pendule destinée à envoyer l’heure automatique à la fabrique sera posée dans le courant de janvier 1894, c’est-à-dire dans quelques jours. L’installation chronométrique de l’Observatoire sera sans doute alors l’une des plus complètes. » Il faudra cependant encore attendre : la pendule Fénon n° 102 - commandée depuis le 1er mars 1883 et destinée à synchroniser celle de l’hôtel de ville - ne fonctionna jamais correctement. Installée complètement en mai 1894, elle ne cesse de se dérégler et constitue la cause d’un procès entre l’observatoire et le constructeur, procès qui se conclut le 17 mars 1898 par la condamnation de ce dernier.
Par ailleurs, la transmission de l’heure telle qu’elle est définie en 1885 ne paraît pas totalement au point puisque dans le rapport de 1903, il est écrit : « La transmission électrique de l’heure avait provoqué quelques réclamations. La ligne a été refaite très soigneusement par l’administration des Postes et télégraphes sous la direction de MM. Rascalou et Béraud. Une vitrine spéciale pourvue d’un téléphone a été installée à l’hôtel de ville près de la pendule réceptrice. Depuis l’exécution de ces travaux, mars-avril 1903, aucune omission dans le service n’a été signalée à l’observatoire. » Les modifications ont consisté en la transformation de la ligne à un seul fil mi-partie aérienne mi-partie souterraine en une ligne à deux fils exclusivement aérienne, et en la réorganisation du système récepteur à l’hôtel de ville. Ce dernier point est l’œuvre d’A. Paulin, de Grenoble, auteur du tableau de réception relié d’une part à la ligne de l’observatoire, d’autre part à la pendule réceptrice Hipp de l’hôtel de ville, à celle qu’il a fournie à la Faculté des Sciences et aux départs vers les autres clients. En effet, l’heure est renvoyée de l’hôtel de ville aux organismes, sociétés et particuliers demandeurs prêts à en assumer le coût (pose et entretien de la ligne, achat d’un appareil récepteur horaire) : Faculté, fabricants d’horlogerie Leroy et Lipmann Frères, etc. (ils seront 12 en 1904, 16 en 1906, 22 en 1908). En 1905 arrivent des demandes d’industriels du val de Morteau et de Montbéliard, qui ne se concrétiseront pas du fait des tarifs demandés par les Postes.
A partir du 1er janvier 1906, les manœuvres manuelles nécessaires à la bonne transmission du signal horaire depuis l’hôtel de ville (actions sur un commutateur) sont supprimées puis, en 1907, une des pendules Fénon (n° 113) est modifiée par le constructeur Leroy pour transmettre automatiquement l’heure. Elle est mise en service le 1er mai 1908 et permet la transmission d’un signal horaire toutes les heures de 11 heures à 17 heures. L’année suivante, Leroy modifie une seconde pendule Fénon (n° 120) dans le même but, cette pendule devant se substituer à la première en cas de défaillance de celle-ci.
L’heure peut aussi être donnée par téléphone, comme le signale le rapport de 1910 et, à l’été 1911, l’établissement se dote d’un poste de TSF pour recevoir les signaux et dépêches émis depuis la Tour Eiffel. Le 29 janvier 1912, un arrêté préfectoral autorise officiellement cette installation, qui s’implante en 1913 dans une pièce du sous-sol de la méridienne.
. Contrôles chronométriques
L’année 1903 est riche en modifications pour la chronométrie. Dès 1900, Gruey avait signalé l’insuffisance de la pièce réservée au dépôt des montres (4,50 x 3,50 m, dans l’angle nord-ouest de la méridienne) et demandé la construction d’un second escalier, à l’est, afin de rendre indépendante la salle réservée aux contrôles chronométriques. Cette disposition est adoptée le 28 août 1903 par un arrêté préfectoral validant le projet de Brugvin : les fabricants peuvent donc dès lors y déposer leurs montres sans que cela n’oblige le personnel à d’incessants va-et-vient dans la salle méridienne. La salle est réorganisée suivant des plans et dessins de l’aide-chronométrier Auguste Hérique. Deux meubles étuves sont construits l’année suivante par l’ébéniste bisontin Baudot : le cœur du premier est constitué d’un coffre-fort Bauche, celui du second de trois coffres-forts distincts. Ils sont placés dans la nouvelle salle de même que les deux vitrines Lequeux, à double parois vitrées et régulation thermique, acquises en 1904 et destinées à la pendule directrice Fénon n° 45 et à celle de temps moyen Leroy n° 16419. Au sous-sol, sous la salle chronométrique, prennent place un calorifère relié aux meubles étuves et une étuve-glacière imaginée par l’assistant Paul Chofardet et pouvant recevoir 200 chronomètres. Ce sous-sol sera partiellement réaménagé en 1910 : la comparaison des montres s’effectuera dorénavant là, à l’aide de deux pendulettes de type Féry fournies par Leroy.Lors de la réorganisation de 1903-1904, une autre salle est aménagée dans le pavillon de la bibliothèque pour contrôler les pendules.
Rénové (pose de boiseries et doubles fenêtres) de même que le pavillon de la méridienne, le bâtiment de la petite méridienne, situé non loin de la bibliothèque, est affecté à un service nouveau : celui de la désaimantation des chronomètres de poche, créée par l’arrêté ministériel du 21 juillet 1903 et qui ouvre le 15 février 1904. Il est équipé par la maison Olivier-Midoz, établie à Ornans et à Besançon , d’un moteur à pétrole Niel de 2 chevaux, d’une dynamo de 1200 watts, d’une batterie de 38 accumulateurs et de divers instruments (ce service existera toujours en 1953 mais ne sera plus actif depuis longtemps faute de demande).
Dès 1893, le directeur se félicitait des résultats du service chronométrique : « La fabrique paraît apprécier de plus en plus l’importance et la bonne tenue de ce service. Elle songe à en demander l’extension par la création, dans la ville même, d’un bureau de contrôle pour les montres courantes. Ce bureau serait confié au personnel de l’Observatoire [il n’a pas été créé]. Le service chronométrique n’a jamais été interrompu un seul jour ; il ne connaît ni vacances, ni fêtes, ni dimanches. » Depuis décembre 1897, l’établissement a le droit d’apposer son propre poinçon sur les montres ayant obtenu un bulletin de marche : elle utilise une machine inventée par Hérique et un coin gravé d’une tête de vipère, dont le dessin est dû au médailleur parisien Alphée Dubois (1831-1905), grand prix de Rome en 1855.
De nouveaux règlements, augmentant le niveau de difficulté, sont applicables à compter du 1er janvier 1895 pour la 1ère classe, de juillet 1903 pour les 2e et 3e classes d’épreuves, l’ensemble étant réformé en 1906-1907 puis en 1909 (avec application à compter du 1er mai 1910) pour tenir « un compte exact des progrès de fabrication et de réglage », déjà entériné par l’observatoire de Genève dont le règlement a été modifié en 1908. Une nouvelle modification a lieu en 1912 (puis en 1914), augmentant les difficultés pour la 1ère classe et supprimant la 3e classe : « La suppression de la 3e classe accentuera désormais le caractère scientifique de la chronométrie. Pour aboutir à cette mesure, d’une importance capitale, il a fallu conquérir successivement la confiance du public et de la fabrique en même temps qu’entraîner celle-ci vers des méthodes meilleures et plus rigoureuses. La 3e classe par sa simplicité a servi, en quelque sorte, d’amorce pour les horlogers et les amateurs. Aujourd’hui la clientèle de la chronométrie se sélectionne aussi bien parmi les artistes qui abordent les épreuves, que parmi les personnes qui préfèrent l’horlogerie de précision. Avec l’année 1913-1914, s’ouvre évidemment une période nouvelle pour l’histoire commune de la Fabrique et de l’Observatoire. »
D’autre part, par un arrêté en date du 16 février 1900, le ministre de l’Instruction publique a institué un diplôme de régleur, de portée nationale à partir de 1905.
Selon Auguste Lebeuf, « l’année 1905 marquera une date dans l’histoire de la chronométrie bisontine. Le concours national et la concours annuel ont en effet mis en relief la valeur des artistes et l’excellence de la fabrique régionale. L’Observatoire a inauguré une nouvelle installation due en grande partie à son personnel […] L’accroissement régulier des dépôts et demandes de transmission horaire atteste de la faveur dont jouit à juste titre le service chronométrique de l’Observatoire auprès de la fabrique bisontine. »
Le ministère ayant approuvé, le 11 janvier 1907, un projet de coupe chronométrique, l’attribution de ce trophée appelle de nouveaux commentaires de Lebeuf : « Nous rappellerons seulement qu’il vient d’être possible de refondre le règlement chronométrique (26 novembre 1907) et que celui-ci contient des limites plus étroites que celles imposées à Genève. Ainsi, pour la première fois, la fabrique bisontine, tributaire dans son code d’horlogerie des travaux anciens et très remarquables d’ailleurs de ses voisins de Genève et Neuchâtel, inaugure un règlement déduit de ses propres efforts. Le service chronométrique ouvert en 1885, il y a vingt-deux ans, s’affranchit peu à peu des influences extérieures et se crée ses propres traditions, en même temps que le public s’intéresse chaque jour davantage à ses progrès et qu’une association puissante, l’Automobile Club de France, lui demande d’organiser un concours spécial pour chronographes, mai 1907. » Adjoint au 20e concours annuel, ce concours spécial a lieu en 1908 et voit quatre des onze chronographes présentés récompensés par une médaille d’or. Son succès incite l’Automobile Club à le pérenniser.
De fait, le nombre de dépôts de montres à contrôler est en augmentation constante : en moyenne 228 pour la période 1886-1891, 418 pour 1892-1899, 732 pour 1900-1905. Il est de 914 en 1906, 868 en 1907, 1075 en 1908, 1368 en 1910, 1572 en 1911. Ce nombre s’écroule en août 1914, au début de la première guerre mondiale. Toutefois, un décompte arrêté au 30 avril 1914 totalise, depuis l’ouverture du service le 5 août 1885 19 079 chronomètres déposés et 14 106 bulletins de marche délivrés.
Astronomie
Dès l’origine, Louis-Jules Gruey déplore que le service astronomique soit réduit à la portion congrue : « Mais les plus grands obstacles à l’amélioration de notre service astronomique viennent de sa liaison au service chronométrique. Tant que nous n’aurons, sous un ciel souvent couvert, qu’une seule lunette méridienne, cette lunette sera absorbée par la chronométrie, réclamant l’heure sans repos ni trêve. Toute réparation minutieuse sera impossible, sous peine d’interruption du service chronométrique, le plus important de tous, et auquel la fabrique n’accorderait pas un seul jour de vacances. Nous espérons pouvoir installer prochainement une petite lunette méridienne purement chronométrique. Nous pourrons alors consacrer à l’astronomie de précision notre grande lunette méridienne, l’étudier et la perfectionner à fond, afin de pouvoir mettre au jour des résultats à l’abri de toute critique. »Il cherche donc à renforcer ce service. En 1897, il fait installer un petit équatorial photographique sous une coupole tournante puis, en 1900, des piliers sont établis dans le pavillon de la méridienne pour pouvoir installer deux collimateurs, destinés à l’étude de la flexion horizontale et de la collimation de la lunette. Cette construction entraîne le percement des voûtes du sous-sol (un devis a été donné en ce sens le 29 décembre 1899 par A. Sourioux, tenant compte du souhait de Gruey que la pierre de taille provienne des carrières de la Malcombe).
Le service astronomique se signale par la découverte en 1898, par Paul Chofardet, d’une comète à laquelle son nom est donné, mais c’est surtout en 1905 qu’il en est question : une mission, comprenant pour l’observatoire de Besançon Lebeuf et ce même Chofardet, va à Cistierna (Espagne, province du Léon) étudier l’éclipse totale de soleil du 30 août. Bien que les observations aient été troublées par des nuages, nous restent de ce voyage un article et un certain nombre de photographies, montrant notamment les conditions d’installation des instruments. Sinon, l’apport principal de Besançon à cette époque tient en la réalisation de catalogues d’étoiles, en la publication d’observations sur les comètes et d’éphémérides de diverses planètes, et en la participation - en fonction « des moyens en personnel et des ressources pécuniaires » disponibles - à l’heure internationale.
Météorologie
Les bulletins météorologiques se font plus nombreux : en 1892, en sus du bulletin mensuel destiné au Bureau central de France, un bulletin quotidien est adressé à la presse locale et un bimensuel au Bureau municipal d’hygiène. A partir de 1896, la Société départementale d’Horticulture est elle aussi destinataire d’un bulletin ; ce sera ensuite le tour de la Société d’Histoire naturelle alors que leur fréquence s’accélèrera.De même, le nombre et l’étendue des observations augmentent : elles se composent en 1897 de « huit observations trihoraires et [de] l’étude des divers phénomènes accidentels et de la végétation ». La diffusion de bulletins météorologiques par l’émetteur de la Tour Eiffel permet à l’établissement, à compter de 1913, de diffuser à la presse des prévisions à court terme, pour le lendemain. Durant la guerre 1914-1918, l’observatoire envoie chaque jour deux dépêches au Service géographique de l’Armée, à Paris, et, si nécessaire, signale à l’aide du téléphone à un poste militaire du front les évènements météorologiques marquants.
Sismographie
En 1905, le ministère de l’Instruction publique fait don à l’établissement d’un sismographe (à construire) : « L’observatoire de Besançon est désigné, avec les observatoires de Paris et du Puy-de-Dôme, pour faire partie d’un réseau de stations françaises rattachées à un ensemble d’Observatoires étrangers permettant par leur choix judicieux d’établir les mouvements de l’écorce terrestre sur toute la surface de la terre. » Cet ensemble d’observatoires constitue l’Association internationale de Sismologie, dont la création a été préconisée en 1903 par la Commission internationale de Sismologie, réunie à Strasbourg, et à laquelle la France adhèrera officiellement le 1er avril 1908.Le déménagement de l’appareil à acétylène dans un hangar isolé (vraisemblablement le bâtiment adossé à l’atelier de mécanique du coudé) libère en 1906 pour ce sismographe de la place au sous-sol de la bibliothèque (salle côté est) mais les études comparatives entreprises par l’Académie des Sciences repoussent à 1909 la livraison de l’instrument. Cet appareil - un Mainka Bosch à double pendule horizontal et enregistrement sur papier au noir de fumée - est complété par un deuxième sismographe - Paulin Kilian - prêté par l’observatoire de Lyon et servant à donner l’heure exacte du tremblement de terre et sa direction. Ce dernier est mis en marche le 21 décembre 1909 (mais son utilisation sera abandonnée en 1913 du fait d’une sensibilité insuffisante) alors que le premier débute son activité le 19 janvier 1910. L’installation est complétée au début 1910 par l’ancienne pendule sidérale Redier n° 57, convertie au temps moyen et remise en état par L. Leroy, placée dans la salle des pendules au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Le parc
Le parc est l’objet de projets d’aménagement, voire de convoitises.Ainsi, le 24 novembre 1899, le maire transmet au directeur la demande de la Société d’Horticulture du Doubs, qui veut créer des vergers cantonaux « pour obtenir le développement de la culture des arbres fruitiers à Besançon et dans tout le Département » . Cette société désire que la ville mette à sa disposition les terrains qui entourent l’observatoire pour y faire pousser des espèces à fruits à cidre susceptibles de fournir des greffons.En septembre 1903, c’est le directeur de l’observatoire qui écrit au Service des promenades de la ville afin de transformer ces terrains en parc boisé. Il désire « que les essences d’arbres adoptées comprennent en premier lieu tout ce qui est d’origine franc-comtoise afin d’en tirer des conclusions météorologiques intéressantes » et « que les premiers travaux donnent accès à la nouvelle salle chronométrique » . D. Gouspy, l’agent voyer qui se rend sur place, rapporte : « Les points de vues que l’on découvre depuis cet endroit peuvent certainement compter parmi les plus jolis panoramas des alentours de Besançon, aussi importe-t-il de donner à ces plantations l’aspect général d’un parc boisé dans lequel on doit ménager des lignes de vues ; d’autre part, ces dispositions permettent également de conserver une bonne partie des herbages qui continueraient toujours à être amodiés .» Il donne un détail estimatif des essences retenues, les plus variées possibles : hêtres, frênes, bouleaux, acacias, ormeaux, chênes, noyers communs et noyers noirs d’Amérique, cerisiers, pruniers pourpres, noisetiers, tilleuls argentés, marronniers blancs ou d’Inde, sophoras du Japon, érables sycomore, érables planes, peupliers blancs de Hollande, alisiers blancs, sorbiers des oiseaux, vernis du Japon, catalpas (catalpas bignonioides), virgilier à bois jaune (virgilia lutea), tulipiers de Virginie, érables négundo panachés, ifs, épicéas, pins noirs d’Autriche et pins sylvestres. Pour les massifs, il prévoit des buissons ardents (pyracanthas), des weigelias, dentzias, forsythias, genêts d’Espagne…
Le 6 novembre, le Conseil municipal délibère favorablement à ce projet, d’un coût de 3000 F, dont la réalisation s’étalera sur 3 années dont « la première serait consacrée à la plantation d’arbres à haute tige en bordure des allées reliant la route aux bâtiments de la chronométrie, de la grande méridienne et de la bibliothèque, ainsi que l’allée conduisant au bâtiment occupé par Mr le Directeur. » Des plantations ont effectivement lieu en 1904 et on lit dans le Rapport sur les observatoires de province : « les travaux, déjà avancés, ont modifié très heureusement l’aspect un peu dénudé de la colline sur laquelle repose l’Observatoire. » Lebeuf écrit en 1905 : « Sous l’habile direction de M. Jeannot, ingénieur-voyer de la ville, de belles allées bordées d’arbres et de massifs ont déjà égayé l’aspect un peu sévère de la colline où se dressent fièrement les coupoles. » Il est de nouveau question de plantations en 1907 puis en 1908 : « Les plantations sont en assez bon état ; les allées sont tracées, mais l’empierrement reste à faire. »
A noter aussi la réalisation en 1902, non loin du bâtiment des aides, d’un cadran solaire analemmatique construit à l’initiative de Gruey et réputé être le troisième plus ancien au monde. Dans ce cadran solaire horizontal, de forme ovale, c’est l’ombre de l’observateur qui indique l’heure suivant - particularité propre à celui de Besançon - le système adopté par les astronomes où le 0 correspond à 12 heures et non à minuit.
L’entre-deux-guerres
Après cette interruption de quatre ans, le fonctionnement de l’observatoire revient progressivement à la normale, même si les conditions économiques sont longtemps défavorables. Il est d’ailleurs, dans un premier temps, peu question de modifications aux bâtiments, reportées « au retour des prix abordables de la main-d’œuvre et des matériaux ». La substitution en 1925 du courant alternatif au courant continu permet toutefois un renouvellement partiel des installations, atelier de mécanique et TSF notamment.Le parc continue d’être entretenu, d’autant que l’observatoire dispose depuis 1909 d’un concierge faisant également office de jardinier. Lebeuf constate en 1923 : « les plantations sont vigoureuses et elles donnent, chaque jour, un aspect plus satisfaisant à l’ensemble du parc et des bâtiments. »
A cette date, le personnel se compose de 8 scientifiques, dont le directeur, et d’un jardinier faisant office de concierge. Ne sont pas comptés les divers auxiliaires employés aux calculs, dont le nombre varie en fonction de la charge de travail à la chronométrie (en 1945 par exemple, le personnel comptera 9 titulaires et 12 auxiliaires).
L’entre-deux-guerres est marqué par la disparition d’Auguste Lebeuf le 13 juillet 1929, alors qu’admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1928, il assurait un intérim dans l’attente de la désignation d’un successeur. Il est remplacé le 1er mars 1930 par René Baillaud (1885-1977), astronome adjoint à l’observatoire de Marseille, nommé directeur par un décret en date du 16 février 1930.
En poste à Besançon jusqu’en 1957, celui-ci donne à la chronométrie une nouvelle impulsion, constatée lors du voyage présidentiel du 2 juillet 1933, au cours duquel Albert Lebrun visite l’établissement à l’occasion du 1er Congrès national de l’Horlogerie. Baillaud est à l’origine de la restauration de divers locaux (dont la salle de chronométrie) en 1931 et de la création de nouveaux bâtiments : pavillon des tables vibrantes en 1932 ou 1934, tour de l’équatorial Secrétan en 1938-1939, bâtiment des horloges à diapason en 1939-1940 (doté vers 1963 d'un petit belvédère pour l'observation des satellites).
Il contribue à une large ouverture de l’établissement. En effet, l’Union nationale astronomique et l’Union nationale de Géodésie et de Géophysique, créées en janvier 1920, cherchent à « provoquer une collaboration plus intime et, partant, plus féconde entre tous les Observatoires français en les associant à une oeuvre commune selon leurs ressources propres en astronomie, météorologie, physique du globe, etc. » L’observatoire de Besançon participe à cette œuvre commune, aux côtés de ceux d’Abbadia (Hendaye), Nice et Toulouse, en établissant à l’aide de sa lunette méridienne un catalogue des étoiles repères, utilisé ensuite pour la constitution de la carte du ciel et du catalogue photographique international. De même, les observations sismiques sont rapidement communiquées aux différents observatoires sismiques et au Bureau central sismologique de Strasbourg. L’observatoire de Besançon est d’ailleurs classé en 1927 au nombre des Observatoires de physique du globe.
Chronométrie
. Distribution de l’heureLe service de l’heure est doté en juillet 1919 d’un nouveau poste de TSF, remis à l’observatoire par le Service de Radiotélégraphie militaire en suite à une intervention du général Ferrié, complété en 1920 par un chronographe enregistreur à bande fumée et un amplificateur à résistances.
Auguste Lebeuf signale son importance en écrivant dans son rapport de 1923 : « La tâche du personnel […] se complique journellement par les multiples applications de la T.S.F. aux déterminations de l’heure et aux dépêches météorologiques. » De fait, cette installation soignée est intégrée à un système permettant la vérification des multiples pendules présentes dans les différents services du site (en tout, 10 pendules principales). En 1925, la modification du réseau électrique s’accompagne de l’installation pour elle d’un groupe électrogène dans le sous-sol du pavillon méridien (où est par ailleurs transporté le service de désaimantation, auparavant établi dans le bâtiment de la petite méridienne, ce qui occasionne peut-être la reprise des opérations de lambrissage des pièces du sous-sol constatée en 1926). En 1927, une nouvelle antenne est mise en place et dessert un récepteur spécial construit par le personnel de l’observatoire ; le « parc » est alors de trois antennes et trois récepteurs différents.
L’acquisition de pendules à pression constante, envisagée dès 1914, était de nouveau souhaitée dans un courrier du 3 décembre 1920 : « Il faut ensuite envisager la pendulerie à pression constante et température invariable appelée désormais à se substituer à la pendulerie mécanique proprement dite [...] » En 1923 encore : « Alors que tous les observatoires bien outillés possèdent plusieurs pendules à pression et température constantes, et peuvent avoir dans leur garde-temps une confiance absolue pendant une longue durée, l’Observatoire de Besançon, tout spécialisé qu’il est dans les questions horaires, n’en possède aucune. » Il faudra attendre octobre 1932 pour que l’observatoire en soit doté. Dès 1931, un souterrain de 5 mètres de profondeur est creusé sous la bibliothèque, afin d’éviter les variations de température importantes. La pendule à pression constante n° 1450, de la maison Leroy, y est installée (trois autres la rejoindront au fil du temps : n° 1600 en 1937, 1723 en 1942 et 1769 en 1955).
Le développement de l’utilisation de l’électricité conduit en outre à l’apparition de nouvelles générations de pendules. En 1940, un bâtiment à étage, dit « des horloges à diapason », leur est consacré. Il est construit derrière la bibliothèque par l’architecte bisontin E. Dampenon à qui, six ans plus tard, il sera demandé de faire réaliser une protection - un « tavillonage »- en fibrociment ou zinc sur les façades sud et ouest, qui laissent passer l’eau (où l’on reparle des problèmes d’humidité !).
. Contrôles chronométriques
Fortement désorganisées par la guerre et son cortège de disparitions, les activités du service de chronométrie reprennent normalement le 1er mai 1920, à une date (fixée par le syndicat de la Fabrique) correspondant au début de l’année chronométrique 1920-1921.
Cette même année, l’observatoire s’engage, aux côtés de l’Ecole d’horlogerie de Besançon, dans la création d’une Société des Amis de l’Horlogerie. Celle-ci met sur pied un congrès horloger, à Besançon les 12 et 13 juillet, dont l’une des premières pistes de réflexions est « la normalisation des différents organes de l’horlogerie » : « Cette question, envisagée en commun avec les horlogers et constructeurs suisses, aura très certainement une grosse répercussion sur toute l’industrie nationale. »
Les dépôts reprennent lentement mais la qualité est au rendez-vous et la coupe chronométrique, créée en 1907, est attribuée définitivement en 1924 à la société L. Leroy et Cie, qui l’a remportée trois années consécutives. Elle est alors remplacée par une médaille d’honneur, gagnée par le même constructeur de 1925 à 1928 ! Par ailleurs, une section sportive autonome est introduite dans le règlement général en 1924, à la demande de l’Aéro-Club de France et avec l’agrément de l’Automobile Club de France.
Le nombre des dépôts est moins important qu’avant-guerre et, apparemment, bien plus dépendant des conditions économiques. Dans un rapport de 1929, le directeur de l’observatoire de Paris, Ernest Esclangeon, note : « Un léger fléchissement toutefois paraît se manifester dans la construction et le développement des chronomètres de précision. Peut-être doit-on en trouver la raison dans les grandes facilités actuelles que donnent les émissions horaires pour la détermination et la conservation de l’heure. »
L’année suivante, 253 chronomètres seulement sont présentés au concours. Le nouveau directeur, Baillaud, constate que les industriels des pays voisins jugent plus importante la publicité faite par la délivrance d’un Bulletin d’observatoire - témoignant de la qualité de leur production - que la plus value directement générée sur le prix de vente. En France, c’est l’inverse : « beaucoup de maisons de moyenne envergure tentent bien, en participant à nos concours, d’y obtenir des résultats dont elles puissent se prévaloir auprès de leur clientèle, mais sous réserve de pouvoir récupérer leurs frais par la vente des chronomètres primés. On comprend alors que nos concours soient affectés par toutes les causes qui touchent à la vente de ces chronomètres. » Et de citer les effets de mode qui font préférer les montres plates aux chronomètres. Il ajoute que les industriels français attendent, de plus, que ce soit l’observatoire lui-même et non eux qui assure la publicité de ses concours. Autre source possible de désaffection : l’attribution définitive de la coupe à un fabricant. « La Coupe a été pendant près de vingt ans la source d’une grande émulation entre les fabricants. Elle est sans doute la cause directe du développement de la chronométrie française pendant le premier quart de ce siècle. »
Pour sortir de la crise, il propose tout un ensemble de mesures : création d’une nouvelle coupe chronométrique (dont le règlement est approuvé par le ministre le 19 août 1930) à laquelle pourront concourir l’ensemble des fabricants français et qui ne sera jamais attribuée définitivement à l’un d’entre eux en particulier, ouverture d’un concours spécial pour les petits chronomètres plats, dotation de prix importants au concours des régleurs pour susciter de nouvelles vocations. Par ailleurs, l’observatoire va faire sa publicité par des communiqués, causeries et autres émissions de signaux horaires relayés par la TSF.
Il s’associe aussi à l’Ecole d’horlogerie pour la création commune d’un service du Poinçon de Besançon (le poinçon retenu représente les armes de la ville de Besançon) attestant de la bienfacture non plus des chronomètres mais des montres courantes de qualité, susceptibles en outre de recevoir un certificat de réglage délivré par l’observatoire. « Certes, en cherchant à encourager en France la production des montres de qualité, les promoteurs du Poinçon espèrent donner en même temps une impulsion à celle des chronomètres de précision susceptibles d’être primés aux Concours de l’Observatoire ; mais, quelque intéressant que soit ce résultat, il ne serait à leur avis qu’accessoire. Le but est simplement, en garantissant la parfaite exécution mécanique et le réglage impeccable des montres poinçonnées, de stimuler la belle fabrication horlogère française. »
Un redressement de la situation est perceptible dès 1931 avec 293 dépôts et, l’année suivante, Baillaud peut se féliciter que le concours de 1932 soit le premier concours chronométrique national (si l’on fait exception de celui de 1905). Acquise par souscription, la coupe dessinée par Hatot est, quant à elle, décernée pour la première fois en 1933.
René Baillaud annonce également en 1930 le remplacement du Bulletin chronométrique par les Annales françaises de chronométrie, organe officiel de l’observatoire, de l’Institut de Chronométrie et de la Société chronométrique de France.
En 1931 est mentionnée l’installation d’un grand appareil frigorifique destiné aux épreuves de réglage des chronomètres, ce qui entraîne une modification du règlement du concours avec l’adoption d’une température de 4° au lieu de 0° pour les épreuves de compensation. Par ailleurs, un service d’essais voit le jour, l’observatoire réalisant divers essais et contrôles à la demande des fabricants. Il peut ainsi prendre en compte les pendules et pendulettes (quelques pendulettes électriques avaient été déposées en 1925).
Toutefois, la guerre a aussi eu pour effet d’ouvrir de nouvelles perspectives.
Dans le Rapport sur les observatoires de province de 1919, Auguste Lebeuf écrivait : « Pour répondre aux besoins de la navigation maritime, l’horlogerie a fait les progrès que l’on sait, avec le chronomètre de marine ; il nous a semblé que la navigation aérienne pouvait aussi poser des problèmes nouveaux à l’horloger et nous avons pris l’initiative de mettre les ressources et moyens chronométriques de l’Observatoire à la disposition des services techniques de l’aviation militaire et civile. La Caisse des recherches scientifiques nous a généreusement accordé un crédit de 2,500 francs pour faciliter cette future collaboration ; nous pouvons ainsi aborder les épreuves préliminaires que les services intéressés nous soumettrons prochainement. » En 1920, une première partie de l’équipement était acquise - en l’occurrence une pompe à vide Moulin destinée à la réalisation d’épreuves chronométriques à pressions variables (basses pressions notamment) - complétée en 1922 par une étuve Hearson, destinée aux épreuves à basses températures (l’étuve glacière réalisée par Chofardet étant refaite dans le courant du printemps 1923).
René Baillaud s’inscrit dans la continuité de cette orientation. En 1931, à la suite de ses démarches, le service technique de l’Aéronautique confie à l’observatoire le soin de contrôler la totalité de ses montres, chronographes et compteurs. L’Aéronautique assure la prise en charge des frais d’aménagement des locaux (au sous-sol de la méridienne dans un premier temps, à l’emplacement du laboratoire photographique) et d’installation de l’équipement dont il le dote. Un pavillon adapté, en rez-de-chaussée, est d’ailleurs construit dès 1933 ou 1934 au nord-est de la méridienne pour accueillir les tables vibrantes fournies (et un nouveau service de l’observatoire : la gravimétrie).
Astronomie
Les activités astronomiques ont repris après la guerre mais l’altazimut est alors délaissé - faute d’observateur et de réparation (câble de synchronisation avec sa pendule directrice) - de même que l’équatorial droit, qui sert épisodiquement pour l’observations d’éclipses.La diffusion de l’heure par la TSF a permis de libérer un peu la lunette méridienne de sa tâche de « fabrication » de l’heure. Lebeuf souhaite la moderniser par l’adjonction - envisagée dès avant la guerre - d’un micromètre impersonnel mais les conditions économiques reportent ce projet qui, ensuite, traîne en longueur - occasionnant d’ailleurs un arrêt des observations. Ce n’est finalement qu’en 1929 que le micromètre impersonnel est mis en place. La lunette est ensuite utilisée pour l’observation d’étoiles circumpolaires et galactiques.
Le premier directeur, Louis-Jules Gruey, et sa veuve ayant légué leur fortune à l’observatoire, Baillaud choisit de la consacrer à l’acquisition d’une nouvelle lunette équatoriale. En 1938 et 1939, une tour coiffée d’un dôme en aluminium est construite au sud de la méridienne pour recevoir cet instrument, un équatorial triple Secrétan-Couder, comportant deux tubes photographiques et un tube visuel. La seconde guerre mondiale bloque la fabrication de cet astrographe, si bien qu’il ne sera mis en place qu’en 1952.
Météorologie
La météorologie poursuit ses activités, malgré un appareillage déclaré usé à la fin des années 1910 et dont le renouvellement est longuement désiré. Les observations quotidiennes sont fréquentes (« observations trihoraires de la pression barométrique, température, état du ciel, direction et vitesse des nuages et hauteur d’eau tombée en 24 heures »), imposant la tenue de registres et le calcul de nombreuses moyennes. De multiples dépêches et communications doivent en être faites tant à la presse locale qu’à l’Office national météorologique, à la Commission météorologique départementale, aux Services d’hygiène de la ville, à diverses associations… Ce qui laisse peu de temps pour des activités de recherche complémentaire, sur les orages, le climat, etc. La parution en 1928 de deux mémoires intitulés Contribution au climat bisontin et Température moyenne quotidienne pour quarante ans d’observations 1884-1924 est donc notable, tout autant que les Eléments provisoires du climat bisontin publiés en 1922.Le 13 mars 1931, une convention signée entre le recteur de l’université et le directeur de l’Office national météorologique crée à Besançon un poste météorologique, relevant de l’université pour la gestion du personnel et de l’ONM pour le côté technique. Fondé une dizaine d’années plus tôt, par un décret en date du 25 novembre 1920, l’Office national météorologique est né de la fusion du Bureau central météorologique et des services météorologiques du Ministère de la Guerre et de la Navigation aérienne. A compter du 31 juillet, c’est donc l’ONM, avec un personnel qu’il recrute mais qui doit être agréé par le directeur de l’observatoire, qui se charge des observations météorologiques. Le poste compte deux personnes dès l’année suivante, hébergées dans un « petit pavillon qui abritait autrefois un petit instrument méridien et qui est aujourd’hui inutilisé ». Situé entre la bibliothèque et le logement du directeur, ce pavillon correspond à la première construction réalisée sur le terrain, en 1881, lors de la détermination de la longitude du site, et affectée ensuite à une petite méridienne puis au service de désaimantation.
Gravimétrie
Un nouveau service ouvre en 1931 lorsque l’observatoire acquiert un pendule Holweck-Lejay (n° 52), destiné à la mesure de la gravité terrestre, qui lui est livré le 23 juin. L’aide-astronome qui en est chargé, Raoul Goudey, commence une série de mesures dans la France entière et en Suisse, collaborant ainsi au programme de travail établi par le Comité national de Géodésie et de Géophysique. Ce service prend place dans le pavillon construit pour les tables vibrantes en 1934, près de la méridienne. Il réalisera la carte gravimétrique générale de la France, utilisant plusieurs gravimètres Holweck-Lejay (n° 52, 518, 518 bis, 651).Le 3e quart du 20e siècle
La seconde guerre mondiale entraîne son lot de perturbations avec, notamment, l’installation de troupes sur le site.A leur départ, le directeur écrit au service d’architecture de la ville pour que soit refaite la haie de clôture, saccagée par les manœuvres allemandes et laissant libre cours aux maraudes « aussi bien dans nos vergers que dans les jardins familiaux attribués dans notre parc aux membres de l’université ». Devant le nombre des ouvertures pratiquées dans la haie, il note : « Actuellement, notre Etablissement n’est pratiquement plus clôturé ». Il se plaint des désagréments « d’un ordre particulier » commis « par des soldats allemands et des femmes qui venaient chercher dans notre parc un asile tranquille », désagréments jugés intolérables lorsqu’ils se poursuivent du fait des Français, et conclut : « A cet état des choses, il n’y a certainement qu’un remède efficace : clôturer notre propriété ». Il préconise donc le replantage de la haie là où cela s’avère nécessaire et, simultanément, que les ouvertures soient closes par des fils de fer barbelés. A la fin de cette même année 1945, dans un courrier au maire, il lui demande de faire reboucher par les Allemands les 132 trous qu’ils ont fait creuser dans le parc.
La guerre suspend pour un quart de siècle les programmes de construction à l’observatoire. A Baillaud, qui lui demande à la fin de 1945 d’envisager la construction de pavillons d’habitation pour les astronomes, la municipalité note que c’est une requête qui lui est présentée périodiquement - en 1932 par exemple - mais qu’elle n’était pas prévue dans la convention initiale et que par ailleurs, il y a alors une crise aiguë du logement. Cette même demande, reformulée à l’attention du ministère dans le cadre de l’élaboration d’un plan quinquennal d’équipement et accompagnée d’un projet de pavillon pour 4 astronomes élaboré par l’architecte de l’université Tournier, demeurera sans suite. De même en 1948 pour son désir de surélévation du bâtiment des tables vibrantes, lui aussi sans suite.
Jean Delhaye (1921-2001) succède en 1957 à René Baillaud et occupe le poste de directeur de l’observatoire jusqu’en 1964 (sa longévité à ce poste, comme celle des directeurs suivants, est moins grande que celle de leurs prédécesseurs : 28 ans pour Baillaud, 26 pour Lebeuf, 22 pour Gruey).
Chronométrie
. Distribution de l’heureAu lendemain de la guerre, le service de l’heure maintient ses activités et continue de se doter des pendules nécessaires à son fonctionnement. Ainsi, le 21 août 1942, le ministère approuve le marché entre le recteur de l’université et Léon Leroy, directeur de la société L. Leroy et Cie, pour l’achat d’une pendule à pression constante, d’un montant de 60 000 F. Cette pendule, la n° 1723, est la troisième de ce type installée sur le site (une quatrième, la n° 1769, sera acquise en 1955). René Baillaud signale en 1948 que les étalons de temps de l’observatoire sont constitués par trois horloges à pression constante Leroy et deux horloges radioélectriques Belin, permettant le contrôle des montres et chronomètres déposés.
La décennie suivante est marquée par le quartz : le directeur signale en 1953 l’installation d’une horloge à quartz sur un pilier « à l’intérieur de notre bâtiment des horloges radioélectriques » (bâtiment dit des horloges à diapason). Cette acquisition était demandée depuis 1948 déjà.
Au milieu des années 1960, l’équipement de l’observatoire comprend trois horloges à quartz (dites « oscillateurs transistorisés ») : James Knights à 1 MHz, Sulzer à 2,5 MHz et Hewlett-Packard à 5 MHz. En liaison avec son installation de réception des signaux horaires, il lui permet de conserver son échelle de temps, de la comparer avec d’autres et de continuer à diffuser l’heure et des fréquences étalons aux grandes fabriques d’horlogerie de Besançon.
. Contrôles chronométriques
Baillaud précisait en 1948 : « l’Observatoire de Besançon, sans rien abandonner des buts scientifiques qui lui ont été assignés dans les voies de l’Astronomie et de la Physique du Globe, se présente comme un Laboratoire d’essais des instruments horaires. Son rôle, il l’a assumé depuis 1882, avec des conceptions qui ont, naturellement, évolué […] »
Et d’expliquer plus en détail en quoi consiste cette fonction de prestataire de services « indépendant et impartial » : « Jusqu’à présent, ces contrôles ont surtout été de deux sortes : les uns destinés aux Services de l’Air, les autres réservés aux besoins civils. L’Observatoire joue, en effet, pour les premiers le rôle de laboratoire d’essais des instruments horaires qu’ils mettent en commande. Les épreuves correspondantes sont essentiellement des épreuves de position, de température, de magnétisme, de vibration, d’étanchéité ; pour y satisfaire, les montres doivent passer successivement dans des étuves, des appareils frigorifiques, des solénoïdes, sur des tables vibrantes, sous l’eau […] Quant à l’action de l’Observatoire dans le domaine civil, elle peut répondre à des besoins variés puisque cet Etablissement est largement ouvert à ceux qui font appel à ses contrôles. Mais son activité prépondérante consiste aujourd’hui dans des essais pour la détermination de la marche des montres de qualité dites " à étoiles ", montres auxquelles des étiquettes ou des dépliants spéciaux sont délivrés en garantie des résultats obtenus. Les montres sont déposées par les Fabricants pour être classées dans une des qualités " une - deux - trois - quatre étoiles ". Le personnel de l’Observatoire les compare à ses pendules ; celles qui donnent des résultats satisfaisants reçoivent les étiquettes qu’elles méritent. Les épreuves ont essentiellement pour but la mesure des effets des variations de positions et de température sur la marche de ces montres. Ce service a été institué par le Centre Technique de l’Industrie horlogère [Cétéhor], il fonctionne sous son impulsion et sous sa direction. C’est le Centre Technique qui assure la bienfacture des montres ; pour celle de leur réglage, il utilise les ressources que l’Observatoire de Besançon a pu mettre à sa disposition. »
Cette orientation est maintenue dans le temps : le service chronométrique effectuera ainsi, par exemple, entre le 1er avril 1964 et le 31 mars 1965 10 233 contrôles et essais pour l’industrie horlogère et pour le Service technique de l’Aéronautique.
Le rôle de l’observatoire de Besançon est d’ailleurs rappelé dès 1952 par la Commission internationale des Contrôles chronométriques. Définissant au niveau européen les critères à respecter pour obtenir l’appellation de chronomètre, cette commission désigne, pour chaque pays à tradition horlogère, une seule institution habilitée à délivrer cette appellation. C’est Besançon qui est choisi pour la France, aux côtés de Stuttgart, Tokyo, Milan…
Astronomie
Cette discipline évolue considérablement après la seconde guerre mondiale mais, dans un premier temps, Besançon continue à pratiquer une astronomie de position traditionnelle. Cette « astrométrie » a pour but de fournir, dans un système de coordonnées défini, la position d’un objet céleste en fonction du temps et, ainsi, d’éditer des catalogues de positions d’étoiles.Les observations se font à l’aide de la grande lunette méridienne et à l’astrographe. Grâce aux photographies qu’il permet d’obtenir, ce dernier est utilisé pour déterminer les positions de certaines planètes, qui sont communiquées au Service des petites Planètes à Cincinnati (USA). Il sert aussi, avec sa lunette visuelle, à l’étude des occultations d’étoiles par la lune, en collaboration avec le Service international de Greenwich.
En 1958, l’observatoire organise un service de mesure du temps et de la latitude, équipé d’un astrolabe impersonnel Danjon qui lui permet d’étudier la rotation de la terre et la variation des latitudes. Cet instrument n’est pas disponible immédiatement mais, en attendant son acquisition, le service utilise un prototype prêté par l’observatoire de Paris pour lequel, en octobre, une coupole provisoire est mise en place (celle définitive sera montée à l’été 1959). L’équipement est complété par des oscillateurs à quartz et chronographes imprimants (dont un chronographe électronique). Des comptes rendus hebdomadaires sont adressés au Bureau international de l’Heure à Paris et au Service international des Latitudes à Mizusawa.
Météorologie
Le 12 octobre 1945, pour définir leurs relations, une convention est passée entre l’observatoire et le tout nouveau service de la Météorologie nationale, en cours de réorganisation afin de prendre en compte l’essor croissant de l’aviation. Issu de l’Office national météorologique, ce dernier est officiellement créé par l’ordonnance du 2 novembre et l’arrêté du 21 novembre 1945, qui le rattachent au Ministère des Travaux publics, des Transports et de la Reconstruction. Ces textes lui attribuent la double mission de contribuer à assurer la sécurité des biens et des personnes, et de conserver la mémoire du temps (à noter que les travaux liés à l’étude de la climatologie de la région restent sous le contrôle de l’observatoire). Le poste météorologique devient indépendant et son parc des instruments est transféré près du bâtiment occupé depuis le début des années 1930 (ancien bâtiment de la petite méridienne).Une quinzaine d’années plus tard, ce local est devenu trop exigu, aussi un projet d’agrandissement est-il étudié. En 1961, l’Etat et la ville de Besançon signent un bail emphytéotique de 65 ans permettant l’occupation d’un terrain municipal et la construction d’un bâtiment en rez-de-chaussée, qui reviendra en pleine propriété à la ville à l’expiration du bail. La municipalité émet la réserve « que les projets de construction seront préalablement soumis au Directeur de l’Observatoire pour accord, l’activité de l’Observatoire ne devant en aucune manière être perturbée par la présence de bâtiments trop élevés ou mal situés » . Ce projet ne semble pas avoir eu de concrétisation immédiate.
L’ère du temps atomique
En 1967, la définition du temps change et se base sur la période de l’atome de césium. Le passage au temps atomique nécessite que soient redéfinies les missions de l’observatoire, les locaux et les instruments nécessaires (nombreux étant ceux qui deviennent obsolètes). C’est à cette réorientation que travaille le directeur de l’époque, Louis Arbey (1908-1972), nommé le 1er octobre 1964. Sans négliger la chronométrie, il développe la recherche fondamentale et obtient des moyens conséquents.A la fin des années 1960, le site comprend 33 personnes : 8 relevant du personnel des observatoires, 4 de la Faculté des Sciences, 4 (dont 2 à mi-temps) du CNRS, 2 du personnel administratif et 7 du personnel technique de l’enseignement supérieur, 3 du CNES, 2 personnel de service et 3 auxiliaires. L’observatoire est organisé en 8 services : Administration - Bibliothèque, Contrôle des montres, Statistique stellaire, Temps atomique (à compter du 4 janvier 1965), Temps universel - Latitudes, Satellites artificiels - Astrographe (incluant la sismographie, apparemment encore active jusqu’en 1972 ), Méridien et Service technique (chargé, notamment, de la comparaison des horloges et de l’envoi de fréquences étalons et tops horaires).
Conséquence logique de cette réorganisation et de l’augmentation importante du nombre de personnes sur le site : le 24 mai 1967, l’Etat et la ville de Besançon signent un nouveau bail emphytéotique de 65 ans permettant la construction « d’un bâtiment à usage de laboratoires et de bureaux, nécessaires à l’extension de l’Observatoire de Besançon », qui reviendra en pleine propriété à la ville à l’expiration du bail.
Ce bâtiment au plan en U - dit Laboratoire de Mesure des Fréquences et des Temps - est édifié de 1970 à 1973, dans la partie sud du site, où se trouvait la coupole de l’équatorial droit (réception provisoire le 17 février 1972). Il est dû à Jean Balme, architecte DPLG et DTP, professeur à l’Ecole nationale des Beaux-Arts de 1946 à 1975 (et auteur du bâtiment du Laboratoire de l’Horloge atomique, situé à proximité immédiate), et Jean-Pierre Rocher, architecte DPLG, établis 26 rue du Château d’eau à Dijon. Le 3 janvier 1979, Balme rend une estimation et un devis descriptif pour une extension du bâtiment par la construction d’une galerie couverte au sud, fermant le U. Les travaux ont lieu en 1980 et 1981 (réception le 31 mars 1981).
En ce 4e quart du 20e siècle, le site est menacé par l’urbanisation du quartier de la Bouloie. En effet, ce quartier a été rattrapé par la ville dès la fin des années 1950 : zone industrielle de Trépillot de 1957 à 1964 (85 ha) immédiatement prolongée par celles des Tilleroyes et de Châteaufarine (60 ha), campus dans les années 1960… Le développement de ce dernier ne cesse d’augmenter la pression foncière, et le site de l’observatoire de susciter des convoitises.
Ainsi, dès 1961, la ville signait un bail emphytéotique de 65 ans avec le CNRS afin de lui permettre de construire un bâtiment pour le Laboratoire de l’Horloge atomique (sans lien fonctionnel direct avec l’observatoire), créé en 1958 à Besançon par les professeurs Alfred Kastler (prix Nobel de Physique) et Jean Uebersfeld. Le bail mettait à sa disposition une parcelle de terrain distraite de la partie nord du site (ce laboratoire est devenu en 1974 le LPMO : Laboratoire de Physique et Métrologie des Oscillateurs).
Après plusieurs projets - dont un (inabouti) de parc scientifique dans les années 1980 - et la construction d’un bâtiment pour la météorologie au milieu de cette même décennie 1980, un nouvel empiètement sur le parc a lieu, dans sa partie sud-ouest (cadastre EZ 2), en 1994 afin que le rectorat construise un restaurant universitaire. Par ailleurs, le bâtiment de la petite méridienne vient d’être rasé en 2003 pour laisser la place à une Maison de l’Etudiant.
Chronométrie
. Distribution de l’heureLes années 1960 sont donc pour l’observatoire celles du passage au temps atomique.
Le service chronométrique s’équipe en 1969 d’une horloge atomique au césium (à 5 MHz), capable d’apprécier la nanoseconde, qui, avec trois horloges à quartz, permet d’élaborer une échelle de temps atomique locale. Il peut ainsi, en 1971, s’intégrer au réseau des laboratoires de métrologie et participer à la constitution des échelles de temps française et internationale. Devenues inutiles, les horloges à pression constante sont désaffectées (vers 1964).
. Contrôles chronométriques
A partir de la décennie 1960, la précision est assurée par le quartz, affaire d’ingénieur plutôt que d’horloger. Alors que l’industrie horlogère locale entre en crise, les concours chronométriques perdent de leur pertinence et disparaissent : la coupe est décernée de 1970 à 1973 à la société Maty et, pour la dernière fois, en 1974 à la société Lip .Toutefois, l’observatoire conserve ses compétences en ce domaine et obtient, en 1971, l’agrément du Bureau national de Métrologie comme centre d’étalonnage Temps-Fréquence.
Astronomie
L’évolution rapide de la discipline entraîne une obsolescence accélérée des instruments, qui se révèlent inadaptés pour la recherche. Ils sont donc désaffectés les uns après les autres et le site perd, dès les années 1960, la quasi-totalité de ses coupoles.En 1967, l’équatorial coudé de Loewy est démonté (la plupart des pièces métalliques sont cependant conservées). La terrasse qui précède le bâtiment est supprimée et celui-ci est prêté à l’Association astronomique de Franche-Comté. Le docteur Jean-Marc Becker, membre de l’AAFC, le dote d’un dôme en résine de synthèse, en remplacement de celui existant, pour accueillir un télescope de 400 mm de fabrication artisanale. Le début de la décennie 1980 voit la fin de l’utilisation régulière des lunettes. Il en est ainsi pour la méridienne, servant alors à l’élaboration de catalogues de position d’étoiles (elle ne « fabrique » plus l’heure depuis la création du temps atomique en 1967), désormais inutilisée. L’astrographe Secrétan est lui aussi désaffecté, en 1981, lorsque part à la retraite la personne qui s’en occupe. Toutefois, il sert encore épisodiquement à des fins d’enseignement.
La recherche astronomique s’oriente selon différents axes, générant autant de services, et se structure au milieu des années 1980 autour de trois thèmes de recherche principaux :
– atmosphères planétaires et cométaires ;
– structure et dynamique des systèmes planétaires ;
– structure, dynamique et évolution galactique.Ce positionnement permet au personnel bisontin de participer à des programmes internationaux (Vega, Hipparcos…).
Le service de l’Astronomie planétaire étudie les couches chaudes des atmosphères des planètes. Au cours des années 1970, il met au point une expérience visant à libérer dans l’atmosphère de Vénus un ballon pressurisé, doté de matériel d’analyse et plafonnant à 55 km d’altitude. Cet équipement doit être embarqué dans une sonde soviétique et largué lors de la mission Venera 84 mais, en 1980, les Soviétiques modifient leurs objectifs en ajoutant à l’étude de la surface de Vénus une traversée de la comète de Halley à l’horizon 1986. L’expérience bisontine fait partie des deux seuls projets français alors retenus, pour une mission qui change son nom pour Véga. Les services techniques de l’observatoire sont mobilisés à plein temps pendant trois ans pour concevoir et fabriquer un spectromètre tricanal, destiné à réaliser des images spectrales de la comète dans trois domaines de longueur d’onde (infrarouge, visible et ultraviolet). Le lancement a lieu en 1984 avec un survol de Vénus en juin 1985 et la traversée de la comète en février 1986.
Le service de l’Astronomie stellaire s’intéresse aux grandeurs physiques des étoiles - masse, luminosité, distance, vitesse, composition - qui permettent d’en comprendre l’histoire. L’éclat et la couleur de certains groupes (étoiles binaires notamment) sont plus particulièrement mesurés, à l’Observatoire européen du Sud au Chili. Le service constitue ainsi l’une des plus importantes bases de données mondiales concernant les étoiles doubles et multiples.Par ailleurs, il utilise la grande lunette méridienne (partiellement automatisée en 1972) pour élaborer un catalogue d’étoiles de type spectral F. En le comparant à des catalogues plus anciens, il peut en déduire le mouvement de ces étoiles et, à la suite d’un travail statistique sur ces données, retracer les mouvements d’ensemble des étoiles et les comparer à des modèles dynamiques de la galaxie.
Enfin, celui de l’Astronomie galactique et extragalactique étudie la structure, la dynamique et l’évolution des galaxies. La distribution de la lumière et des couleurs dans une galaxie, déterminée à partir de plaques photographiques exposées avec différents filtres et différents temps de pose, permet d’obtenir des informations sur la répartition de la matière et sa composition chimique. Les mouvements internes et la dynamiques des galaxies sont étudiés à partir d’observations optiques (spectroscopie ou interférométrie de Pérot-Fabry) ou radio-astronomique. Toutes ces observations permettent l’élaboration de modèles théoriques de galaxies, constituées d’étoiles et de gaz.
Météorologie
En 1983 et 1984, la météorologie se dote de nouveaux locaux, délaissant les anciens (qui lui serviront de remise jusqu’au 1er avril 1992 puis abriteront le projet Aurore). Elle s’installe à l’automne 1984 dans le bâtiment édifié à l’ouest de la bibliothèque par les architectes Jean-Jacques Bourlanges et Serge Madon, du Service technique des Bases aériennes à Paris (le maître d’œuvre est la Direction départementale de l’Equipement). Cette construction est complétée en 1992 par des garages dessinés par Michel Bourgeois, architecte à Cussey-sur-l’Ognon (Haute-Saône). La dernière évolution notable en cette fin de 20e siècle est le transfert du parc aux instruments en novembre 2001 (officialisé en avril 2002) afin de libérer un terrain nécessaire à de nouvelles constructions universitaires.L’instrumentation actuelle (2005) associe thermomètre PT 100 et hygromètre électroniques Vaïsala (société finlandaise fondée en 1936, établie à Vantaa), baromètre Vaïsala, pluviomètre Préci-Mécanique, anémomètre girouette Degreane type Déolia (mesures à 10 m du sol), pour les mesures d’insolation un héliographe à fibre optique Cimel (172 rue de Charonne, à Paris), pour mesurer la puissance du rayonnement solaire un pyromètre Kipp & Zonen (société fondée aux Pays-Bas en 1830, établie à Delft)… La centrale d’acquisition est une Miria 25, de la société Degreane (société française fondée en 1927, établie dans le Var). Le personnel est passé de 5 au début des années 1980 à 12 maintenant, pour tenir compte des besoins en maintenance résultant de l’automatisation des stations et du développement de l’informatique. L’ensemble des relevés de température et de pluviométrie, depuis l’ouverture d’un service météorologique à Besançon, est d’ailleurs informatisé.
L’observatoire au début du 21e siècle
Ce chapitre (complété en 2009), en partie rédigé par l’actuel directeur de l’observatoire, François Vernotte, élu en 2002, évoque les missions et la place de l’observatoire de Besançon en 2005.Classé par décret en juin 1985 au rang des Observatoires des Sciences de l’Univers (OSU), l’établissement relève d’une double tutelle : il dépend de l’Institut national des Sciences de l’Univers (rattaché au CNRS) et de l’Université de Franche-Comté, dont il compose à lui seul l’Unité mixte de Recherche (UMR) Laboratoire d’Astrophysique de l’Observatoire de Besançon.
Doté d’un équipement lourd - 3 horloges atomiques, doublant celles de l’observatoire de Paris -, il doit s’acquitter de missions de service en liaison avec sa spécialisation : le Temps-fréquence. Parallèlement, il poursuit ses propres recherches et une partie de ses membres a une activité d’enseignement.
Par ailleurs, intégré au sein du réseau des observatoires, il participe comme eux aux services d’observations qui mutualisent les données collectées par les uns et les autres, pour les mettre à disposition de la communauté des astronomes.
Ainsi, l’équipe d’Astrophysique des grands relevés est particulièrement impliquée dans la préparation de la mission Gaia, de l’Agence spatiale européenne, par exemple en implémentant son modèle de formation des galaxies dans le simulateur de Gaia. De même, il s’investit dans la création d’un observatoire virtuel, dont l’ambition est de rendre accessible à tous les données collectées aux niveaux national et international (il cherche à être reconnu comme l’un des Centres nationaux ou internationaux de traitement et d’archivage des données). Il contribue notamment à l’alimenter avec les résultats des relevés systématiques réalisés par ses chercheurs à Hawaï (USA), avec le télescope de 3,60 m mis en service en 1979 conjointement par la France, le Canada et les Etats-Unis.
L’observatoire de Besançon est organisé en 5 services, réunissant 35 personnes (dont 3 astronomes et astronomes adjoints, et 2 chercheurs CNRS) :
– Temps-fréquence : 9 personnes, soit 5 aux services et 4 à la recherche (dont un en thèse) ;
– Astrophysique des grands relevés : 8 personnes (dont 2 en thèse) ;
– Dynamique et photo-physique des milieux dilués : 7 personnes (dont un en thèse) ;
– Informatique (service support) : 4 personnes ;
– Administration (service support) : 7 personnes, dont 3 à l’entretien (jardinier et concierge inclus).
Depuis quelques années, il s’est engagé dans une politique volontariste de sauvegarde et mise en valeur de son patrimoine, aussi bien instrumental qu’architectural.
Ainsi le 5 mars 1998, il a déposé au Musée du Temps un certain nombre d’objets destinés à y être exposés : horloges Fénon et Leroy (dont 2 des horloges à pression constante), oscillateurs à quartz, pendulette, chronographe enregistreur, récepteurs radio de signaux horaires, petit altazimut, etc. L’inventaire - en cours - de ses instruments anciens va lui permettre d’étudier les conditions de leur préservation, de leur restauration et de leur exposition.
Le cadran solaire analemmatique, réalisé par Gruey en 1902 et redécouvert en 1974, a été restauré en 2004 par l’association Alternative Chantiers, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine et avec le concours actif de l’Association astronomique de Franche-Comté. Cette même année, le site était ouvert aux visites pour les Journées du patrimoine. Le 22 mars 2005, l’allée centrale de la partie nord, remise en état, a été inaugurée sous le nom d’allée René Baillaud.
Cette activité se traduit par une protection des bâtiments au titre des Monuments historiques (inscription à l’Inventaire supplémentaire en cours, classement prévu), celle des objets étant envisagée pour la fin de cette même année 2005 ou pour 2006. D’autres projets attendent encore de se concrétiser, nécessitant la réhabilitation des bâtiments délaissés (maison du directeur par exemple) : installation d’un planétarium, ouverture au public du pavillon de la méridienne et du bâtiment de l’astrographe, création d’un « Jardin des Etoiles et du Temps »…
Temps-fréquence
. Étude des échelles et transferts de tempsL’observatoire continue à « fabriquer » l’heure. Seulement, les théories et les techniques ont largement et rapidement évolué, permettant de travailler avec des précisions de l’ordre de 10 9 seconde. Maintenant, les échelles de temps sont construites en collectant, grâce au système GPS, les temps donnés par un grand nombre d’horloges atomiques à travers la planète et en les comparant. L’équipe travaille à améliorer la précision des transferts de temps en utilisant la phase de l’onde porteuse du signal du GPS. Elle participe également au système Galileo (équivalent européen du GPS), en élaborant une échelle de temps de bord à partir des deux horloges embarquées dans chaque satellite.Autre collaboration : la station spatiale internationale embarquera une horloge à atome froid (Pharao) et un maser à hydrogène. Mais elle ne sera observable que quelques minutes par période orbitale, pendant 4 ou 5 périodes, puis sera invisible pendant près de 24 heures. Il est nécessaire d’étudier les effets de cette fenêtre temporelle d’observation sur les transferts de temps.
Enfin, d’autres projets sont en cours, par exemple la construction d’une échelle de temps bisontine basée sur des horloges ayant des caractéristiques différentes, ou la synchronisation des données collectées par l’observatoire Auger, en Argentine, détectant des rayons cosmiques à très haute énergie.
. Missions de service
Contribuant à l’élaboration et l’amélioration d’échelles de temps (le temps atomique français et le temps atomique international), l’équipe participe à leur dissémination au niveau national. Elle poursuit donc ainsi l’une des tâches premières de l’observatoire : la distribution de l’heure exacte. Par ailleurs, elle conçoit et réalise des appareils temps-fréquence, essentiellement destinés aux autres observatoires. Ces deux missions - distribution de l’heure et réalisation d’appareils temps-fréquence - ne sont pas destinées uniquement à des clients institutionnels mais sont largement ouvertes sur le monde de l’industrie.
Dans la droite ligne de ses activités chronométriques passées, l’équipe assure toujours, aussi bien pour le secteur privé que public, le contrôle, l’étalonnage et la certification des instruments de mesure du temps, de la montre à l’horloge atomique.
En 2007, plusieurs fabricants de montre mécanique de prestige ont demandé à l’Observatoire de certifier à nouveau la qualité de leur production : son poinçon à tête de vipère, qui a cessé d’être frappé il y a trente ans, reste en effet un label très recherché par les amateurs d’horlogerie. Le service Temps-Fréquence a donc décidé de reprendre ses activités chronométriques et de délivrer un nouveau bulletin de marche. Le premier de ces certificats a fait l’objet d’une remise officielle dans la salle du cercle méridien le 6 février 2008.
Astrophysique des grands relevés
L’objectif final et à long terme de ces recherches est de comprendre l’évolution et la structure de l’univers. L’équipe y participe de différentes façons.Elle étudie la galaxie, en développant des modèles numériques, pour mieux comprendre sa structure et son évolution. Le modèle construit à Besançon donne des éléments pour expliquer la distribution actuelle des étoiles et tester les scénarios de formation et d’évolution des galaxies que les théoriciens imaginent. Elle observe aussi les petits corps du système solaire externe, au-delà de Jupiter. Par leur position, ceux-ci n’ont que peu évolué depuis leur création et leur grand nombre permet d’utiliser les statistiques pour dégager leurs caractéristiques communes. Les données recueillies (la distribution dynamique des petits corps et leurs propriétés physico-chimiques) peuvent ensuite venir améliorer le modèle de formation du système solaire interne (planètes telluriques). Enfin, l’observatoire, depuis sa création, s’intéresse aux étoiles doubles. Ces étoiles tournent l’une autour de l’autre. En observant ces mouvements, il est possible de retrouver leur masse par la loi de Kepler. D’une part, ces données amènent de l’eau au moulin des modèles d’évolution stellaire. D’autre part, elles viennent alimenter une base de données bisontine, mise à disposition de la communauté des astronomes.
Dynamique et photo-physique des milieux dilués
L’étude des gaz et l’évolution des molécules dans différents milieux sont au cœur des recherches de cette équipe.D’une part, dans la haute atmosphère où se déroulent des réactions entre l’ozone et les protons, sous l’action de rayonnements, qui produisent des radicaux hydroxyles. Ces radicaux se décomposent ensuite en émettant un rayonnement infrarouge. C’est celui-ci qui est détecté, pour créer une cartographie 3D précise des nuages de radicaux et de leur mouvement. Leur connaissance est utile pour les observations astronomiques, le « fond de ciel » étant gênant, et pour la préservation de l’environnement.
D’autre part, dans les milieux astronomiques, l’équipe s’intéresse de façon théorique à la détection de certaines molécules et aux réactions qu’elles produisent. Chaque molécule, lorsqu’elle rencontre un rayonnement, réagit en émettant de la lumière, qu’elle soit visible ou non. Sa composition est caractéristique de la molécule. Les travaux de l’équipe consistent donc à développer des modèles, dans le cadre de la mécanique quantique, qui permettraient de déterminer le signe distinctif de chaque molécule... et ainsi de les détecter plus facilement dans un milieu astronomique.
Description
Partie nordLaboratoire d’essais dit « pavillon des horloges à diapason »
Construit en 1939-1940, par l’architecte E. Dampenon
Dimensions : 12,75 x 6 m
Murs : moellon calcaire apparent ; essentage de tôle sur les murs sud et ouest
Etage : étage carré et étage en surcroît ; élévation à travées
Escalier : escalier dans-œuvre tournant à retours avec jour, en bois
Couverture : toit à longs pans, demi-croupes, lanterneau à charpente métallique ; tuile mécanique, métal en couverture (le lanterneau, à couverture métallique, est mobile sur des rails et permet de dégager un espace d’observation)
Laboratoire d’essais dit « pavillon des tables vibrantes »
Construit en 1932 ou 1934. Désaffecté
Dimensions : 13,50 x 6 m
Murs : soubassement du mur en moellon calcaire apparent, parpaing de béton enduit au-dessus ; travée nord en béton armé
Etage : en rez-de-chaussée
Couverture : toit à longs pans, demi-croupes ; tuile mécanique
Ancien laboratoire d’essais de la chronométrie, actuellement garage
Construit dans la 2e moitié du 20e siècle
Dimensions : 12 x 10,50 m
Murs : parpaing de béton enduit
Etage : en rez-de-chaussée
Couverture : toit à longs pans, pignons couverts ; tuile mécanique
Station météorologique
Construit en 1983-1984, par les architectes Jean-Jacques Bourlanges et Serge Madon, du Service technique des Bases aériennes (STBA)
Dimensions : 27 x 11 m
Murs : parpaing de béton, béton armé, brique, enduit partiel
Etage : étage carré
Escalier : escalier dans œuvre, en béton
Couverture : terrasse, appentis ; zinc laqué
Partie sud
Maison du directeur
Construite en 1883-1884, par l’architecte Etienne-Bernard Saint-Ginest. Désaffectée
Dimensions : 13,20 x 12,70 m
Murs : moellon calcaire apparent ; essentage de tôle sur les murs sud et ouest
Etage : sous-sol, étage carré et étage en surcroît ; élévation ordonnancée
Escalier : escalier dans-œuvre tournant à retours avec jour, en bois
Couverture : toit brisé en pavillon ; tuile mécanique, zinc en couverture (sur les terrassons)
Conciergerie
Construite en 1883-1884, par l’architecte Etienne-Bernard Saint-Ginest
Dimensions : 22,50 x 9,75 m
Murs : moellon calcaire apparent ; essentage de tôle sur les murs sud et ouest
Etage : sous-sol, étage carré et étage en surcroît
Escalier : escalier dans-œuvre tournant à retours avec jour, en bois
Couverture : toit à longs pans, croupes, pignons couverts, noues ; tuile mécanique
Bureaux et laboratoire d’essais
Construits de 1970 à 1973, par les architectes Jean Balme et Jean-Pierre Rocher. Agrandis en 1980-1981
Dimensions : 37,50 x 40,50 m
Murs : parpaing de béton, béton armé, pan de béton armé, enduit
Etage : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Escalier : escalier dans œuvre tournant à retours avec jour, en béton
Couverture : toit à longs pans, pignons couverts, appentis ; métal (terrasses béton jusqu’à la fin des années 1990)
Historique
L'Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique de Besançon est créé par le décret présidentiel du 11 mars 1878, à la demande de la ville de Besançon et des horlogers du Doubs, soucieux d'améliorer la production locale. La convention signée en 1882 entre le maire de Besançon et le ministre de l'Instruction publique stipule que l'achat du terrain et la construction des bâtiments sont à la charge de la ville, l'Etat finançant les instruments scientifiques et le fonctionnement, et le Conseil général les instruments météorologiques. Après un premier projet d'Edouard Bérard en 1879, le conseil municipal approuve le 16 janvier 1883 celui de l'architecte du département, Etienne-Bernard Saint-Ginest (1831-1888), établi en accord avec le directeur de l'observatoire, Louis-Jules Gruey, qui préconise la séparation des fonctions au sein de bâtiments isolés. L'établissement est inauguré le 16 août 1884 mais des malfaçons importantes nécessitent de lourdes réparations en 1888. Aménagé en parc boisé à partir de 1904, le site réunit les activités scientifiques dans sa partie nord : méridienne et équatorial coudé, bibliothèque (abritant aussi le service météorologique et, à partir de 1909, la sismographie), petite méridienne et dômes, glacière... Bien que partiellement occupée par le dôme de l'équatorial droit, la partie sud est dévolue au logement : maison du directeur et conciergerie. Un cadran solaire analemmatique, réputé être le 3e plus ancien au monde, y est construit en 1902. De nouveaux bâtiments sont édifiés dans le 2e quart du 20e siècle pour les tables vibrantes en 1932 ou 1934, l'équatorial Secrétan (astrographe) en 1938-1939 par les entrepreneurs Pateu et Robert et les horloges à diapason en 1939-1940 par l'architecte E. Dampenon (doté vers 1963 d'un petit belvédère pour l'observation des satellites). La seconde moitié du siècle voit la construction au sud, de 1970 à 1973, par les architectes dijonnais Balme et Rocher, des laboratoires et bureaux actuels (agrandis d'une galerie couverte en 1980-1981) et, au nord, en 1983-1984, du bâtiment de la météorologie par les parisiens Bourlanges et Madon, du Service technique des Bases aériennes (STBA). Accompagnant les évolutions technologiques et le passage au temps atomique en 1967, l'établissement est toujours actif, notamment dans le domaine du Temps-Fréquence.
- 4e quart 19e siècle
- 2e quart 20e siècle
- 3e quart 20e siècle
- 4e quart 20e siècle
Date de naissance : 15/02/1831 - date de décès : 02/09/1888
Né le 15 février 1831 à Toulouse (Haute-Garonne), mort à Besançon (Doubs) le 2 septembre 1888. A l’Ecole des beaux-arts, il est élève de Labrouste et Questel. En 1861, alors qu’il est employé par Baltard, il est nommé architecte départemental du Doubs. On lui doit les archives du Doubs, le tribunal de Pontarlier, les prisons de Pontarlier, Montbéliard, Baume-les-Dames et Besançon.
Pateu et Robert. Entreprise de couverture en ardoises créée en 1856 par François Jean-Marie Pateu (1835-1905). Installée 45 rue d’Arènes en 1868, 9 avenue Carnot en 1899. Développée par Louis (1862-1908), le fils du fondateur, elle se spécialise dans l'entretien, la restauration et la transformation des bâtiments. Devenue Pateu Robert dès 1926, elle est transformée en 1935 en Sarl (au capital de 600 000 F), gérée par Georges François Pateu (1889-1957), fils de Louis, et Paul Robert (1874-1955), neveu du fondateur. Pateu cède en 1949 ses parts de l'entreprise (capital 6 600 000 F) à la famille Robert. Siège social transféré au 19 rue de la Mouillère en 1951 et capital est porté à 9 900 000 F en 1953. Georges François Pateu et Paul Robert prennent leur retraite en 1954 et sont remplacés par Pierre, Maurice et Michel Robert.<span style="font-weight:bold;"> </span>Capital de l’entreprise porté à 231 000 F en 1963. 1964, expropriation de la carrière qu'elle possède à la Malcombe, à Besançon. 1973, transformation de la Sarl en SA, dont 70 % du capital (231 000 F) est acquis par la société Hory, de Dijon. Devenu directeur en 1980, Daniel Saillard achète les actions d'Hory en 1985. Création de deux filiales en 1986 : ADECO (peinture, décoration, agencement) et EGS (études, gestion, services), d'une troisième en 1988 : SIREC (ravalement de façade, restructuration et aménagement). Capital porté de 332 000 F à 1 048 500 F en 1989. Installée au 21 rue des Tilleroyes en 1983, l'entreprise se transporte rue Berthelot en 1991 (elle est actuellement établie au 7 rue Albert Thomas, avec des agences à Dijon et Autun). Elle Intègre le groupe SGE (devenu VINCI) en 1994.(Source : https://www.chaprais.info/2015/04/pateu-robert-une-entreprise-prestigieuse-autrefois-aux-chaprais/ et https://www.chaprais.info/2015/04/pateu-robert-une-entreprise-des-chaprais-suite/)
Architecte à Besançon au milieu du 20e siècle.
Date de naissance : 23/03/1914
Balme, Jean Gabriel. Né en 1914. Architecte. Diplômé de l'École des Travaux publics et du Bâtiment de Paris, de l’Ecole des Beaux-Arts (entrée le 19 mars 1941, sortie le 14 juin 1946). Elève d'Alphonse Defrasse, Alfred Recoura et Jean Baptiste Mathon, André Hilt et Otello Zavaroni. Architecte à Dijon [entre 1949 et 1973] (au 26 rue du Château d’Eau en 1971), Beaune et Lamarche [en 1949]. (Source : notice de Marie-Laure Crosnier-Leconte dans Agorha : https://agorha.inha.fr/ark:/54721/f7e46863-e45c-4164-8ea1-93d54976b41c)
Description
L'établissement s'est implanté à l'ouest de la ville, sur un terrain de 7,5 ha dès l'origine coupé en deux par l'ancienne route de Gray (actuelle avenue de l'Observatoire). Le plan initial se caractérise par une composition strictement orientée. L'axe ouest-est est doublement marqué, d'abord par le pavillon de la bibliothèque qui fait face à celui de la méridienne, ensuite par le logement du directeur auquel répond la conciergerie. L'axe nord-sud était encore plus fortement apparent : une allée (récemment baptisée René Baillaud) reliait le pavillon de l'équatorial coudé, au nord, au dôme de l'équatorial droit, au sud (remplacé par les laboratoires et bureaux actuels), en passant entre les deux petits dômes symétriques de la lunette photographique et de l'altazimut (dont subsistent des vestiges). La maison du directeur, la conciergerie et le bâtiment des horloges à diapason ont des murs en moellon calcaire apparent, protégés au sud et à l'ouest par un essentage de tôle, et sont desservis par un escalier tournant à retours avec jour en bois. Comptant sous-sol, étage carré et étage en surcroît, la première présente une élévation ordonnancée en façade et est couverte d'un toit brisé en pavillon (avec tuile sur les brisis et zinc sur les terrassons). La conciergerie a le même nombre d'étages mais une couverture associant croupes et pignons couverts. Le bâtiment des horloges à diapason, à étage carré et étage en surcroît, est coiffé d'un toit à demi-croupes sur lequel a été aménagé un lanterneau métallique, mobile sur des rails afin de dégager un espace d'observation du ciel. Le bâtiment des tables vibrantes et l'ancien laboratoire d'essais, tous deux en rez-de-chaussée, font appel au parpaing de béton. Les constructions de la 2e moitié du 20e siècle sont en béton armé (associé aux briques dans le cas de la station météorologique). Les laboratoires et bureaux actuels, en rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement, sont couverts de toits à longs pans et en appentis métalliques (ayant remplacé, à la fin des années 1990, des terrasses en béton). Une terrasse, prolongée à l'est par un appentis revêtu de zinc laqué, protège la météorologie, à étage carré. Piliers et mires sont en pierre de taille.
- calcaire
- calcaire
- béton
- brique
- moellon
- pierre de taille
- parpaing de béton
- béton armé
- pan de béton armé
- enduit
- enduit
- enduit partiel
- essentage de tôle
- tuile mécanique
- béton en couverture
- zinc en couverture
- sous-sol
- 1 étage carré
- étage en surcroît
- élévation ordonnancée
- toit brisé en pavillon
- toit à longs pans, pignon couvert
- croupe
- demi-croupe
- noue
- lanterneau
- appentis
- escalier dans-oeuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente en maçonnerie
Source(s) documentaire(s)
-
F 17 3754 Observatoire de Besançon (1881-1900)
F 17 3754 Observatoire de Besançon (1881-1900)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 17 3754 -
Observatoire de Besançon. Rapport pour l’année 1881
Observatoire de Besançon. Rapport pour l’année 1881, ms, par Louis-Jules Gruey (document contenant un croquis de plan de l’observatoire en projet)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 17 3754 -
F 17 3755 Observatoire de Besançon. Comptabilité (19e siècle-20e siècle)
F 17 3755 Observatoire de Besançon. Comptabilité (19e siècle-20e siècle)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 17 3755 -
F 17 13583 Observatoires de province. Besançon (1878-1942)
F 17 13583 Observatoires de province. Besançon (1878-1942)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 17 13583 -
F 21 6418 Procès-verbaux des séances du Conseil général des Bâtiments civils (1883)
F 21 6418 Procès-verbaux des séances du Conseil général des Bâtiments civils (1883)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 21 6418 -
F 21 6507 Avis du Conseil général des Bâtiments civils (1883)
F 21 6507 Avis du Conseil général des Bâtiments civils (1883)Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 21 6507 -
66 O 21-2 Besançon. Dossier sur l’observatoire (1878-1911)
66 O 21-2 Besançon. Dossier sur l’observatoire (1878-1911)Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 66 O 21-2 -
T 624 Observatoire de Besançon (1901-1915)
T 624 Observatoire de Besançon (1901-1915)Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : T 624 -
Rapport sur l’établissement d’un observatoire astronomique, chronométrique et météorologique à Besançon, octobre 1877
Rapport sur l’établissement d’un observatoire astronomique, chronométrique et météorologique à Besançon, ms, s.n. [par Lissajous], s.d. [octobre 1877]Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : T 624 -
4 M 8 Dossier sur l’observatoire (1877-1946)
4 M 8 Dossier sur l’observatoire (1877-1946)Lieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : 4 M 8 -
Archives de l’Observatoire de Besançon (4e quart 19e siècle-1er quart 21e siècle)
Archives de l’Observatoire de Besançon (4e quart 19e siècle-1er quart 21e siècle)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Boîte n° 1 : Avants-projets (1868-1897)
Boîte n° 1 : Avants-projets (1868-1897)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 -
Boîte n° 1 (suite) : Procès Fénon (1882-1898)
Boîte n° 1 (suite) : Procès Fénon (1882-1898)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 (suite) -
Boîte n° 1 (suite) : Inventaire, livre premier (1885-1902)
Boîte n° 1 (suite) : Inventaire, livre premier (1885-1902)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 (suite) -
Boîte n° 1 (suite) : Archives diverses en ordre chronologique (1884-1896)
Boîte n° 1 (suite) : Archives diverses en ordre chronologique (1884-1896)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 (suite) -
Boîte n° 2 : Archives diverses en ordre chronologique (1898-1909)
Boîte n° 2 : Archives diverses en ordre chronologique (1898-1909)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 2 -
Boîte n° 3 : Archives diverses en ordre chronologique (1910-1923)
Boîte n° 3 : Archives diverses en ordre chronologique (1910-1923)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 3 -
Boîte n° 4 : Archives diverses en ordre chronologique (1924-1935)
Boîte n° 4 : Archives diverses en ordre chronologique (1924-1935)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 4 -
Boîte n° 5 : Archives diverses en ordre chronologique (1936-1944)
Boîte n° 5 : Archives diverses en ordre chronologique (1936-1944)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 5 -
Boîte n° 6 : Archives diverses en ordre chronologique (1945-1950)
Boîte n° 6 : Archives diverses en ordre chronologique (1945-1950)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 6 -
Boîte n° 7 : Archives diverses en ordre chronologique (1951-1953)
Boîte n° 7 : Archives diverses en ordre chronologique (1951-1953)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 7 -
Boîte n° 7 (suite) : Archives diverses en ordre chronologique (1953)
Boîte n° 7 (suite) : Archives diverses en ordre chronologique (1953)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 7 (suite) -
Boîte n° 8 : Archives diverses en ordre chronologique (1954- )
Boîte n° 8 : Archives diverses en ordre chronologique (1954- )Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 8 -
Boîte Catalogues de matériels divers (1915-1935)
Boîte Catalogues de matériels divers (1915-1935)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte Catalogues de matériels divers -
Boîte Histoire des jardins de l’observatoire (1930-1947)
Boîte Histoire des jardins de l’observatoire (1930-1947)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte Histoire des jardins de l’observatoire -
Boîtes (deux) Bâtiments (1970-1981)
Boîtes (deux) Bâtiments (1970-1981)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîtes Bâtiments -
Historique des avant-projets de l’observatoire de Besançon, vers 1882
Historique des avant-projets de l’observatoire de Besançon, ms, s.n. [par Louis-Jules Gruey], s.d. [vers 1882]Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 -
Observatoire. Organisation des services, vers 1882
Observatoire. Organisation des services, ms, s.n. [par Louis-Jules Gruey], s.d. [vers 1882]Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 -
[Notice sur l’observatoire de Besançon], vers 1882
[Notice sur l’observatoire de Besançon], ms, s.n. [par Louis-Jules Gruey], s.d. [vers 1882], 16 p. Base d’un article publié dans les Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1883, p. 311-322.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 1 -
Règlement chronométrique applicable à partir du 16 mai 1908, 1908
Règlement chronométrique applicable à partir du 16 mai 1908. XIXe bulletin chronométrique. Année 1906-1907, 1908, p. 58-70 : ill. -
Rapport d’Auguste Lebeuf au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sur "les travaux, les directives et les besoins" de l’observatoire de Besançon, 12 septembre 1923
Rapport d’Auguste Lebeuf au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sur "les travaux, les directives et les besoins" de l’observatoire de Besançon, 12 septembre 1923Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 3 -
Courriers de René Baillaud au Ministère de la Guerre, 1930-1932
Courriers de René Baillaud au Ministère de la Guerre, 1930-1932Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 4 -
Dossier de construction du bâtiment de Météo-France, incluant divers plans (1983-1984)
Dossier de construction du bâtiment de Météo-France, incluant divers plans (1983-1984)Lieu de conservation : Archives du Centre départemental Météo-France du Doubs, Besançon - Cote du document : Dossier de construction du bâtiment de Météo-France (1983-1984)
-
[Plan du terrain au Chasnot, premier emplacement retenu pour l’observatoire], vers 1879
[Plan du terrain au Chasnot, premier emplacement retenu pour l’observatoire], dessin, s.n., s.d. [vers 1879], sans échelle [1:500], 47 x 76,5 cmLieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : T 624 -
Avant projet d'un observatoire astronomique, 1879.
Avant projet d'un observatoire astronomique, dessin sur calque (plume, lavis), 25 janvier 1879- Plan, échelle 1:400, 56,2 x 35,7 cm- Façade principale, sans échelle, 34,6 x 55,6 cmLieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 66 O 21 -
[Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], 1881.
[Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], dessin sur calque (plume), s.n. [Louis-Jules Gruey ?], s.d. [1881], sans échelle. Mise au net A. CérézaPlan annexé à un rapport manuscrit de L.-J. Gruey. Existe sous une forme légèrement différente dans un exemplaire du rapport conservé aux Archives nationales : Plan général de l’observatoire [projet], dessin (plume), s.n. [Louis-Jules Gruey ?], s.d. [1881], sans échelle (AN : F 17 3754)Lieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : 4 M 8 -
Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], 1883.
Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], dessin sur calque, s.n., s.d. [1883], échelle 1:50, 49,5 x 35,9 cm.Inscription : « Calque du bilan remis à l’entrepreneur par Mr St Ginest », 21 mai 1883Lieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : Archives bâtiments -
Directeur. Coupe transversale sur les caves [et] Coupe transversale sur les terre-pleins, 4e quart 19e siècle
Directeur. Coupe transversale sur les caves [et] Coupe transversale sur les terre-pleins, dessin sur calque (plume, lavis), s.n., s.d. [4e quart 19e siècle], sans échelle, 48 x 34,3 cmLieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : Archives bâtiments -
Pavillon du directeur, 1883-1884.
Pavillon du directeur, dessin sur calque (plume, lavis), s.n., 1883-1884, échelle 1:50.- Plan des fondations, dessin sur papier, 46,5 x 65,5 cm- Plan du rez-de-chaussée, 38 x 51 cm- Plan de l’étage, 30,5 x 48 cm- Poutrage sur la tête du rez-de-chaussée, 34,5 x 49,5 cm- Poutrage sur la tête de l’étage, 35 x 49,5 cm- Coupe transversale, 37,5 x 52,5 cm- Coupe longitudinale, dessin sur papier, 63,5 x 46 cm- Façade principale, dessin (plume), 50,5 x 35 cm- Façade est, dessin sur calque (plume), 49,5 x 38 cmLieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : Archives bâtiments -
Pavillon du concierge et des aides, 1883-1884.
Pavillon du concierge et des aides, dessin sur calque (plume, lavis), s.n., 1883-1884, sans échelle- Fondations, 50 x 36 cm- Fouilles et béton, dessin sur calque (plume), 49,5 x 37,5 cm- Etage, échelle 1:50, 49 x 36 cm- Coupe transversale, 35,5 x 50,5 cm- Coupe longitudinale, 36 x 50 cm- Façade côté nord [et] Façade côté sud, dessin (plume), 71 x 45 cmLieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : Archives bâtiments -
Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, 1884.
Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, dessin (plume, crayon), 15 octobre 1884, échelle 1:1000, 38 x 50 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte 1 [a] -
Plan des terrains, 1892.
Plan des terrains, dessin imprimé, 1892, échelle 1:700, 24 x 31,5 cm. Publié dans : "Observatoire astronomique" [...] / Gruey (Louis-Jules), Besançon : Millot, 1892, p. 14. -
Plan des terrains : légende du plan, 1892.
Plan des terrains : légende du plan, texte imprimé, 1892. Publié dans : "Observatoire astronomique" [...] / Gruey (Louis-Jules), Besançon : Millot, 1892, p. 15. -
Réseau électrique, 1892
Réseau électrique, dessin imprimé, 1892, échelle 1:120, 24 x 32 cm. Publié dans : "Observatoire astronomique" [...] / Gruey (Louis-Jules). - Besançon : Millot, 1892, p. 59, pl. VIII. -
Plan général [du site avec implantation des pendules et câblage], limite 19e siècle 20e siècle
Plan général [du site avec implantation des pendules et câblage], dessin sur calque collé sur papier (plume), s.n., s.d. [limite 19e siècle 20e siècle], 32,5 x 25 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte Catalogue de matériels scientifiques divers -
Université de Besançon. Observatoire. Pavillon du Directeur. Plan du rez-de-chaussée, 1er quart 20e siècle ?
Université de Besançon. Observatoire. Pavillon du Directeur. Plan du rez-de-chaussée, dessin (tirage bleu), s.n., s.d. [1er quart 20e siècle ?], échelle 1:50, 37 x 40,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Pavillon de Mr le Directeur. Coupe longitudinale, 1er quart 20e siècle
Pavillon de Mr le Directeur. Coupe longitudinale, dessin sur calque (plume), s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], échelle 1:50Lieu de conservation : Archives municipales, Besançon - Cote du document : Archives bâtiments -
Université de Besançon. Observatoire. Pavillon du concierge et des aides. Plan des fondations, 1er quart 20e siècle ?
Université de Besançon. Observatoire. Pavillon du concierge et des aides. Plan des fondations, dessin (tirage), s.n., s.d. [1er quart 20e siècle ?], échelle 1:50, 37 x 45 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Pavillon du concierge et des aides. Plan du rez-de-chaussée, 1er quart 20e siècle.
Pavillon du concierge et des aides. Plan du rez-de-chaussée, dessin (tirage bleu), s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], échelle 1:50, 45,5 x 37,3 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Plan des terrains [plan imprimé de 1892 surchargé du projet de transformation en parc boisé], 1903.
Plan des terrains [plan imprimé de 1892 surchargé du projet de transformation en parc boisé], dessin (tirage, crayon noir) collé sur carton, s.d. [1903], échelle 1:960, 45 x 35 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Projet de transformation du terrain de l'observatoire en parc boisé], 1903.
[Projet de transformation du terrain de l’observatoire en parc boisé], dessin, s.n., s.d. [1903], échelle 1:500. Reproduit dans : Korti, Malik. Etude du parc de l’Observatoire. - Besançon, 1999.- [Plan d’ensemble], dessin sur calque (plume, crayon noir), 85 x 56 cm- [Plan de la partie nord], dessin sur calque (plume, crayon noir, crayon de couleur), 35 x 30 cm- [Plan de la partie sud-ouest], dessin sur calque (plume, crayon noir, crayon de couleur), 30 x 34 cmLieu de conservation : Ville de Besançon, Direction des Espaces verts, sportifs et forestiers -
Observatoire. Construction d'un Pavillon pour Laboratoires, 1934.
Observatoire. Construction d'un Pavillon pour Laboratoires, dessin (tirage), par le chef de bureau du service d’architecture [de la ville], 1934, échelles 1:100 et 1:50, 66 x 86 cmDonne : Plan d’ensemble, Plan, Façade principale, Façade postérieure, Façade latérale et Coupe. Existe aussi sous forme de calque, conservé aux Services techniques de la villeLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, 1940.
Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, dessin (tirage), 15 janvier 1940, échelle 1:50, 55,5 x 72,5 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Croquis de plan des bâtiments, donnant leur superficie], novembre-décembre 1953
[Croquis de plan des bâtiments, donnant leur superficie], dessin (feutre, crayon de couleur), s.n., s.d. [novembre-décembre 1953], sans échelle, 32 x 50 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 7 -
Ancien bâtiment de chronométrie. Aménagement de deux studios. Plans, Façades et coupe existants, avril 1976
Ancien bâtiment de chronométrie. Aménagement de deux studios. Plans, Façades et coupe existants, dessin sur calque (plume), par le chef de bureau d’architecture de la ville, avril 1976, échelle 1:50Lieu de conservation : Ville de Besançon, Services techniques -
Observatoire de Besançon. Plan d’ensemble et canalisations souterraines, 21 novembre 1977
Observatoire de Besançon. Plan d’ensemble et canalisations souterraines, dessin (tirage), dessiné par M.Q., le 21 novembre 1977, échelle 1:300, 67 x 116 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîtes Bâtiments -
L.M.F.T. Besançon. Bt « Z » galerie couverte. Phase 2 Permis de construire. 1 Masse situation, janvier 1980
L.M.F.T. Besançon. Bt « Z » galerie couverte. Phase 2 Permis de construire. 1 Masse situation, dessin (tirage à l’ammoniaque), par J. Balme et J.-P. Rocher, janvier 1980, échelles 1:2000 (plan de situation) et 1:200 (plan-masse), 67 x 90 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîtes Bâtiments -
Bâtiment stockage [ancien laboratoire d’essais dit des tables vibrantes]. Plan de toiture, octobre 1989
Bâtiment stockage [ancien laboratoire d’essais dit des tables vibrantes]. Plan de toiture, dessin sur calque (plume), s.n., octobre 1989, échelle 1:50Lieu de conservation : Ville de Besançon, Services techniques -
[Vue d’ensemble des pavillons, depuis le logement du directeur au sud-ouest], entre 1884 et 1888
[Vue d’ensemble des pavillons, depuis le logement du directeur au sud-ouest], photographie (négatif), s.n., s.d. [entre 1884 et 1888], plaque de verre 18 x 24 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d'ensemble du site depuis le nord-ouest (fort des Montboucons)], 1889 ?
[Vue d'ensemble du site depuis le nord-ouest (fort des Montboucons)], tirage photographique, s.n., s.d. [1889 ?], 12 x 16,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vues d’ensemble du site et des différents pavillons], 1892.
[Vues d’ensemble du site et des différents pavillons], tirages photographiques, 1892, 19,5 x 26,5 cm. Publiés dans : "Observatoire astronomique" […] / Louis-Jules Gruey. - Besançon : Millot, 1892.- Vue prise de l’est, p. 8. – Vue prise de l’ouest, p. 10.– Vue de la partie nord (prise du point v du plan), p. 18.- Vue de la partie sud (prise de la terrasse de l’équatorial coudé), p. 20.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vues des différents pavillons], fin 19e siècle.
[Vues des différents pavillons], tirages photographiques collés sur carton 40 x 50 cm, s.n., s.d. [fin 19e siècle, après 1892]. Réunis dans un volume de 13 illustrations intitulé : Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Université de Besançon. Observatoire astronomique - météorologique et chronométrique. - S.n., s.d. [fin 19e siècle].Notamment :- Pavillon de la petite méridienne [vu du sud-est].- Pavillon de l’équatorial coudé [vu de l’est].- Pavillon de la bibliothèque [vu du sud-est].- Coupoles. Altazimut, Anémoscope & Equatorial photographique [vues du nord-ouest].- Coupole de l'équatorial droit.- Parc météorologique.- Glacière.- Pavillon du directeur.- Pavillon des aides.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], limite 19e siècle 20e siècle.
[Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], photographie (négatif), s.n., s.d. [limite 19e siècle 20e siècle], plaque de verre 12 x 9 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle.
Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], dessin en couleur (plume, aquarelle), s.d. [limite 19e siècle 20e siècle], 36,5 x 24 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle.
[Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], dessin en couleur (plume, aquarelle), s.d. [limite 19e siècle 20e siècle], 9,5 x 10,5 cm.Document attaché au projet intitulé : Le temps arrête le soleil à l’heure de se coucher (profil de l’observatoire).Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle.
L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], dessin en couleur (plume, aquarelle), s.n., s.d. [limite 19e siècle 20e siècle], 36,5 x 23,5 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Colonel Laussedat (1819-1907), 20e siècle.
Colonel Laussedat (1819-1907), tirage photographique partiel d'une peinture, s.n., s.d. [20e siècle, après 1905], 22 x 24 cm. Inscriptions sur la peinture : "Ann. aet. suae LXXXVI." et "[Lausse]dat. 1905".Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], 1er quart 20e siècle.
[Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], tTirage photographique, s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], 16 x 21,5 cm. Lebeuf est, au 3e rang, la 4e personne à partir de la droite.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Coupe chronométrique], 1er quart 20e siècle.
[Coupe chronométrique], tirage photographique, sn., s.d. [1er quart 20e siècle], 23 x 17 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], 1er quart 20e siècle.
[Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], tirage photographique, s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], 12 x 18 cm.Inscription sur le cartel, sous la coupe : "Coupe de la chronométrie française / […] Concours National de [ ? …] / A la fabrique des chronomètres Lipp / 1912-1913 [1918 ?] / Ligeron horloger de la Marine dépositaire".Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Besançon. Observatoire, 1er quart 20e siècle.
Besançon. Observatoire, carte postale, s.n., s.d. [1er quart 20e siècle, entre 1906 et 1914 ?], Raffin éd. à Besançon. Porte la date 31 juillet 1914 (tampon).Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], 1er quart 20e siècle.
[Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], photographie (positif), s.n., s.d. [1er quart 20e siècle, après 1904], plaque de verre 8,5 x 10 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le sud-ouest], 1er quart 20e siècle [après 1903].
[Vue d’ensemble des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le sud-ouest], tirage photographique, s.d. [1er quart 20e siècle, après 1903], 16,5 x 23,5 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], entre 1900 et 1904.
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], dessin imprimé, s.n., s.d. [entre 1900 et 1904], 35,5 x 23,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], 1904.
[Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], tirages photographiques, s.n., fin avril 1904, 9 x 18 cm (8 x 8 cm chaque tirage).Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], 1904.
Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], dessin en couleur (aquarelle), s.n., 12 janvier 1904, 35 x 22 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905].
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905], dessin imprimé en couleur, 1905, Lith. J. Millot et Cie à Besançon, 38 x 24,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Ensemble de photographies illustrant l’expédition de Cistierna (Espagne)], 1905.
Ensemble de photographies illustrant l’expédition de Cistierna (Espagne)], positifs et négatifs, généralement s.n. et s.d. [1905], plaques de verre 4,5 x 10,5 cm et 6 x 13 cm (vues stéréoscopiques), et 8,5 x 10 cm. Certaines ont été publiées dans : "Observation de l'éclipse totale de soleil du 29-30 août 1905" [...] / Auguste Lebeuf, Paul Chofardet, s.l. : s.n., s.d. [1905]. (Tiré à part des Annales du Bureau des Longitudes, t. VIII).Notamment :- Eclipse du 30 août 1905. - Cistierna - Espagne. Membres et observateurs de la Mission, photographie, par Charles Le Morvan. Publiée : pl. 4. Identification des personnes, de gauche à droite : au 1er rang Mme Voisin, Mme Lebeuf, J. Baillaud, P. Chofardet, au 2e rang A. Lebeuf, Le Morvan, de Sailly, Berrueta, B. Baillaud, Bouty, P. Gautier, Vion, au 3e rang G. Prin, V. Puiseux, M. Hamy. - Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue prise du NW. Installation électrique, plaque de verre stéréoscopique (positif) 6 x 12,5 cm, s.n.- Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue générale des appareils prise du SW [membres de la mission de Cistierna], photographie (positif), par Jules Baillaud, août 1905, plaque de verre stéréoscopique 6 x 13 cm. Publiée : pl. 1. La légende donnée dans l’article est la suivante : "Eclipse du 30 août 1905. - Mission A. Lebeuf et P. Chofardet. Installation astronomique". Elle se complète d’une identification des personnes photographiées : de gauche à droite Mme Lebeuf, A Lebeuf, G. Prin, V. Puiseux, Berrueta, P. Chofardet, M. Hamy et P. Puiseux.- Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Installation de M Lebeuf (astronomie). Membres des missions françaises, plaque de verre stéréoscopique (positif) 6 x 12,5 cm, s.n. Auguste Lebeuf et Paul Chofardet se trouvent à gauche.- [Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Aurelio Garcia, M et Mme Leboeuf et M X posant à côté de la lunette photographique], plaque de verre (positif) 8,5 x 10 cm, s.n.- [Cistierna. Vue d’ensemble de l’installation Hamy], plaque de verre (positif) 8,5 x 10 cm, s.n. De gauche à droite : Charles Le Morvan (?), Victor Puiseux, Pierre Puiseux et Vion (?).- [Cistierna. Vue d’ensemble rapprochée de l’installation Hamy], plaque de verre (positif) 8,5 x 10 cm, s.n. - [Cistierna. Détail de l’installation Hamy], plaque de verre (positif) 8,5 x 10 cm, s.n.- Cistierna : installation Hamy : M. Baillaud fils, plaque de verre (positif) 8,5 x 10 cm, s.n. La "tente" magnétique est visible derrière Jules Baillaud.- Cistierna : installation Hamy : Pierre Hamy et Prin, plaque de verre (négatif) 12,5 x 6 cm, s.n. Pierre Hamy est à l'arrière-plan, Georges Prin au premier plan.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], 1907.
[Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], dessin imprimé, s.n., s.d. [1907]. Publié dans : "Règlement chronométrique applicable à partir du 16 mai 1908. XIXe bulletin chronométrique. Année 1906-1907", 1908, p. 62.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], 1909.
[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], tirage photographique, s.n., novembre 1909, 8,5 x 11,5 cm. De gauche à droite : Raoul Goudey (?), Auguste Lebeuf, deux personnes non identifiées, Paul Chofardet et Auguste Hérique.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], 1909 ou 1910.
[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], carte postale, s.n., s.d. [1909 ou 1910], 9 x 14 cm. Inscription au verso : "1909 ou 1910. Observatoire de Besançon. En regardant de face de droite à gauche : MM. Leboeuf directeur, Chofardet, Goudey Raoul" puis, après une personne non identifiée, Auguste Hérique.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble des pavillons, depuis le sud-est], 24 avril 1911
[Vue d’ensemble des pavillons, depuis le sud-est], photographie (négatif), s.n., 24 avril 1911, plaque de verre 13 x 18 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], 1911.
[Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], photographie (négatif), s.n., mai 1911, plaque de verre stéréoscopique 4,5 x 10,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], 1912.
[Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], photographie (négatif), s.n., 21 juin 1912, plaque de verre 12 x 12 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], 1912.
[Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], tirage photographique, s.n., 29 mai 1912, 13 x 18 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Poseurs de ligne sur un poteau électrique], 1913 ?
[Poseurs de ligne sur un poteau électrique], photographie (négatif), s.n., s.d. [1913 ?], plaque de verre 13 x 18 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], mars 1914
[Vue d’ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], tirage photographique, s.n., mars 1914, 13 x 18 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble des coupoles et du bassin, depuis le nord], mars 1914
[Vue d’ensemble des coupoles et du bassin, depuis le nord], photographie (négatif), s.n., mars 1914, plaque de verre 13 x 18 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble du pavillon de la méridienne et des coupoles, depuis le nord], mars 1914
[Vue d’ensemble du pavillon de la méridienne et des coupoles, depuis le nord], photographie (négatif), s.n., mars 1914, plaque de verre 13 x 18 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], 1916.
[Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], tirage photographique, s.d. [1916], 17 x 23 cm.Documentation et tirage photographique avec identification des personnes photographiées (dont pour l’observatoire Auguste Lebeuf devant Auguste Hérique - au centre des deux derniers rangs - et Brück - non identifié) dans les archives : Boîte n° 3 (1910-1923).Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d’ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 31 mars 1921
[Vue d’ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], photographie (négatif), 31 mars 1921, plaque de verre 13 x 18 cmLieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 6 avril 1922.
[Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], tirage photographique, s.n., 6 avril 1922, 13 x 18 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Observatoire national de Besançon. Service chronométrique. Résultats généraux du 5 août 1885 au 30 avril 1922.
Observatoire national de Besançon. Service chronométrique. Résultats généraux du 5 août 1885 au 30 avril 1922, affiche collée sur carton, s.d. [1922], Impr. Millot Frères à Besançon, 63 x 46,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Observatoire national de Besançon. Une page du livre d'or de l'horlogerie bisontine. Mémento des plus hautes récompenses des concours annuels, 1922.
Observatoire national de Besançon. Une page du livre d'or de l'horlogerie bisontine. Mémento des plus hautes récompenses des concours annuels, affiche collée sur carton, s.d. [1922], Impr. Millot Frères à Besançon, 63 x 46,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
La lune à Besançon le 10 novembre 1924.
La lune à Besançon le 10 novembre, tirage photographique imprimé, 10 novembre 1924, 9 x 13 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Observatoire météorologique, 1926.
Observatoire météorologique, photographie (négatif), s.n., septembre 1926, plaque de verre stéréoscopique 4,5 x 10,5 cm.On aperçoit au centre, à côté de l’enclos météorologique, l’héliographe Campbell.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
A. Lebeuf (1859-1929), octobre 1927.
A. Lebeuf (1859-1929), photographie (positif), octobre 1927, plaque de verre 12 x 12 cm. Publiée dans : Baillaud, René. A. Lebeuf [notice nécrologique]. Bulletin astronomique. 2e série. Mémoires et variétés, t. 6, 1930, photogr. h.t.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Pavillon de la méridienne et parc météorologique, 1928.
Pavillon de la méridienne et parc météorologique, photographie (négatif), novembre 1928, plaque de verre 13 x 18 cm. Publiée dans : "Franche-Comté, Monts-Jura, Haute-Alsace", décembre 1928, n° 113, p. 198.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé].
Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé], carte postale, s.n., s.d. [vers 1932]Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Certificat de réglage d'une montre], décennie 1940.
[Certificat de réglage d'une montre], dessin imprimé, s.d. [décennie 1940], 13,5 x 21 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], 1948.
Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], tirage photographique, s.n., 1948, 13 x 18 cm. Texte au verso : "Service chronométrique (1948) - de gauche à droite : 4. Mlle Jacqueline Chevillard -> Mme Racine1. Jeannette Faivre ->2. Germaine Gazon -> Mme Prétet3. Henriette Chaignet -> Mme Bernardot5. Ginette Duchanoy -> Mme Bontemps6. Jacqueline Schevènement (Rivotte) -> Mme Bourgeat (Pirey) (Yéma)Tout le monde a été licencié en 1948 sauf les 3 soulignées, tirées au sort."Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], 1ère moitié 20e siècle.
Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], photographie (positif), s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle], plaque de verre 8,5 x 10 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], 1ère moitié 20e siècle.
[Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], photographie (négatif), s.d. [1ère moitié 20e siècle], plaque de verre 13 x 18. Photographie d’un dessin signé M.H.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], 1ère moitié 20e siècle.
[Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], dessin imprimé en couleur, s.d. [1ère moitié 20e siècle, après 1907], Lith. J. Millot et Cie à Besançon, 50,5 x 65 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Diplôme de régleur], 1ère moitié 20e siècle.
[Diplôme de régleur], dessin imprimé en couleur, s.d. [1ère moitié 20e siècle], 50,5 x 65 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle.
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], dessin imprimé en couleur, s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle, après 1904], 35,5 x 24 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle.
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], dessin imprimé en couleur, s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle], 35,5 x 24 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle.
[Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], dessin imprimé en couleur, s.d. [1ère moitié 20e siècle], 38 x 25 cm. Ce bulletin a été utilisé pour des comparaisons du 13 novembre au 19 décembre 1956.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle.
[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], dessin imprimé en couleur, s.d. [1ère moitié 20e siècle, après 1904], 35,5 x 24 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, milieu 20e siècle.
[Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, tirage photographique, s.d. [milieu 20e siècle, après 1933], 16,5 x 25 cm.Tampon au verso : "Copyright by / Universal Press Agency / 85-87 avenue des Champs-Elysées 8e / Mention obligatoire / Universal - Photo".Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 2e moitié 20e siècle.
[Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], dessin imprimé en couleur, s.n., s.d. [2e moitié 20e siècle], 27 x 21 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], années 1960.
[Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], tirage photographique, s.d. [années 1960], 12 x 18 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Le personnel de l’observatoire], octobre 1964.
[Le personnel de l’observatoire], photographie, s.n., octobre 1964, tirage 18 x 24 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Le personnel de la chronométrie], octobre 1964.
[Le personnel de la chronométrie], photographie, octobre 1964, tirage 13 x 18 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
[Bulletin de marche d'une montre-bracelet], décennie 2000.
[Bulletin de marche d'une montre-bracelet], dessin imprimé en couleur, s.n., s.d. [décennie 2000], 30 x 22 cm. Reprise d'un modèle de la 1ère moitié du 20e siècle.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon
-
1er Congrès National de l’Horlogerie, Besançon - Juillet 1933, 15 juillet 1933
1er Congrès National de l’Horlogerie, Besançon - Juillet 1933. La France horlogère, 32e année, n° 14, 15 juillet 1933, p. 4-38. -
A l’Observatoire [visite du président de la République, Albert Lebrun], 15 juillet 1933
A l’Observatoire [visite du président de la République, Albert Lebrun]. La France horlogère, 32e année, n° 14, 15 juillet 1933, p. 28-29 : ill. -
[Aménagement d’une nouvelle salle de chronométrie dans le pavillon de la méridienne et matériel mis en place], 1906
[Aménagement d’une nouvelle salle de chronométrie dans le pavillon de la méridienne et matériel mis en place]. XVIIe bulletin chronométrique. Année 1904-1905, 1906, p. 16-19 : 1 pl. h.t. -
Antoine, E. Rapport de la commission nommée par la Chambre syndicale des Fabricants d’Horlogerie pour l’étude du règlement relatif aux chronomètres qui doivent subir les épreuves de l’Observatoire, 1908
Antoine, E. Rapport de la commission nommée par la Chambre syndicale des Fabricants d’Horlogerie pour l’étude du règlement relatif aux chronomètres qui doivent subir les épreuves de l’Observatoire. XIXe Bulletin chronométrique. Année 1906-1907, 1908, p. 88-94.Texte suivi du règlement de 1885, p. 95-99. -
Arbey, Louis. Rapport d’activités de l’Observatoire de Besançon (année 1965), 1966
Arbey, Louis. Rapport d’activités de l’Observatoire de Besançon (année 1965). Annales de l’Observatoire de Besançon, t. VII, fasc. III, 1966, p. 73-79. -
Baillaud, René. A. Lebeuf [notice nécrologique], 1930
Baillaud, René. A. Lebeuf [notice nécrologique]. Bulletin astronomique. 2e série. Mémoires et variétés, t. 6, 1930, p. 193-199 : 1 photogr. h.t. -
Baillaud, René. L’observatoire national de Besançon et l’Industrie horlogère française, 1er-15 septembre 1930
Baillaud, René. L’observatoire national de Besançon et l’Industrie horlogère française. Le Fabricant français d’horlogerie, 12e année, n° 17-18, 1er-15 septembre 1930, p. 267-271.Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : Per 303 -
Baillaud, René. [Discours à l’occasion de la] Célébration du cinquantenaire de l’Observatoire, 15 juillet 1933
Baillaud, René. [Discours à l’occasion de la] Célébration du cinquantenaire de l’Observatoire. La France horlogère, 32e année, n° 14, 15 juillet 1933, p. 34-35. -
[Baillaud, René]. Radioreportage à l’observatoire de Besançon, 1935
[Baillaud, René]. Radioreportage à l’observatoire de Besançon. - 1935. 13 p. dactyl. Texte préparatoire à un reportage de Radio Strasbourg, prévu le vendredi 5 avril 1935.(Arch. Obs., Besançon : boîte n° 4 1924-1935)Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 4 -
[Baillaud, René]. Brève notice sur l’observatoire de Besançon, 1938
[Baillaud, René]. Brève notice sur l’observatoire de Besançon. - 1938. 5 p. dactyl.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 5 -
Baillaud, René. L’observatoire de Besançon et la chronométrie française, 1943
Baillaud, René. L’observatoire de Besançon et la chronométrie française. In : 1793-1943 Cent cinquantenaire de la Fabrique d’horlogerie de Besançon. - Besançon : Syndicat de la Fabrique d’Horlogerie de Besançon, 1943, p. 9-12 : ill. -
Baillaud, René. Rapport sur l’activité de l’observatoire de Besançon au cours de l’année 1945-1946, 1946
Baillaud, René. Rapport sur l’activité de l’observatoire de Besançon au cours de l’année 1945-1946. - 1946. 4 p. dactyl. -
Baillaud, René. Ce qu’est l’observatoire chronométrique de Besançon, 21 janvier 1948
Baillaud, René. Ce qu’est l’observatoire chronométrique de Besançon. - 21 janvier 1948. 4 p. dactyl. Article destiné à être publié dans la revue Atomes.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte Bibliothèque -
[Baillaud, René]. Assainissement sur l’emploi du mot chronomètre, 1953
[Baillaud, René]. Assainissement sur l’emploi du mot chronomètre. - 1953. 5 p. dactyl. annotées. Communication présentée à la Fédération des horlogers détaillants le 12 octobre 1953.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon - Cote du document : Boîte n° 7 -
Baillaud, René. Baillaud, famille d’astronomes, 1967
Baillaud, René. Baillaud, famille d’astronomes. - Besançon : l’auteur, 1967. 105 p. multigr. ; 27 cm. -
Blot-Garnier, Paul. Distribution électrique de l’heure, 1906
Blot-Garnier, Paul. Distribution électrique de l’heure. XVIIe bulletin chronométrique. Année 1904-1905, 1906, p. 63-66. -
Bonfils, Thomas. Les conditions de la création d’un observatoire à Besançon, 2000
Bonfils, Thomas. Les conditions de la création d’un observatoire à Besançon. - 2000. Mémoire de l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard -
Boyer, Jacques. Les rouages d'une montre moderne, juillet 1910
Boyer, Jacques. Les rouages d'une montre moderne. Le Mois littéraire et pittoresque, n° 139, juillet 1910, p. 86-100 : ill. -
Burgey, Edith. Restauration du cadran solaire analemmatique de l’Observatoire de Besançon, 2004
Burgey, Edith. Restauration du cadran solaire analemmatique de l’Observatoire de Besançon. - Besançon : Observatoire des Sciences et de l’Univers, 2004. 4 p. : ill. ; 30 cm. Plaquette réalisée pour l’inauguration du cadran restauré, le 22 septembre 2004. -
Burgey, Edith ; Vernotte, François. Balade dans le parc de l’observatoire de Besançon, avril 2004
Burgey, Edith ; Vernotte, François. Balade dans le parc de l’observatoire de Besançon. En Direct, n° 183, avril 2004, p. 1-4 : ill. N° spécial de la revue de l’Université de Franche-Comté. -
Cent cinquantenaire de la fabrique d'horlogerie de Besançon, 1943
Cent cinquantenaire de la fabrique d'horlogerie de Besançon. - S.l. [Besançon] : impr. Millot Frères, 1943, 40 p. [Plaquette souvenir éditée par le syndicat de la fabrique d'horlogerie de Besançon à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la fondation de la fabrique d'horlogerie de Besançon]. -
Couturier, Pierre. En souvenir : Jean Delhaye, 12 avril 2001
Couturier, Pierre. En souvenir : Jean Delhaye. Bulletin intérieur de l’Observatoire de Paris, n° 1331, jeudi 12 avril 2001, p. 88-89. -
Davoigneau, Jean ; Le Guet Tully, Françoise ; Poupard, Laurent ; Vernotte, François. L’Observatoire de Besançon : les étoiles au service du temps, 2009
Davoigneau, Jean ; Le Guet Tully, Françoise ; Poupard, Laurent ; Vernotte, François. L’Observatoire de Besançon : les étoiles au service du temps / photogr. Jérôme Mongreville avec la collab. d’Yves Sancey ; cartogr. André Céréza. - Lyon : Lieux Dits, 2009. 80 p. : ill. ; 22 cm. (Parcours du patrimoine ; 349) -
De la direction de l’Observatoire, 14 février 1879
De la direction de l’Observatoire. La Démocratie franc-comtoise, 7e année, n° 39, vendredi 14 février 1879, p. 3. -
Goudey, Raoul. Station sismique de l’observatoire de Besançon, 1914
Goudey, Raoul. Station sismique de l’observatoire de Besançon. XXVIIe bulletin météorologique. Année 1911, 1914, [21 p.] : ill. Extrait de l’Annuaire de la Société météorologique de France, janvier 1912. -
Goudey, Raoul. L’enregistrement des signaux horaires à l’observatoire de Besançon, 1925
Goudey, Raoul. L’enregistrement des signaux horaires à l’observatoire de Besançon. - Besançon : Impr. Millot Frères, 1925. 34 p. : ill., 1 pl. h.t. ; 24,5 cm. -
Goudey, Raoul. L’Observatoire de Besançon, décembre 1928
Goudey, Raoul. L’Observatoire de Besançon. Franche-Comté, Monts-Jura, Haute-Alsace, n° 113, décembre 1928, p. 196-200 : ill. Numéro spécial sur l’horlogerie en Franche-Comté. -
Gruey, Louis-Jules. Notice historique sur l’observatoire de Besançon, 1883
Gruey, Louis-Jules. Notice historique sur l’observatoire de Besançon. Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1883, p. 311-322. Article préparé à partir d’une notice manuscrite de 16 p., non datée ni signée (Arch. Obs., Besançon : boîte n° 1 1868-1897). -
Gruey, Louis-Jules. Visite à divers observatoires étrangers, 1883
Gruey, Louis-Jules. Visite à divers observatoires étrangers. Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1883, p. 39-88. -
[Gruey, Louis-Jules]. Création de l’Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon, 1886
[Gruey, Louis-Jules]. Création de l’Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon. - Besançon : Impr. Dodivers, 1886. 3 p. Tiré à part paginé 43-45.Lieu de conservation : Archives nationales, Paris - Cote du document : F 17 13583 -
[Gruey, Louis-Jules]. Notice sur l’observatoire de Besançon, 1889
[Gruey, Louis-Jules]. Notice sur l’observatoire de Besançon. 1er bulletin chronométrique, 1889, p. 3-6.Notice préparée à partir d’un texte manuscrit de 25 p., non daté ni signé (Arch. Obs., Besançon : boîte n° 1 1868-1897). -
Gruey, Louis-Jules. Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon, 1892
Gruey, Louis-Jules. Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon. Description des terrains, pavillons, instruments et services. - Besançon : Impr. Millot Frères et Cie, 1892. 65 p. : ill. ; 32,5 cm.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Korti, Malik. Etude du parc de l’Observatoire, 1999
Korti, Malik. Etude du parc de l’Observatoire. - Besançon, 1999. Mém. maîtrise : Biologie des Populations et Ecosystèmes : Besançon : 1999.Lieu de conservation : Ville de Besançon, Services techniques -
Laurent, Pierre. A la bonne heure ! L’observatoire de Besançon a inauguré hier son cadran solaire analemmatique, 23 septembre 2004
Laurent, Pierre. A la bonne heure ! L’observatoire de Besançon a inauguré hier son cadran solaire analemmatique. Une pièce rarissime, au principe ingénieux, qui vient tout juste d’être restaurée. L’Est républicain, édition du Doubs, 23 septembre 2004, ill. -
Laussedat, Aimé. Etude sur le développement de l’horlogerie dans le département du Doubs et en Suisse. Ecole d’Horlogerie de Besançon. Observatoire de Neufchâtel, 1868
Laussedat, Aimé. Etude sur le développement de l’horlogerie dans le département du Doubs et en Suisse. Ecole d’Horlogerie de Besançon. Observatoire de Neufchâtel. - Paris : Libr. polytechnique de J. Baudry, s.d. [1868]. 44 p. Extrait des Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, 1ère série, t. 8, 1867-1868, p. 334-377. -
[Lebeuf, Auguste]. Concours national de réglage de 1905, 1904
[Lebeuf, Auguste]. Concours national de réglage de 1905. XVe Bulletin chronométrique. Année 1902-1903, 1904, p. 39-50. Donne un bref historique de la chronométrie française. -
[Lebeuf, Auguste]. Notice sur la vie et les travaux de M. L.-J. Gruey, 1904
[Lebeuf, Auguste]. Notice sur la vie et les travaux de M. L.-J. Gruey. XVe Bulletin chronométrique. Année 1902-1903, 1904, p. 7-13 : 1 photogr. h.t. -
[Lebeuf, Auguste]. [Présentation des activités de l’observatoire, notamment des services de la transmission de l’heure et de désaimantation des chronomètres de poche], 1904
[Lebeuf, Auguste]. [Présentation des activités de l’observatoire, notamment des services de la transmission de l’heure et de désaimantation des chronomètres de poche]. XVe Bulletin chronométrique. Année 1902-1903, 1904, p. 37-39. -
Lebeuf, Auguste ; Chofardet, Paul. Observation de l’éclipse totale de soleil du 29-30 août 1905, 1905
Lebeuf, Auguste ; Chofardet, Paul. Observation de l’éclipse totale de soleil du 29-30 août 1905. Rapport des membres de la mission de l’observatoire de Besançon MM. A. Lebeuf et P. Chofardet. - S.l. : s.n., s.d. [1905]. 47 p. : ill., 4 pl. h.t. [sur 2 feuilles] ; 28 cm. Tiré à part des Annales du Bureau des Longitudes, t. VIII. -
Lebeuf, Auguste. La chronométrie pratique en France. L’horlogerie française en 1823 et 1923, 1924
Lebeuf, Auguste. La chronométrie pratique en France. L’horlogerie française en 1823 et 1923.- Besançon : Université de Besançon, 1924. 45 p. ; 24 cm.Ouvrage réunissant deux articles de Lebeuf : "Sur l’évolution, le développement et les bases de la chronométrie française. Dépôt de la marine et observatoire de Besançon" et "Sur l’horlogerie en 1823 et 1923. Sur la rénovation de l’art horloger de Bréguet et de ses contemporains". -
Lebeuf, Auguste. Observatoire de Besançon, 1923
Lebeuf, Auguste. Observatoire de Besançon. In : Le Département du Doubs.- [Paris] : [Impr. spéciale de l’Illustration Economique et Financière], 1923, p. 49 : ill. Supplément au numéro de l’Illustration économique et financière du 4 août 1923 (numéro spécial consacré au Doubs). Article préparé à partir d’une notice manuscrite de 2 p., non datée ni signée (Arch. Obs., Besançon : boîte n° 3 1923-1924). -
Le Guet Tully, Françoise ; Davoigneau, Jean. Les instruments pour la mesure du temps de l’observatoire de Besançon, avril 2004
Le Guet Tully, Françoise ; Davoigneau, Jean. Les instruments pour la mesure du temps de l’observatoire de Besançon. - Avril 2004. 11 p. dactyl. Communication présentée lors du 129e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques "Le Temps", 19-24 avril 2004, Besançon. A paraître aux Editions du CTHS. -
Leroy, Louis. L’heure, vers 1915
Leroy, Louis. L’heure. - Paris : L. Leroy et Cie, s.d. [vers 1915]. 26 p. : ill. ; 24 cm. -
Loewy, Maurice. Observatoires astronomiques de province. Année 1879. Rapport général, 1880
Loewy, Maurice. Observatoires astronomiques de province. Année 1879. Rapport général. - Paris : Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 1880. 16 p. Existe aussi sous forme de tiré à part (AC, Besançon : 4 M 8). -
Loewy, Maurice. Rapport adressé par le Comité consultatif des Observatoires astronomiques de Province à M. le Ministre de l’Instruction publique. Année 1880, 1881
Loewy, Maurice. Rapport adressé par le Comité consultatif des Observatoires astronomiques de Province à M. le Ministre de l’Instruction publique. Année 1880. - Paris : Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 1881. 21 p. -
Maître, Victor. Louis Arbey (1908-1972) [notice nécrologique], octobre-novembre 1972
Maître, Victor. Louis Arbey (1908-1972) [notice nécrologique]. L’Astronomie, 86e année, octobre-novembre 1972, p. 478-479 : 1 photogr. -
Mamet, Joël. Un cadran solaire à sauvegarder, 18 juillet 2003
Mamet, Joël. Un cadran solaire à sauvegarder. L’Est républicain, édition du Doubs, vendredi 18 juillet 2003. -
Martin, Louis. Etude sur les transformations de l'industrie horlogère dans le département du Doubs et particulièrement à Besançon depuis 1850, 1900
Martin, Louis. Etude sur les transformations de l'industrie horlogère dans le département du Doubs et particulièrement à Besançon depuis 1850. - Besançon : Impr. du Progrès, 1900. 62 p. : ill. ; 24 cm.Lieu de conservation : Bibliothèque municipale, Besançon - Cote du document : 269 922 -
Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Rapports sur les observatoires astronomiques de province, 1879-1933
Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Rapports sur les observatoires astronomiques de province, 1879-1933. (Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supérieur)A partir de 1926, le titre complet est : Rapports sur les observatoires astronomiques de province et les observatoires et instituts de physique du globe. -
Observatoire de Besançon. Bulletin astronomique, 1886-1896
Observatoire de Besançon. Bulletin astronomique. - Besançon, 1886-1896. Devient ensuite : Annales de l’Observatoire de Besançon. Astronomie et géophysique (1934-1971). -
Observatoire de Besançon. Bulletin chronométrique, 1889-1925
Observatoire de Besançon. Bulletin chronométrique. - Besançon, 1889-1925. Devient ensuite : - Annales françaises de chronométrie. - Besançon : Observatoire national de Besançon, 1931-1965. Trimestriel. De 1931 (t. 1) à 1946 (t. 16) puis de 1947 (2e série, t. 1) à 1965 (2e série, t. 19)- Annales françaises de chronométrie et de micromécanique. - Besançon : Observatoire de Besançon, 1966-1977. Annuel puis trimestriel à compter de 1975. De 1966 (t. 1) à 1974 (t. 9), puis de 1975 (45e année, 4e série, t. 29) à 1977 (47e année, 4e série, t. 31)- Annales françaises de chronométrie et de microtechnique. - Besançon : Société française de Chronométrie et de Microtechnique, 1978-1981. Trimestriel. De 1978 (48e année, 4e série, t. 32) à 1981 (51e année, 4e série, t. 35)- Annales françaises des microtechniques et de chronométrie. - Besançon : Centre technique de l’Industrie horlogère, 1982-... Trimestriel. De 1982 (52e année, 4e série, t. 36) à... -
Observatoire de Besançon. Bulletin météorologique, 1890-1951
Observatoire de Besançon. Bulletin météorologique. - Besançon, 1890-1951.Devient ensuite : Annales scientifiques de l’Université de Besançon. Climatologie (1952-1954), Climatologie comtoise et jurassienne (1955-1958) puis Annales scientifiques de l’Université de Besançon. Climatologie (1962) -
Puel, François. Instruments d’astronomie de l’Observatoire de Besançon, 19 avril 2002
Puel, François. Instruments d’astronomie de l’Observatoire de Besançon. - 19 avril 2002. 12 p. dactyl.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Puel, François. [Notice sur le personnel de l’Observatoire de Besançon], 2002
Puel, François. [Notice sur le personnel de l’Observatoire de Besançon]. - S.d. [2002]. 11 p. dactyl.Notice composée de :- Les directeurs successifs de l’Observatoire de Besançon, p. 1 ;- De longues carrières d’assistants à l’Observatoire de Besançon pour les anciens élèves de l’école d’horlogerie, p. 2-3 ;- Personnel scientifique de l’Observatoire de Besançon de 1881 à 1902, p. 4-6 ;- Personnel de l’Observatoire de Besançon de 1903 à 1929, p. 7-10 ;- Personnel de l’Observatoire de Besançon de 1930 à 1933, p. 11.Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon -
Puel, François. L’instrument méridien de l’Observatoire de Besançon, mars-avril 2005
Puel, François. L’instrument méridien de l’Observatoire de Besançon. L’Astronomie, vol. 119, mars-avril 2005, p. 186-190 : ill. -
Poupard, Laurent. L’observatoire de Besançon, novembre-décembre 2002
Poupard, Laurent. L’observatoire de Besançon. La lettre de l’OCIM, n° 84, novembre-décembre 2002, p. 20-21 : ill. -
Quartier-La-Tente, Edouard (père). L’Observatoire cantonal neuchâtelois, 1858-1912 : souvenir de son cinquantenaire et de l’inauguration du Pavillon Hirsch, 1912
Quartier-La-Tente, Edouard (père). L’Observatoire cantonal neuchâtelois, 1858-1912 : souvenir de son cinquantenaire et de l’inauguration du Pavillon Hirsch. - Neuchâtel : Département de l’Instruction publique, 1912. 144 p. : ill. ; 22 cm. -
Salis-Aguillaume, Cécile de. Biographies, 2004
Salis-Aguillaume, Cécile de. Biographies. - 2004. 70 p. dactyl. Version du 4 septembre 2004 d’un document en cours de rédaction. -
Suagher, Françoise. Cadrans solaires originaux en Franche-Comté, avril 2004
Suagher, Françoise. Cadrans solaires originaux en Franche-Comté. - Avril 2004.Communication présentée lors du 129e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques "Le Temps", 19-24 avril 2004, Besançon. A paraître aux Editions du CTHS. -
Université de Besançon. Rapports sur la situation et les travaux des établissements d’enseignement supérieur de Besançon, 1947-1948
Université de Besançon. Rapports sur la situation et les travaux des établissements d’enseignement supérieur de Besançon, 1947-1948. -
Vernotte, François. La mesure du temps à l’Observatoire de Besançon : évolutions et tendances, avril 2004
Vernotte, François. La mesure du temps à l’Observatoire de Besançon : évolutions et tendances. - Avril 2004.Communication présentée lors du 129e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques "Le Temps", 19-24 avril 2004, Besançon. A paraître aux Editions du CTHS. -
Vernotte, François ; Poupard, Laurent. L'observatoire de Besançon et la mesure du temps, juin 2016
Vernotte, François ; Poupard, Laurent. L'observatoire de Besançon et la mesure du temps. Horlogerie ancienne, n° 79, juin 2016, p. 17-36 : ill.
-
Puel François (témoignage oral)
Puel François, astronome à l'observatoire de Besançon. -
Vermot-Desroches Bruno (témoignage oral)
Vermot-Desroches Bruno, directeur du Centre départemental Météo-France du Doubs, à Besançon -
Vernotte François (témoignage oral)
Vernotte François, directeur de l'observatoire de Besançon de mars 2002 à septembre 2012. -
Vincent Michel (témoignage oral)
Vincent Michel, membre du personnel de l'observatoire de Besançon.
À voir
Informations complémentaires
Boyer, Jacques. Les rouages d'une montre moderne. Le Mois littéraire et pittoresque, n° 139, juillet 1910, p. 86-100 : ill.
Liste établie par François Puel en 2002
1879-1881 Jean-François Saint-Loup (1831-1913). Démissionne en 1881.
1881-1902 Louis-Jules Gruey (1837-1902)
1903-1928 Auguste Lebeuf (1859-1929)
1929-1930 Paul-Albert Sallet (1869-19..). Assure l’intérim.
1930-1957 René Baillaud (1885-1977)
1957-1964 Jean Delhaye (1921-2001)
1964-1972 Louis Arbey (1908-1972)
1972 Victor Maître (1906-1975). Assure l’intérim.
1972-1977 Avram Hayli
1977-1982 Michel Crézé
1982-1985 Claude Chevallier
1985-1988 Michel Festou
1988-1998 Sonia Clairemidi
1998-2002 Philippe Tuckey
2002 Jean-Marc Petit. Assure l’intérim
2002-… François Vernotte
Arbey, Louis (1908-1972) : Après une formation initiale dans la marine marchande, L. Arbey enseigne les mathématiques dans un collège d’Alger. Entré à l’Institut de Météorologie et de Physique du Globe de l’Algérie, il devient ensuite aide-astronome à l’observatoire d’Alger avant de rejoindre celui de Paris (au service de l’Heure) puis de revenir, comme directeur, à Alger de 1962 à 1964. Nommé directeur de l’observatoire de Besançon de 1964 à 1972, il y fait développer des compétences en métrologie astronomique (automatisation des instruments d’observation), renforce le service de l’Heure et fait venir une équipe chargée d’étudier la haute atmosphère.
Baillaud, René (1885-1977) : Fils de Benjamin Baillaud (directeur de l’observatoire de Toulouse puis de celui de Paris), René Baillaud travaille de 1910 à 1925 à l’observatoire de Nice, où il invente un instrument impersonnel des hauteurs égales. Affecté à l’observatoire de Marseille de 1925 à 1930, il est, de 1930 à 1937, directeur de l’observatoire de Besançon, où il développe les activités chronométriques.
Bérard, Édouard (1843-1912) : A l’Ecole des beaux-arts, Bérard est l’élève de Lacroix, Lisch et Viollet-le-Duc. Architecte de la ville de Besançon de 1878 à 1883, il y est nommé architecte diocésain le 26 juin 1882. Architecte en chef des monuments historiques.
Chofardet, Paul (1871-1958) : Recruté en 1890 comme assistant au service chronométrique de l’observatoire de Besançon, il prend part au service méridien et surtout au service des équatoriaux. Il est l’auteur de très nombreuses observations de petites planètes à l’équatorial coudé et donne son nom à une comète qu’il découvre en 1898. Aide-astronome en 1919, astronome adjoint en 1930, il part à la retraite en 1936.
Delhaye, Jean (1921-2001) : Entré comme assistant à l’observatoire de Paris en octobre 1943, J. Delhaye est nommé directeur de l’observatoire de Besançon de juin 1957 à octobre 1964, date de son retour dans le premier établissement, dont il est le directeur de février 1968 au 1er mars 1971. Il est ensuite, jusqu’au 31 octobre 1979, directeur de l’Institut national d’Astronomie et de Géophysique. Il fut l’un des artisans du renouveau de l’astrométrie et de la statistique stellaire en France. Correspondant de l’Académie des Sciences en 1964, président du Bureau des Longitudes en 1978-1979 et en 1991-1992, de la Société française d’Astronomie et d’Astrophysique en 1984.
Faye, Hervé (1814-1902) : Elève astronome à l’observatoire de Paris en 1836, Faye y est nommé astronome en 1843, date à laquelle il découvre la comète qui porte son nom. Membre de l’Académie des sciences à partir de 1847, il en devient le président en 1872. Il enseigne à l’Ecole polytechnique de 1852 à 1854 puis de 1873 à 1893. Membre du Bureau des longitudes en 1862, il est également inspecteur général de l’Enseignement de 1857 à 1887, et ministre de l’Instruction publique en 1877.
Fénon, Auguste (1843-1913) : Apprenti dans l’atelier d’horlogerie de son père, Auguste Fénon travaille ensuite chez Winnerl, horloger attitré de l’observatoire de Paris, pour lequel il met au point un taximètre enregistreur et fabrique des horloges de précision et des chronomètres de marine. Il remporte en 1878 un concours de la ville de Paris pour la fourniture d’une pendule électrique de précision destinée à synchroniser 20 autres pendules, à installer dans chacun des arrondissements. Successeur de Winnerl, il fournit un certain nombre de pendules astronomiques aux observatoires français, notamment une pendule directrice à interrupteur électrique pour celui de Marseille qui lui vaut des commandes similaires des établissements de Besançon (avec lequel il sera, d’ailleurs, en procès) et de La Plata (Argentine). Grand prix de la classe d’Horlogerie à l’exposition de Paris en 1889, il est directeur de l’école d’horlogerie de Besançon de 1892 à 1912 et membre du Bureau des longitudes en 1897.
Ferrié, Gustave (1868-1932) : Polytechnicien, capitaine du Génie, il suit les premières expériences de télégraphie sans fil transmanche réalisées par Marconi en 1899 entre Douvres et Boulogne. De 1903 à 1908, il met en place le réseau de TSF de l’armée française et organise l’émission de signaux horaires depuis la tour Eiffel, émission régulière à partir du 23 mai 1910 (ce qui vaut à la France de devenir le siège du Bureau international de l’Heure). Nommé général à l’issue de la première guerre mondiale, il cherche à faire profiter la science des progrès réalisés en matière de TSF et milite pour la mise en place, dans les observatoires français mais aussi étrangers, de dispositifs d’enregistrement de l’heure diffusée par les ondes. Elu membre de l’Académie des Sciences en 1922, il fut aussi président de la Société de Chronométrie.
Féry, Charles (1865-1935) : Major en 1885 de la première promotion de l’Ecole de Physique et Chimie de la ville de Paris, il y est nommé professeur d’optique en 1902. Il est l’inventeur de plusieurs appareils : un spectrographe, un spectrophotomètre, un actinomètre, un réfractomètre, un pyromètre optique (« lunette de Féry »)… Dans le domaine de l’horlogerie, il imagine en 1900-1901 une horloge électrique à pendule libre, construite ensuite à des milliers d’exemplaires par la société Brillié. Il travaille aussi sur les sources d’énergie et met au point une pile à dépolarisation par l’air ainsi que divers petits accumulateurs à longue durée.
Gruey, Louis-Jules (1837-1902) : L.-J. Gruey est professeur de mathématique au lycée de Nevers de 1862 à 1865, date de son entrée à l’observatoire de Paris comme astronome adjoint. Il redevient professeur des lycées en 1869, avant d’enseigner en faculté à partir de 1874. De 1881 à sa mort, en 1902, il est titulaire de la chaire d’astronomie et directeur de l’observatoire de Besançon. Auteur d’une Théorie élémentaire des Gyroscopes, il est l’inventeur du stréphoscope universel ; il publie aussi en 1885 un Cours d’astronomie, rapidement réputé, suivi en 1889 d’Exercices d’astronomie.
Hérique, Auguste (1865-1924) : Recruté en 1884 par l’observatoire de Besançon comme aide-chronométrier, il devient aide-astronome en 1906 puis astronome adjoint en 1922. Il consacre sa vie professionnelle au service chronométrique (instrumentation, détermination et distribution de l’heure, contrôle des montres, concours) ainsi qu’à la surveillance et l’entretien des instruments. Il réalise en 1897-1898 une machine à poinçonner pour apposer sur les chronomètres le poinçon de l’observatoire (une tête de vipère).
Hirsch, Adolphe (1830-1901) : Astronome, Adolphe Hirsch fonde l’observatoire de Neuchâtel, qu’il dirige de 1858 à 1901. Géodésien, professeur de géophysique et d’astronomie à l’Académie de Neuchâtel, il participe dès 1864 à l’établissement du premier nivellement de précision suisse. Il est aussi fortement impliqué dans la collaboration scientifique internationale : secrétaire de l’Association géodésique internationale, membre du Bureau international des poids et mesures (où il préconise l’adoption du mètre et du kilogramme comme étalons de mesure internationaux), il contribue à l’unification des longitudes et à l’introduction de l’heure universelle.
Laussedat, Aimé (1819-1907) : Inventeur de la photogrammétrie en 1849-1850, cet officier du Génie met au point la première utilisation cartographique de la photographie (1862-1864) et conçoit divers instruments d’optique. Professeur d’astronomie et de géodésie à Polytechnique à partir de 1853, il est nommé professeur de géométrie appliquée aux arts à l’École des arts et métiers en 1873. Directeur des études à l’École polytechnique (1879-1881) et du Conservatoire des arts et métiers (1881-1900), il devient membre de l’Académie des sciences le 21 mai 1894. Membre du Bureau des longitudes.
Lebeuf, Auguste (1859-1929) : Professeur de mathématiques fin 1883, Auguste Lebeuf entre le 22 juin 1884 à l’observatoire de Paris. Il est nommé aide-astronome à l’observatoire de Besançon le 1er avril 1887 puis enseigne à la Faculté des Sciences de Montpellier à partir de 1898. Le 1er février 1903, il revient à Besançon pour succéder à L.-J. Gruey aux postes de directeur de l’observatoire et titulaire de la chaire d’astronomie, fonctions qu’il occupe jusqu’à sa mort en juillet 1929.
Leroy, Louis (1859-1934) : Né dans une famille d’horlogers célèbres depuis Julien Le Roy (1686-1759), Louis Leroy fait son apprentissage chez son père, fabricant de chronomètres de marine au Palais-Royal. Il prend sa succession en 1889, dans la société L. Leroy et Cie, et s’installe ensuite boulevard de la Madeleine. Afin de participer aux concours chronométriques, il ouvre en 1892 à Besançon un atelier, dirigé par M Maillard-Salin. Pionnier en France pour la fabrication des pendules à température et pression constantes, il installe les trois premières à l’observatoire de Paris en 1914. Perfectionnant ces pendules en utilisant les alliages mis au point par C.-E. Guillaume, il permet d’inverser les rôles entre astronome et pendule, la deuxième permettant désormais de corriger les observations du premier. En 1924, il succède à Fénon au Bureau des longitudes.
Le Verrier, Urbain (1811-1877) : Mathématicien et astronome français, il entre à l’Ecole polytechnique en 1831 et y devient, dix ans plus tard, titulaire de la chaire d’astronomie. Par ses calculs, il prouve en 1846 l’existence de Neptune sans l’observer directement. Membre de l’Académie des sciences cette même année, il est nommé directeur de l’observatoire de Paris le 31 janvier 1854. Il y œuvre notamment pour l’augmentation de la précision des mesures de l’heure et sa diffusion par télégraphe, de même qu’il utilisera, à partir de 1858, ce moyen pour la diffusion quotidienne d’un bulletin météorologique. Auteur de théories cohérentes pour les mouvements des planètes, il est le créateur des Annales de l’Observatoire de Paris.
Lissajous, Jules-Antoine (1822-1880) : Entré à l’Ecole normale supérieure en 1841, il est ensuite professeur au lycée Saint-Louis. Recteur de l’Académie de Chambéry en 1874, il devient l’année suivante recteur de celle de Besançon. Physicien dans le domaine de l’optique, il invente en 1855 une méthode pour étudier les vibrations acoustiques, par réflexion de signaux lumineux sur un miroir attaché à l’objet vibrant.
Loewy, Maurice (1833-1907) : Né à Marienbad, Loewy devient assistant à l’observatoire de Vienne puis travaille, à partir de 1860, à celui de Paris. Membre du Bureau des longitudes en 1872. De 1873 à 1880, il contribue à l’amélioration de la Connaissance des Temps et au perfectionnement de divers instruments. Inventeur de l’équatorial coudé, construit en 1882, il réalise avec Pierre Puiseux L’Atlas photographique de la Lune, achevé en 1910 et totalisant 10 000 clichés. Membre de l’Académie des sciences depuis 1873, il en devient le président en 1894. En 1896, il est nommé directeur de l’observatoire de Paris, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1907.
Saint-Ginest, Etienne-Bernard (1831-1888) : A l’Ecole des beaux-arts, il est élève de Labrouste et Questel. En 1861, alors qu’il est employé par Baltard, il est nommé architecte départemental du Doubs. On lui doit les archives du Doubs, le tribunal de Pontarlier, les prisons de Pontarlier, Montbéliard, Baume-les-Dames et Besançon.
Sire, Georges (1826-1906) : Deuxième directeur de l’Ecole d’horlogerie de Besançon (de 1864 à 1871), essayeur du Service de la garantie de 1871 à 1906, membre de l’Académie de Besançon en 1870, correspondant de l’Académie des sciences en 1891, président de la Société d’Emulation du Doubs en 1893, membre de l’Association française pour l’Avancement des Sciences.
Gruey (Louis-Jules). Notice historique sur l’observatoire de Besançon. Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1883, p. 311-322. Dans le même volume de Mémoires, p. 39-88 : Visite à divers observatoires étrangers.
NOTICE HISTORIQUE SUR L’OBSERVATOIRE DE BESANCON
Par M. Gruey, directeur de cet établissement
Séance publique du 13 décembre 1883.
MESSIEURS,
Dans la séance du 7 novembre dernier, votre conseil d’administration a bien voulu me demander, pour la réunion solennelle d’aujourd’hui, une notice sur la création de l’Observatoire de Besançon. J’ai eu la témérité de promettre, au milieu de travaux professionnels qui s’allient mal à l’idée d’une lecture publique à courte échéance. Il faut tenir maintenant. Permettez-moi de le faire en quelques mots, puisqu’il s’agit d’un établissement qui ne fonctionne pas encore, qui voit à peine le jour et sur lequel j’ai bien peu de choses à vous apprendre.
Dès l’année 1868, le colonel du génie, Laussedat, dans une étude sur l’horlogerie du Doubs et de la Suisse, disait: : « La fabrique de Besançon se trouve dans une situation critique, malgré toutes les apparences de la prospérité ; car elle est menacée à la fois par la concurrence des produits suisses et par celle des montres faites à la mécanique. » Il concluait en indiquant la création d’un Observatoire comme indispensable pour mettre l’industrie bisontine à l’abri d’une décadence. Trois ans plus tard, en 1871, le Conseil municipal de Besançon émettait le vœu qu’un Observatoire fût fondé pour venir en aide aux horlogers ; mais ce n’est qu’en 1877 que le maire, M. le sénateur Oudet, sollicitant le concours de l’Etat, soumit au ministre de l’instruction publique un avant-projet rédigé par M. Rouzet, ingénieur voyer de la ville.
« Les événements, dit cet avant-projet, ont donné raison à M. Laussedat, et, en présence du perfectionnement incessant des machines étrangères, la fabrique bisontine doit s’inquiéter de ses conditions d’existence. Les hommes clairvoyants s’inquiètent des progrès réalisés par les usines américaines, dont les produits livrés à bas prix, envahiront tôt ou tard le marché français, si nos montres ne justifient pas de leur prix élevé par une qualité supérieure.
» Les efforts de l’industrie horlogère, pour prévenir sa ruine, ajoute en concluant l’avant-projet, doivent être secondés et encouragés par l’établissement d’un Observatoire indispensable pour la fabrication des pièces de précision et nécessaire pour compléter l’éducation des élèves de l’Ecole d’horlogerie que la ville entretient à grands frais.
» Cet Observatoire, dont le but immédiat est d’assurer l’avenir de l’industrie horlogère, doit être avant tout chronométrique ; mais il doit aussi être astronomique à cause des élèves de la Faculté des sciences. Enfin, on doit y faire un peu de météorologie, celle de la région jurassique de l’Est.
» Il est certainement extraordinaire qu’on ne sache pas l’heure dans un pays où l’on fabrique plus de mille montres par jour et non moins étrange qu’aucune série d’observations météorologiques n’ait été recueillie dans une ville qui possède une Faculté des sciences. »
En se bornant provisoirement au seul service chronométrique, ce premier projet propose une installation dont il donne le détail et évalue la dépense à 100,000 francs environ. Suivant lui, on aurait établi plus tard pour l’astronomie un équatorial, une pendule sidérale et un cercle mural.
Le ministre de l’instruction publique, saisi du projet, le renvoya au recteur, M. Lissajous, en le chargeant de s’entendre avec la municipalité pour la répartition de la dépense entre la ville et l’Etat, mais sous la condition expresse que l’Observatoire serait considéré comme une annexe de la Faculté des sciences. « Il faut, écrivait le ministre, que les terrains et bâtiments demeurent la propriété de la ville, qui s’interdira d’en modifier l’affectation sans le consentement de l’Etat. La direction de l’Observatoire relèvera exclusivement du ministre de l’instruction publique et fera corps avec la Faculté. »
Le recteur, après avoir visité les divers observatoires de la Suisse, destinés à favoriser à la fois les progrès de l’astronomie et de l’horlogerie, adressa au maire, le 17 novembre 1877, un nouveau projet assez détaillé s’élevant à la somme de 150,000 francs environ. Dans ce projet, M. Lissajous songeait surtout à la chronométrie ; il ne s’occupait guère de l’astronomie et laissait complètement de côté le service météorologique « question, disait-il, que je me réserve de reprendre en y intéressant, si faire se peut, le Conseil général. »
Le 20 décembre 1877, le Conseil municipal, réuni en séance, accepta les conclusions de M. Lissajous, et le vote d’acceptation fut transmis à M. le ministre de l’instruction publique.
Le ministre répondit, le 11 mars 1878, par un décret créant un Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique à Besançon. Le lendemain, 12 mars, il écrivait au recteur :
« J’accepte les propositions contenues dans la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 1877. L’Observatoire devant être à la fois astronomique, météorologique et chronométrique, les ressources assurées jusqu’ici ne donnent satisfaction qu’à deux de ces besoins.
» Le Conseil général s’associera, je l’espère, aux sacrifices que s’imposent mon administration et la municipalité, et voudra bien compléter l’œuvre, en allouant le supplément nécessaire pour doter le service météorologique qui a pour lui une importance toute particulière. »
Enfin, vers la même époque, il obtenait des Chambres le vote d’un budget annuel de 20,000 francs affecté par l’Etat au traitement du personnel et à l’entretien du matériel d’observation.
En présence de cette généreuse activité ministérielle, la ville votait, le 15 avril 1878, les frais nécessaires à la recherche d’un emplacement convenable ; le 17 octobre suivant, elle faisait l’acquisition d’un terrain de 1 hectare 57 ares 39 centiares 60 pour la somme de 15,844 fr. 20.
De son côté, le Conseil général, dans sa session d’avril 1878, votait la création du service météorologique à l’Observatoire, avec une somme de 5,000 francs et un budget annuel de 250 francs pour satisfaire aux premières exigences de ce service.
On le voit, pour mener l’entreprise commune à bonne fin, il ne manquait plus qu’un directeur et il fut nommé par arrêté ministériel du 16 janvier 1879.
Malheureusement, des difficultés imprévues surgirent bientôt et la municipalité déclara ajourner l’exécution des projets.
L’année 1879 s’écoula dans l’inaction ; il en fut de même de l’année 1880 presque toute entière. On pouvait croire la question abandonnée. Il n’en était rien, cependant, Messieurs ; elle fut reprise vigoureusement par la ville et par l’Etat.
Dans sa séance du 6 décembre 1880, le Conseil municipal, sur le rapport du docteur Saillard : « Considérant que, par l’intermédiaire de son syndicat élu, la population horlogère de Besançon, qui produit annuellement 450,000 montres, sollicite instamment la prompte organisation de l’Observatoire et fait justement remarquer que tout retard apporté à l’édification de cette œuvre entrave les progrès et cause le plus sérieux préjudice à la réputation de l’industrie capitale de la cité ;
» Qu’en effet, il est incontestable que cette institution pourra seule fournir les deux moyens de contrôle indispensables au développement de l’horlogerie : 1° la fixation quotidienne de l’heure exacte ; 2° le contrôle officiel de ses produits ; que ce puissant concours est acquis depuis plusieurs années à la fabrication rivale et étrangère de la Suisse, qui possède deux observatoires chronométriques et astronomiques, l’un à Genève et l’autre à Neuchatel ;
» Que la création d’un Observatoire doit entraîner celle d’une chaire d’astronomie à la Faculté des sciences et contribuer ainsi à la prospérité de l’enseignement supérieur de la ville ; émet le vœu que l’Observatoire soit rapidement construit et qu’il soit dirigé par le titulaire d’une chaire d’astronomie à la Faculté. »
Ici, Messieurs, nous devons rendre un juste hommage à la hauteur et à la sagesse des vues du Conseil municipal en matière d’enseignement.
Limitée aux questions essentielles, le jour, la nuit, la forme et la mesure de la terre, les saisons, les éclipses, les parties saillantes des systèmes planétaire et stellaire, les applications les plus simples à la géographie et à la navigation, les éléments de l’analyse spectrale et de la physique céleste, l’astronomie a sa place marquée au premier rang dans toute éducation vraiment nationale et démocratique. Elle est le meilleur préservatif contre les préjugés frivoles, la superstition, le fanatisme et toutes les passions vulgaires, parce qu’elle est le plus haut exemple du triomphe définitif de la raison humaine.
On ne saurait donc estimer à trop haut prix les bonnes habitudes d’esprit contractées dans cet enseignement et répandues dans le public par un auditoire qui se renouvelle chaque année au moins partiellement.
Cependant, les cours sérieux d’astronomie mathématique ou populaire ont peu réussi jusqu’à ce jour en province. C’est que le raisonnement, à défaut d’Observatoire, a toujours été appelé, avec les descriptions abstraites, à en faire les principaux frais.
Que deviendraient nos amphithéâtres de physique, de chimie, d’histoire naturelle, ordinairement si bien garnis, si les professeurs annonçaient un beau jour qu’à l’avenir ils feront leurs cours sans instruments, sans expériences, sans échantillons, avec la seule raison pure, assistée d’un tableau noir, de la craie blanche et d’une éponge ? A l’instant les amphithéâtres se videraient ; il n’y resterait plus que quatre ou cinq auditeurs, comme aux cours de mathématiques transcendantes les plus suivis.
Un cours d’astronomie ne peut produire ses meilleurs fruits qu’à l’ombre d’un Observatoire, muni des principaux instruments. En même temps que le Conseil municipal ressuscitait la question de l’Observatoire, en l’élargissant, M. Lœwy, sous-directeur de l’Observatoire de Paris, écrivait au ministre de l’instruction publique, dans son rapport de 1880 sur les observatoires de province :
« Le gouvernement a bien voulu, de concert avec la ville de Besançon, décider la création d’un Observatoire destiné à provoquer et à constater les progrès de l’industrie horlogère locale et à lui venir en aide.
» L’urgence de cette création s’impose chaque jour davantage.
» La concurrence étrangère devient en effet redoutable. Les Américains particulièrement, dans leur ardeur universelle d’entreprise, ont, depuis quelques années, fondé des fabriques d’horlogerie où, par le concours de capitaux considérables et par la centralisation du travail, on a pu simplifier les procédés de construction et réaliser ainsi une économie sérieuse sur le prix de revient. Il en résulte que les Etats-Unis offrent au commerce leurs produits à des prix inférieurs à ceux des autres pays. La Suisse, menacée comme la France, par le travail américain, s’est mise en devoir de résister le plus tôt possible. La république helvétique, depuis plusieurs années déjà, a créé des observatoires chronométriques à Neuchatel et à Genève, afin de donner un nouvel essor à son industrie horlogère et de lui assurer la suprématie dans le monde au point de vue de la précision des produits : aussi la fabrication suisse a-t-elle fait des progrès sérieux et constants ; elle peut ainsi lutter avec succès et se maintenir au rang élevé qu’elle occupait jadis.
» Nous nous trouvons donc aujourd’hui en face d’une double rivalité, celle de la perfection du travail suisse et celle du bon marché des produits américains. Il est par suite urgent, Monsieur le ministre, de prendre immédiatement des mesures pour le prompt développement de l’Observatoire chronométrique de Besançon.
» Il ne s’agit pas seulement de sauvegarder les intérêts légitimes d’une industrie qui constitue une des principales branches de l’activité nationale, en Franche-Comté ; il faut considérer encore que la France est une grande, nation maritime et qu’il convient d’assurer par tous les moyens possibles la sécurité de la navigation.
» Or, l’un des éléments les plus importants sur lesquels s’appuient les marins, dans la détermination de leur route, est la connaissance exacte de l’heure.
» Cet élément s’obtient à l’aide de chronomètres, et il sera naturellement d’autant plus précis que la construction de ces appareils sera plus parfaite et leur marche plus régulière.
» Ce sont ces deux ordres de considérations, Monsieur le ministre, qui font au comité consultatif un devoir de vous signaler l’urgence des mesures à prendre. »
On ne saurait rien ajouter à la force des raisons données par M. Lœvy, sinon que nos marins, marchands et militaires, achètent aujourd’hui leurs chronomètres en Angleterre, en attendant que Besançon soit en mesure de les construire.
Vous le voyez, Messieurs, dans l’esprit de tous ceux qui travaillent, sans se décourager, à sa fondation, l’Observatoire de Besançon doit être à la fois chronométrique, astronomique et météorologique. Remarquons en passant que les observatoires de la Suisse ont ce triple caractère.
« Si l’observatoire de Neuchatel, écrit M. Hirch dans son rapport de l’année 1875, a pu rendre des services appréciés à notre industrie horlogère, c’est grâce à l’esprit large qui a présidé à sa fondation et l’a soutenu constamment ; c’est qu’on a compris, dès l’origine, qu’il ne fallait pas se borner à rassembler les moyens strictement nécessaires pour pouvoir contrôler un chronomètre, mais qu’il s’agissait de créer un établissement scientifique capable de prendre part, dans une certaine mesure, au travail astronomique et météorologique. En effet, les sciences et les arts ne peuvent rendre leurs services inappréciables à l’industrie et à tout le développement matériel de la Société qu’en restant libres et indépendants dans leur culte du vrai et du beau.
» L’utilitarisme rigoureux, qui demande à chaque travail théorique et à toute œuvre d’art son utilité immédiate et directe, finirait bientôt par étouffer le développement des sciences et par faire tarir la source des progrès pratiques aussi bien que théoriques. »
En résumé, d’un avis unanime, que chaque jour de retard a fortifié de plus en plus, l’Observatoire de Besançon devait offrir avant tout aux horlogers et fabricants de la Franche-Comté un service chronométrique complet, réunissant les moyens de contrôle les plus délicats et les plus perfectionnés.
Il devait prendre part au magnifique réseau de recherches astronomiques qui s’organisent en France, à Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Nice ; car il n’y a jamais trop d’observatoires pour explorer le Ciel ; noter et suivre tout ce qui se produit ; découvrir les petites planètes et les comètes ; surveiller les corps intra-mercuriels, soupçonnés par Le Verrier ; attendre les étoiles filantes et les bolides ; dessiner les taches du soleil ; dresser les cartes célestes ; faire de l’analyse spectrale ou de la photographie. Enfin, il devait contribuer aux progrès de la météorologie qui ne fait que commencer à la fin de notre siècle, tandis que l’astronomie a presque atteint les limites de la perfection.
Un pareil programme ne se remplit pas en un jour, ni même en une année. Voici comment il s’est enfin réalisé peu à peu.
Dans le courant de juin 1881, M. Faye et M. Lœvy, membres de l’Académie des sciences et du bureau des longitudes, se rendirent à Besançon. Leur présence eut un grand retentissement dans la ville et fit entrer la question de l’Observatoire dans la voie véritable. Ils décidèrent la municipalité à abandonner le terrain, déjà acquis, comme trop exigu et trop voisin de la gare du chemin de fer, et, après avoir parcouru les environs, ils proposèrent à son nouveau choix les vastes espaces mamelonnés du canton de la Bouloie. Le Conseil municipal et le syndicat des horlogers goûtèrent vivement les raisons données par les deux éminents astronomes et l’acquisition du nouveau terrain contenant 7 hectares 44 ares fut décidée en principe.
M. Lœvy prolongea son séjour à Besançon et prit en quelque sorte possession du terrain. Il fit construire une cabane en briques où la longitude du futur Observatoire fut déterminée, sous sa direction, par deux officiers de marine, à l’aide d’un petit cercle méridien. La ville prit à sa charge la dépense de la cabane, 4,800 fr., et le bureau des longitudes prit à la sienne la somme de 3,663 francs pour la pose du fil télégraphique nécessaire à l’opération.
Le 14 octobre 1881 le Conseil municipal mettait en réserve dans son budget supplémentaire de 1882 une somme de 100,000 francs sous le titre de Terrains et constructions de l’Observatoire.
Quelques jours plus tard, le 26 octobre, le directeur de l’Observatoire donnait sa démission. Son successeur, sans perdre un instant, s’occupe immédiatement d’élaborer, avec l’architecte de la ville, un projet qui fut soumis au Conseil municipal et au ministère de l’instruction publique. En attendant une décision, on a cru bien faire d’appliquer la somme de 5,000 francs votée par le Conseil général pour le service météorologique, à l’acquisition des principaux enregistreurs :
1 anémoscope ;
1 anémomètre ;
2 baromètres (Redier et Richard) ;
2 thermomètres (Redier et Richard) ;
1 électromètre (Mascart).
Le 31 mai 1882, un traité entre la ville et l’Etat fut signé par M. Ferry, ministre de l’instruction publique, et M. Delavelle, maire de Besançon. Ce traité, d’une importance capitale, faisait sortir l’Observatoire de la région des nuages et l’établissait sur des bases aussi larges que solides. Aux termes de ce traité, la ville s’engage :
1° A fournir un terrain de 7 hectares 50 ares au lieu dit canton de la Bouloie ;
2° A construire les pavillons nécessaires aux instruments et à l’administration, savoir :
Un pavillon chronométrique ;
Un pavillon météorologique ;
Un pavillon pour équatorial ;
Un pavillon pour altazimut ;
Deux pavillons d’habitation, l’un pour les aides, l’autre pour le directeur ; constructions dont la dépense totale, terrain compris, est évaluée à 190,000 francs ;
3° A doter annuellement le service chronométrique d’une somme de 4,000 francs.
L’Etat s’engage :
1° A donner à la ville une subvention de 30,000 francs pour terrains et constructions ;
2° A fournir les instruments, savoir :
Une lunette méridienne 7 pouces ;
Un équatorial de 12 pouces ;
Un altazimut de 4 pouces ;
Tous les appareils nécessaires au service chronométrique ; instruments dont le prix total est évalué à 130,000 francs ;
3° A doter annuellement d’un budget de 20,000 francs l’ensemble de tous les services et l’entretien du matériel.
Le 25 août de la même année 1882, le Conseil général terminait son œuvre, si bien commencée, en votant 3,000 francs pour l’acquisition des enregistreurs magnétiques.
Le 15 octobre 1883 une chaire d’astronomie était créée à la Faculté des sciences.
Ainsi, Messieurs, la question de l’Observatoire vous paraît résolue par la générosité et les lumières réunies du Conseil municipal, du Conseil général et du ministère de l’instruction publique. Les pavillons élégants et commodes sortent de terre rapidement sous la main d’un architecte habile, M. Saint-Ginest ; les instruments se fabriquent à Paris dans les ateliers des meilleurs artistes ; la dotation de tous les services est largement assurée ; oui, l’Observatoire est fondé.
Mais, au-dessus de l’Observatoire, se place une question plus haute, complexe, difficile, que vous n’avez pas perdu de vue, qui nous préoccupe tous à juste titre : c’est le progrès de notre industrie horlogère ? Qui pourrait se flatter de posséder tous les éléments délicats et fugitifs de ce grand problème. L’Observatoire doit contribuer, sans doute, puissamment à le résoudre, mais il ne saurait avoir la prétention d’y suffire. Il faudra le concours de tous : de l’administration, des pouvoirs publics, du syndicat, des fabricants et des ouvriers.
Lorsque toutes les mesures nécessaires seront prises, que tous les services fonctionneront, qu’après nous être entourés des conseils des hommes éminents, qui font des vœux pour notre industrie, nous aurons réuni tous les moyens de perfectionnement et de contrôle, les 10,000 horlogers de Besançon comprendront mieux que jamais, s’il est possible qu’ils sont une armée et qu’ils peuvent marcher résolûment à la concurrence étrangère, c’est-à-dire à l’ennemi, sous le drapeau de la science.
Gruey, Louis-Jules. Visite à divers observatoires étrangers. Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1883, p. 39-88. Du même, p. 311-322 : Notice historique sur l’observatoire de Besançon.
VISITE A DIVERS OBSERVATOIRES ETRANGERS
I OBSERVATOIRES DE LA SUISSE.
J’ai désiré visiter les observatoires de la Suisse, cette terre classique de l’horlogerie, avant de soumettre à M. le Ministre de l’Instruction publique le programme du service le plus important de l’observatoire de Besançon, le service chronométrique. M. le ministre a bien voulu approuver ce désir et subvenir aux frais de l’excursion.
Je suis parti de Besançon le 24 novembre 1881, accompagné de M. Bérard, architecte de la ville. Nous avons visité ensemble les observatoires et les écoles d’horlogerie de Neuchatel, du Locle, de Zurich, de Berne et de Genève. Notre mission pouvait s’arrêter là, mais nous l’avons étendue jusqu’à l’observatoire de Lyon qui est déjà construit en très grande partie. Le 6 décembre nous rentrions à Besançon.
Dans ce voyage rapide, nous n’avons jamais cherché que l’utile, et nous l’avons toujours trouvé mêlé à l’agréable ; Partout, sur notre route, des paysages dont la beauté nous faisait oublier les approches de l’hiver et, dans les villes, des savants distingués qui nous ont accueilli comme des concitoyens.
NEUCHATEL.
Partis de Besançon le 24 novembre à 7 h. 41 m. du matin, nous arrivons à Neuchatel à 3 heures du soir. Le 25 à 9 heures du matin, par une pluie fine et serrée, nous nous rendons à l’observatoire. Il est situé au bord du lac, à l’est de la ville, et à deux kilomètres environ du centre, sur une petite hauteur. Nous y arrivons par une large route, excellente, malgré le mauvais temps.
Le directeur, M. Hirsch nous reçoit. Il ne nous a jamais vus, mais il nous sourit comme à de vieilles connaissances, en apprenant que Besançon nous envoie. Besançon n’a-t-il pas déjà frappé trois ou quatre fois à sa porte ? Aussi s’empresse-t-il de nous expliquer lui-même avec la netteté la plus courtoise, tous les détails de son installation.
Aperçu général.
La situation est superbe, entièrement isolée. Nous pouvons l’admirer malgré la pluie. Au sud et de l’est à l’ouest s’étend le lac qui baigne les pieds de l’établissement ; au nord court une colline, légèrement boisée, qui n’enlève à l’horizon que deux ou trois degrés.
Le bâtiment s’élève au milieu d’un jardin parfaitement horizontal. Il est distribué en trois parties ; au centre, les salles d’observation ; à l’est, l’appartement du directeur ; à l’ouest, le logement des aides et adjoints.
Le personnel se compose du directeur, d’un astronome adjoint, d’un aide et d’un concierge.
Salles d’observation.
1° Salle méridienne. – M. Hirsch nous introduit d’abord dans la salle méridienne, jolie pièce de 8 mètres de long, sur 6 de large environ.
Une lunette méridienne, un 7 pouces en très bon état, repose sur deux beaux piliers en marbre. Les coussinets sont munis de vis qui permettent de régler l’azimut et l’inclinaison, disposition généralement abandonnée aujourd’hui, mais à laquelle M. Hirsch paraît tenir. La lunette est munie d’un bon cercle de déclinaison et 4 microscopes sont fixés sur chacun des piliers. 2 microscopes mobiles servent en outre à déterminer les erreurs de division.
A côté de la lunette est debout la pendule sidérale, la meilleure de l’observatoire, dite pendule normale, fixée à un troisième pilier du même marbre. Le battement de cette pendule est trop faible pour être entendu même à une petite distance ; aussi observe-t-on les passages sur un cadran électrique, comparé chaque jour à la pendule normale, cadran marquant les heures, minutes, secondes et dont le régulateur se trouve dans une pièce voisine.
Au nord de la lunette, nous voyons une excellente et jolie machine à retournement construite à Munich par Ertel. Le modèle est certainement meilleur que le modèle français ; il permet de faire le retournement, opération délicate, avec plus de facilité et plus de précision. Nous en prenons le dessin exact.
Au-dessus de cette lunette se tient, suspendu au plafond, le grand niveau qui peut descendre mécaniquement pour donner la mesure de l’inclinaison.
Je m’étonne de la largeur du lit d’observation. Suivant M. Hirsch, le lit français est trop étroit, il reçoit mal la tête de l’observateur et occasionne souvent une tension des muscles du cou, tension fatigante, nuisible en outre à l’exactitude des mesures.
Nous examinons les fenêtres et la fente méridienne du toit. Elles sont larges et la salle est bien aérée. Des parasols et parapluies mécaniques, fort bien cousus, permettent d’ailleurs d’abriter complètement les instruments soit contre la chaleur, pendant l’observation du soleil, soit, pendant les ouragans contre l’eau ou la neige qui s’infiltrent dans les jointures des trappes.
Le mauvais temps nous empêche de pointer deux mires éloignées, l’une au sud, au-delà du lac, à 9 kilomètres ; l’autre au nord, à 3 kilomètres 8 seulement, avec une légère inclinaison à l’horizon. La mire sud est excellente pour deux raisons ; d’abord elle est très éloignée, ensuite le rayon visuel se dirige sur elle en rasant une surface liquide, également échauffée partout et n’occasionnant pas ces ondulations atmosphériques si nuisibles et si fréquentes au-dessus de la terre ferme. Une troisième mire, une mire ordinaire avec objectif, sert pendant la nuit et les jours de mauvais temps ; nous l’avons pointée ; elle est située au nord, à une distance de 100 mètres environ.
Un quatrième pilier, en calcaire, paraît sans emploi à l’angle nord-est de la salle ; c’est le pilier qui a servi à MM. Hirsch et Plantamour pour déterminer l’intensité de la pesanteur à Neuchatel.
2° Rotonde de pendule électrique. – De la salle méridienne, nous passons à l’est, dans une rotonde annulaire. C’est le rez-de-chaussée de la tour équatoriale, traversée de haut en bas par un gros pilier central et cylindrique qui se rend sous une coupole au premier étage.
Autour de ce pilier central sont accrochées trois pendules ordinaires communes et une pièce importante, le pendule électrique de M. Hipp ; c’est un simple pendule dont les oscillations sont entretenues par un électro-aimant ; il n’y a ni rouage, ni minuterie. La seconde sidérale donnée par ce pendule, est transmise électriquement à la minuterie du compteur à cadran de la salle méridienne. Nous partageons l’admiration de M. Hirsch pour cette belle application de l’électricité et pour partager aussi sa confiance dans la sûreté de la seconde, ainsi donnée et transmise, il nous suffirait sans doute d’expérimenter nous même et de faire, pendant un temps assez long, ce que M. Hirsch fait tous les jours, la comparaison de cette seconde électrique avec la seconde de la pendule normale.
Sur les parois de la rotonde sont installées quelques piles électriques, notamment celle qui actionne le pendule de M. Hipp.
3° Salle des chronomètres. – A l’ouest de la salle méridienne se trouve celle des chronomètres, sous les mêmes dimensions ; 8 mètres de long et 6 mètres de large.
Là, nous trouvons un beau chronographe cylindrique de M. Hipp ; une pendule moyenne ; une pendule directrice qui distribue un signal à Neuchatel et ses environs, des étuves, enfin, dans un vaste placard, sorte de coffre-fort fermé par une porte en fer, les pièces suivantes déposées à l’étude par les horlogers : deux chronomètres de marine du Locle, deux chronomètres de marine de Genève et 32 montres ordinaires. Ce placard renferme, en outre, divers thermomètres et un chronomètre thermométrique.
C’est la salle vraiment originale et intéressante pour nous ; nous y restons longtemps, examinant tout en détail.
Une étuve à chaleur est bien facile à comprendre. C’est une caisse divisée en deux compartiments séparés par une cloison horizontale. Le compartiment inférieur est rempli d’eau chauffée par un bec de gaz qui brûle immédiatement au-dessous. Le compartiment supérieur renferme : le chronomètre à étudier, un thermomètre ordinaire, des thermomètres à maximum et minimum, enfin, un régleur bimétallique, zinc et cuivre, qui ouvre plus ou moins le robinet du tuyau conduisant le gaz, suivant que la température du compartiment s’abaisse ou s’élève au-dessus de la valeur moyenne qu’elle doit conserver.
Une étuve à glace est encore plus simple. C’est une caisse entourée extérieurement d’une couche de glace, pouvant recevoir chronomètres et thermomètres sans les exposer aux atteintes de l’eau de fusion.
Le chronographe n’est autre chose qu’un cylindre horizontal, recevant d’un mouvement d’horlogerie une rotation uniforme autour de son axe. Une feuille de papier est enroulée sur le cylindre et deux plumes, continuellement imbibées d’encre, peuvent à un moment donné tracer sur la feuille un trait représentatif de ce moment. L’une des plumes peut être mise en relation électrique avec le pendule de M. Hipp, dont elle inscrit aussitôt les secondes successives ; l’autre plume fait partie d’un circuit ou fil voltaïque ouvert que l’observateur ferme à volonté, en appuyant le pouce sur un bouton qui réunit les deux bouts du fil. Au moment de la fermeture, la plume trace un trait sur la feuille. Le bouton est d’ailleurs mobile et l’observateur, en le tenant en main, peut le déplacer librement.
Tous les jours, vers midi et demi, lorsque l’état de la pendule a été déterminé par les observations à la lunette méridienne, le chronographe sert à comparer toutes les pendules, montres et chronomètres, soit de l’observatoire, soit des horlogers. Voici comment se fait cette comparaison :
L’aide se place devant le chronographe sur lequel la première plume inscrit les secondes de la pendule électrique. Il tient d’une main un crayon et de l’autre un compas dont l’ouverture invariable répond sur le chronographe à un intervalle de 10 secondes. L’adjoint va se placer d’abord devant la pendule électrique. Il donne à l’aide un tope vocal correspondant à une minute ronde, désignée à l’avance. Sur le trait que trace à l’instant même la première plume, l’aide inscrit le numéro de cette minute ; il inscrit de même, à partir de ce moment, les numéros des dizaines de secondes successives de la pendule électrique, en s’aidant du compas et sans nombrer les secondes. Cependant l’adjoint a déjà saisi le bouton électrique de la deuxième plume et est venu se placer devant la pendule ou le chronomètre à comparer. Il prévient l’aide à haute voix qu’à partir de telle minute, il donnera six topes répondant aux six secondes suivantes. L’aide inscrit le numéro de la minute désignée sur le premier des traits tracés par la deuxième plume. La comparaison s’achève en relevant les secondes des deux instruments ainsi inscrites sur la même feuille. Un vernier spécial, le releveur, permet d’exécuter facilement cette opération finale, lorsque la feuille du chronographe a reçu l’heure de tous les instruments à comparer.
La comparaison chronographique est d’ailleurs contrôlée autant que possible par une comparaison directe ou à l’œil. Cette dernière est même seule employée pour les montres de poche.
Les aiguilles à secondes des petites montres sont souvent excentriques au cadran. On en tient compte dans chaque comparaison, en observant la pointe de l’aiguille dans deux positions diamétralement opposées.
Les montres ne sont conservées à l’étude que si elles ont une marche inférieure à 10 s. et une variation diurne inférieure à 2 s.
Les montres de moindre qualité ne sont étudiées que 15 jours, à plat, cadran en haut, sans passer par les étuves.
Les chronomètres de poche sont suivis dans cinq positions :
à plat, cadran en haut, 8 jours
à plat, cadran en bas, 8 jours
pendus, queue en haut, 5 jours
pendus, queue à droite, 5 jours
pendus, queue à gauche, 5 jours
en tout 31 jours, à la suite desquels on les soumet 24 heures à la glace et 24 heures à l’étuve. Quelques-uns, spécialement recommandés, sont suivis pendant 45 jours.
Les chronomètres de marine sont suivis pendant environ 2 ou 3 mois, en passant plusieurs fois par les étuves.
Les horlogers paient 5 fr. pour un chronomètre de poche et 20 fr. pour un chronomètre de marine.
Distribution du signal.
La pendule directrice est une pendule anglaise, réglée sur le temps moyen. Chaque jour, aussitôt que la comparaison a déterminé son avance ou son retard, on la met à l’heure exacte en actionnant son balancier pendant un temps convenable par une pendule auxiliaire qui la retarde ou l’avance de 0 s, 01 par oscillation. Cet[te] correction physique se pratique à midi trois quarts environ. Lorsqu’elle est effectuée, on la contrôle en comparant la pendule directrice à la pendule moyenne située dans la même salle, à peu de distance, et dont l’état est connu.
Cette pendule directrice, ainsi corrigée, distribue dans toute la Suisse, à 0 h. 55 m. 0 s. un signal instantané. Voici comment :
Elle est traversée par un courant électrique qui s’y brise ou s’y ouvre en trois endroits différents. A ces trois ouvertures correspondent chacune à chacune les trois aiguilles de la pendule. Chaque aiguille ferme son ouverture pendant un temps très court, aussitôt qu’elle occupe sur son cadran une certaine position ; l’aiguille des secondes lorsqu’elle tombe sur 0, l’aiguille des minutes lorsqu’elle tombe sur 55 et l’aiguille des heures lorsqu’elle marque 0. Ainsi, une seule fois seulement par jour, 0 h. 55 m. 0 s., les trois ouvertures sont fermées simultanément et le courant électrique est rétabli. Il se lance au moment même, en sortant de la pendule, dans toutes les directions qui lui sont offertes, à Neuchatel, Berne, Bienne, Locle, Soleure, Chaux-de-Fonds, les Ponts, les Brenets, Fleurier, Sainte-Croix. Dans chaque hôtel de ville, il actionne 1’armature d’un électro-aimant. Avant l’action, l’armature retient écarté de la verticale le pendule d’un petit compteur marquant 0 h. 55 m. 0 s ; au moment de l’action électrique, l’armature abandonne ce pendule et le compteur, mis en marche, donne l’heure exacte de Neuchatel. Le compteur, ou, comme disent les Suisses, le signal marche pendant quelque temps jusqu’à ce que l’horloger municipal vienne remettre son pendule en arrêt sur l’armature de l’électro-aimant. Un grand nombre d’horlogers ont demandé et obtenu le même signal à domicile, en payant une taxe. Ce signal manque quelquefois, lorsqu’il se produit dans le courant électrique l’une de ces perturbations qu’il est si difficile d’éviter entièrement.
L’équatorial. – Nous quittons enfin le rez-de-chaussée de l’observatoire et nous montons à l’équatorial. Avant de pénétrer sous la coupole, nous traversons une petite salle qui sert de bibliothèque et de cabinet de travail.
L’équatorial n’a rien de particulier, c’est un bon petit 6 pouces, avec mouvement d’horlogerie. Il repose immédiatement sur un bloc de marbre, sorti de la même carrière que les piliers de la salle méridienne. La coupole est très bien montée et roule parfaitement sur ses galets.
Jardin. – Le jardin est, lui aussi, un lieu d’observation ; on y trouve installés les instruments météorologiques les plus usuels sous un abri presque identique à celui qui est adopté en France.
Après cette longue et instructive visite, nous quittons l’observatoire ; il est onze heures et demie. Nous reviendrons demain, à une heure, pour assister à la comparaison des pendules et chronomètres déjà décrite par anticipation. En rentrant à Neuchatel, nous voyons avec plaisir que le beau temps se prépare ; nous retournons plusieurs fois pour examiner encore et admirer la position de l’observatoire. Nous passons la soirée à Neuchatel. J’y visite la distribution de l’heure tandis que M. Bérard s’y met à la recherche des curiosités artistiques.
Distribution de l’heure.
Un peu avant une heure moins cinq minutes, je suis allé à l’hôtel-de-ville en présence du signal, les yeux fixés sur la pendule immobile. L’horloger municipal est là, attendant comme moi. Tout à coup, un léger bruit se fait entendre ; le pendule vient de donner le signal en échappant à l’armature qui se retire ; il est 0 h. 55 m. 0 s. à l’observatoire de Neuchatel. Aussitôt l’horloger compare au compteur, qui fournit le temps exact, une horloge placée dans la même vitrine et dont le balancier oscille entre deux petits pendules immobiles. Après avoir déterminé l’avance ou le retard de cette horloge, il la corrige de son erreur en faisant agir sur son balancier, pendant un nombre suffisant d’oscillations, l’un ou l’autre de ces deux petits pendules auxiliaires. Cette horloge distribue l’heure à la minute à des cadrans distribués dans toutes les rues de Neuchatel, dans les édifices publics et même, moyennant une taxe, dans plusieurs maisons particulières.
Le principe de la distribution est très simple. L’horloge fait tourner un cylindre armé de pièces métalliques qui viennent, à la fin de chaque minute, fermer un circuit électrique. Aussitôt le courant passe dans chaque cadran, placé sur le circuit et y actionne un électro-aimant qui fait avancer d’une division, l’aiguille des minutes.
Pour des causes imprévues, il arrive, mais rarement, que le courant ne passe pas dans les cadrans d’un circuit. Les cadrans retardent alors d’autant de minutes que cet accident s’est renouvelé de fois. Mais l’horloger municipal y remédie en appuyant le même nombre de fois sur un bouton pour fermer le circuit trouvé en défaut. A chaque fois l’aiguille rattrape une minute pour indiquer finalement l’heure exacte.
Le lendemain 26, je passe la matinée à l’école d’horlogerie et dans les magnifiques ateliers de M. Hipp.
L’école d’horlogerie n’est pas très florissante en ce moment ; le nombre des élèves a diminué dans ces dernières années ; elle n’offre, d’ailleurs, rien qui ne se trouve à l’école du Locle, que nous visiterons bientôt.
Les ateliers de M. Hipp, sont consacrés à la fabrication des télégraphes et des appareils électriques. Ils sont connus du monde entier. Je m’y suis attaché surtout à l’examen des chronographes et des pendules, régulateurs, cadrans, horloges électriques.
Un peu avant midi, nous retournons à l’observatoire, M. Bérard et moi. Après avoir assisté à la comparaison des pendules, montres et chronomètres, nous prenons congé de M. Hirsch, en le remerciant de son gracieux accueil et nous rentrons à Neuchatel à 2 heures, pour prendre le train du Locle à 4 h. 13.
Le temps est devenu très beau. En passant une dernière fois devant le lac, si brumeux la veille, pour examiner le limnimètre de M. Hipp, nous éprouvons un saisissement indescriptible.
Des volées de mouettes, innombrables, flottent, crient, voltigent, bataillent sur les eaux resplendissantes, au-delà desquelles on croirait pouvoir suivre, avec la main, le profil immense de la chaîne des Alpes, sous les plis du manteau de neige qui la recouvre et étincelle aux yeux éblouis.
LE LOCLE.
Partis de Neuchatel le 26 à 4 h. 13 m. du soir, nous arrivons au Locle à 6 h. 30. Le 27, nous employons notre matinée à visiter l’école d’horlogerie dirigée par M. Grossmann.
Cette école parait très florissante ; elle compte 60 élèves environ, distribués en 6 cours ou 6 années différentes. L’enseignement y est à la fois pratique et théorique. Nous parcourons successivement les différentes classes.
1° La classe des ébauches ; c’est celle de première année ;
2° La classe des cadratures et mécanismes de remontoir ;
3° La classe des finissages ;
4° La classe des échappements. Les élèves y construisent les divers genres d’échappement : à ancre, à cylindre, à bascule, à ressort ;
5° La classe des repassages. Les élèves y font des repassages à remontoir, à clef, à chronographe, à seconde indépendante ;
6° La classe des réglages tenue par M. Grossmann.
Tout en enseignant dans leurs classes, les maîtres pratiques de l’école ont exécuté des pièces de démonstration, sur une grande échelle. La collection des engrenages, celle des échappements surtout, sont fort belles.
Mais l’école du Locle forme en même temps l’esprit et la main. En sortant des ateliers, les élèves se rendent dans les salles de cours. Les cours ont pour objet :
1re année : L’arithmétique, la mécanique expérimentale et la géométrie plane.
2e année : L’algèbre élémentaire jusqu’au 2e degré inclus avec les questions de maximum, les progressions et la géométrie dans l’espace.
3e année : La trigonométrie et la cinématique.
4e année : Les éléments de géométrie analytique et de statique.
5e année : Les éléments du calcul infinitésimal et de la dynamique.
Il y a longtemps que l’horlogerie marche sous le drapeau de la science ; cependant on est d’abord étonné de voir l’algèbre, la géométrie analytique, le calcul différentiel et intégral, la mécanique rationnelle figurer dans le programme d’une école de jeunes ouvriers. L’étonnement diminue lorsqu’on connaît M. Grossmann, Il n’est pas seulement artiste ; il est familier avec l’analyse et la mécanique. Il n’y a pas dans un chronomètre une seu1e pièce dont il n’ait soumis le mouvement au calcul algébrique, en tenant compte des frottements, des moments d’inertie, des moments d’élasticité, et en divisant le mouvement en autant de phases qu’il est nécessaire. En ce moment, il calcule les effets d’un échappement à ancre particulier, dont il a eu l’idée et où les deux pièces ancre et roue d’échappement fonctionnaient comme deux roues d’engrenage à développante de cercle. On conçoit qu’un tel directeur cherche à élever de plus en plus le niveau de son école et à former des horlogers capables, sinon de comprendre les finesses des mathématiques, du moins d’appliquer sciemment les règles qu’elles fournissent à leur art.
En quittant l’école d’horlogerie, nous avons à peine le temps de visiter quelques fabriques et nous prenons à midi et demi le train de Zurich.
ZURICH.
Le 27, à 10 h. 15 m. du soir, nous entrons dans la grande et belle gare de Zurich. Le lendemain matin nous visitons l’observatoire. C’est un vaste édifice, situé à l’extrémité et dans le haut de la ville, entouré d’un jardin.
Le directeur, M. Wolff, nous conduit d’abord à l’équatorial, un bon 6 pouces, logé sous une coupole qui recevrait aisément une lunette deux fois plus grande. Nous traversons ensuite une longue et belle galerie, où M. Wolff a établi un musée astronomique très intéressant, pour nous rendre aux salles méridiennes. Il y en a deux.
Les deux salles méridiennes forment une aile de l’établissement. La première est destinée aux élèves de l’Université ou du polytechnicum. Elle renferme une petite lunette, une pendule et des instruments météorologiques enregistreurs.
La deuxième salle méridienne est réservée exclusivement au directeur et à ses aides. On y voit une très belle lunette, une pendule de Mairet du Locle, une pendule électrique de Hipp, un chronographe à bandes de Hasler et un chronographe cylindrique de Hipp. Le mercure, pour le nadir, repose sur un pilier spécial établi sous le plancher entre les deux piliers de la lunette. Au moment d’observer le nadir, on découvre le pilier en enlevant la petite planche qui le recouvre. Nous remarquons, comme à Neuchatel, la largeur du lit d’observation. Cette salle est ornée de gravures et photographies de plusieurs astronomes. Un téléphone la met en communication avec l’équatorial.
Un cabinet spécial est affecté aux piles électriques et à la photographie.
Un amphithéâtre permet à M. Wolff de faire à l’observatoire même son cours d’astronomie aux étudiants.
Le reste du bâtiment est occupé par les logements spacieux du personnel.
Dans le jardin, nous trouvons les instruments météorologiques les plus usuels ; une lunette pour le public et 3 ou 4 piliers à théodolite pour les élèves.
En quittant l’observatoire, nous passons devant un magnifique palais, de construction récente ; c’est le polytechnicum, la grande école nationale de la Suisse. Des groupes nombreux d’étudiants, aux casquettes multicolores, vont et viennent, entrent ou sortent. Nous franchissons le seuil et nous apprenons du directeur que le polytechnicum compte annuellement de 600 à 800 élèves, venus de tous les cantons de la Suisse et même de l’étranger. L’enseignement roule sur les sciences pures ou appliquées, les mathématiques, la physique, la chimie, la mécanique, la technologie, l’architecture et les beaux-arts. Il a pour objet de former des ingénieurs, des savants et même des artistes. Nous demandons à visiter les salles de cours et les collections, dans l’après-midi et nous obtenons sans peine l’autorisation dont nous avons usé largement. Mais il serait trop long de décrire ici les richesses de ce grand établissement. J’ai tout admiré et spécialement la collection des mécanismes et des machines.
Dans la matinée du 29, nous visitons le bureau central météorologique de la Suisse, analogue au bureau central météorologique de France.
Le directeur du bureau, M. Fuchwillers, nous explique toute l’organisation et nous fait cadeau de quelques brochures. Le soir, nous jetons un coup d’œil sur la ville, son musée, son beau lac, ses bataillons de mouettes qui jouent avec les bourgeois et se disputent, au vol, les miettes du pain quotidien lancé par mille mains hospitalières.
Le 30, à 6 h. 20 du matin, nous partons pour Berne où nous arrivons à 10 h. 3.
BERNE.
Berne ne possède pas d’observatoire astronomique, mais un observatoire météorologique très bien organisé. Le bâtiment a des proportions monumentales. Le personnel et les instruments y sont logés grandement. Le directeur, M. Forster, nous montre successivement :
1° Son grand cabinet de travail ;
2° Deux salles contiguës où sont installés divers appareils séismiques, destinés à constater les tremblements de terre, leur direction, leur intensité ;
3° Un laboratoire d’électro-magnétisme ;
4° Une salle de balances ;
5° Une salle de chimie ;
6° La salle des enregistreurs : thermomètres, baromètres, hygromètre, pluviomètre, anémomètre ;
7° Un amphithéâtre pour le cours de physique et de météorologie, professé par lui aux étudiants de l’Université ;
8° La salle d’éclairage électrique. Une machine à gaz de 2 chevaux, ne dépensant que 40 c. à l’heure, actionne une bobine Gramme et toute la nuit l’observatoire est éclairé à la lumière électrique.
Le musée et le palais fédéral, les ateliers de Hasler, ne nous retiennent qu’un instant avant notre départ pour Genève, qui a lieu à 6 h. 25 m. du soir.
LAUSANNE.
Avant d’arriver à Genève, nous nous arrêtons avec le train, à Lausanne, à 10 h. 8 m. pour y passer la nuit. C’est à Lausanne que repose le maître illustre de mon compagnon de voyage. Violet-le-Duc, a voulu mourir au pied de cette vieille église gothique, sa dernière restauration, que nous visitons le lendemain, 1er décembre, à la pointe du jour.
A 9 heures, nous sortons de l’église, et du portail nous voyons le bateau qui conduit à Genève. Nous nous embarquons aussitôt, pour débarquer à 11 h. 55.
GENÈVE.
Les observatoires de Zurich et de Berne sont bâtis sur les limites de la ville, dans des positions élevées, et n’ont pas eu trop à souffrir jusqu’ici des constructions voisines, ni de la circulation insignifiante qu’elles produisent. Il en était de même pour l’observatoire de Genève, à l’époque de sa création. Mais aujourd’hui il est débordé de toutes parts et comme en pleine cité. La hauteur sur laquelle il se trouve lui permet à peine de dominer les maisons voisines et ne tient qu’à une faible distance le réseau des rues qui l’entourent.
L’observatoire est trop étroit pour loger son généreux et savant directeur, M. Plantamour. Nous sommes reçus par l’astronome adjoint, le Dr Meyer.
Le bâtiment central se compose, au rez-de-chaussée : d’une salle méridienne, d’un cabinet chronométrique, d’un cabinet météorologique, d’une bibliothèque ; au premier étage, de quelques chambres pour les aides et de deux coupoles.
La salle méridienne possède : une bonne petite lunette de 6 pouces avec excellente machine de retournement où tout est réglé et prévu pour la sûreté et la facilité de la manœuvre ; un grand niveau maniable mécaniquement, une pendule sidérale. M. Meyer a installé dans la boite de cette pendule, en évitant tout contact avec le mécanisme, un microphone qui envoie la seconde dans tout l’observatoire et l’enregistre même sur un chronographe. Il a pu, avec ce microphone, envoyer la seconde de sa pendule jusqu’à Vienne. Dans un coin de la salle, nous apercevons la pendule Repsold, qui a servi à Neuchatel et ailleurs pour les nombreuses déterminations de l’intensité de la pesanteur entreprises par M. Plantamour.
En sortant de la salle méridienne, nous traversons le cabinet chronométrique où se trouvent une vingtaine de montres déposées par les horlogers.
Le Dr Meyer nous conduit ensuite sous les coupoles où nous trouvons, dans l’une, un petit altazimut à lunette brisée ; dans l’autre, un petit chercheur de comètes de 4 pouces.
Autour du bâtiment central sont distribués trois pavillons ; deux, fort petits, abritent quelques théodolites, cercles divisés ou quelques piles ; et le troisième abrite un équatorial de 10 pouces. Ce bel instrument a coûté 45,000 francs ; il a été donné à l’observatoire par M. Plantamour. A notre grande surprise, le mouvement d’horlogerie est remplacé par une petite turbine qui fonctionne parfaitement. Avec cet équatorial, M. Meyer se propose d’exécuter un grand nombre de travaux divers. Il en a déjà tiré une étude intéressante, sur le système de Saturne, dont la première partie seulement vient d’être publiée dans les mémoires de la Société de physique de Genève. En quittant M. Meyer, nous sommes allés voir M. Plantamour. Je lui raconte ma surprise en présence de la turbine de son grand équatorial. Il m’assure que ce moteur est très suffisant dans la plupart des cas. D’ailleurs, a-t-il ajouté, on n’a pas de ressort à remonter et en tournant le robinet plus ou moins on règle le mouvement à volonté sur le soleil la lune ou les étoiles.
Le 2 décembre, nous visitons l’école d’horlogerie et l’Université. L’école d’horlogerie est un véritable monument, tout nouvellement construit. Les ateliers, les salles de cours sont magnifiques et en très grand nombre. L’enseignement pratique est le même qu’au Locle ; mais l’enseignement théorique vise moins haut. En revanche, l’école de Genève, possède deux ateliers complémentaires qui n’existent pas au Locle ; un atelier de mécanique et un atelier professionnel où les jeunes horlogers, en sortant de l’école, peuvent travailler pour le public, sous le patronage de la municipalité. Enfin, l’Université habite un palais que nous avons parcouru avec un plaisir infini en compagnie du recteur de l’année dernière, M. Hartman, savant distingué et professeur habile qui, après nous avoir accueilli gracieusement à son cours de physique, a bien voulu nous guider dans les belles salles, les riches collections, les musées, et nous présenter à plusieurs de ses collègues. Mais c’est au cours de M. Hartmann, lui-même que nous avons éprouvé l’impression la plus vive. Sur les bancs étaient assis une quarantaine de jeunes gens de 18 à 20 ans et au milieu d’eux, non réunies, mais dispersées çà et là, une quinzaine de jeunes filles du même âge. A travers ces visages si pleins de vie et de calme, n’ayant des yeux que pour le maître ou le cahier de notes, des oreilles que pour la parole limpide qui tombe de la chaire, nous cherchons, en bon français, à découvrir l’amour déguisé en étudiant, et nous ne découvrons que la grande âme de la Suisse. Nous nous rappelons qu’à Neuchatel, attirés le dimanche par une voix unique qui sortait à la fois de 2,000 poitrines d’hommes et de femmes de tout âge, nous n’avons surpris ni un regard, ni un geste qui ne fût pour le culte. Heureux peuple où la jeunesse des deux sexes peut s’épanouir sans danger, la main dans la main, pénétrée d’un égal respect pour la religion et pour la science.
Nous quittons Genève dans la soirée du 3 décembre. A cause de la brume, nous ne voyons pas les mouettes qui couvrent le lac de leurs bandes joyeuses, mais nous les entendons crier. C’est l’heure, en effet, où 3 ou 4 boulangers de la ville, apportent à ces oiseaux, le repas qui est servi par les passants.
La brume nous suit, en s’épaississant, jusqu’à Lyon où nous arrivons au milieu de la nuit.
LYON.
Nous avons cru utile, en rentrant en France, de passer par l’observatoire de Lyon, que le directeur, M. André, a disposé d’après les idées nouvelles.
Il n’est pas situé à Lyon même, mais à Saint-Genis, village voisin. Le terrain est très vaste, de 5 à 6 hectares et bien exposé ; l’horizon est entièrement libre de toutes parts. Nous l’avons visité deux fois le 4 et le 5 décembre.
Les constructions, encore inachevées, sont déjà considérables. Elles ont coûté plus de 350,000 francs. On compte dès aujourd’hui, à Saint-Genis :
1° La grande salle méridienne, fort bien conçue et outillée au grand complet, avec mires éloignées et mires voisines dans d’excellentes conditions. Ici, pas de trappes ; les deux versants du toit s’ouvrent entièrement et d’une seule pièce de part et d’autre de la ligne méridienne. Ils roulent sur un bon système de galets et la manœuvre est très facile. Nous prenons bonne note de ce dispositif ;
2° La petite salle méridienne, pour les élèves astronomes.
3° Le pavillon météorologique, pourvu de tous les enregistreurs connus ;
4° Le pavillon d’un petit équatorial de 6 pouces ;
5° Le pavillon d’habitation du directeur ;
6° Le pavillon d’habitation des aides ;
7° La maisonnette du concierge.
Chaque pavillon possède un excellent sous-sol.
On doit construire, en outre et incessamment, le pavillon d’un grand équatorial de 16 pouces et une galerie souterraine, longue et profonde, pour des expériences d’optique, fort intéressantes, que poursuit M. André depuis quelques années.
En dehors de Saint-Genis, l’observatoire compte deux stations météorologiques, importantes, l’une à Lyon même, dans le parc de la Tête-d’Or et l’autre sur le mont Verdun.
Le 5 décembre, nous rentrions à Besançon, très satisfaits de notre voyage, chargés de renseignements, de notes et de croquis précieux.
II OBSERVATOIRES DE L’ALLEMAGNE, DE LA BELGIQUE ET DE L’ANGLETERRE.
Par sa lettre du 12 juin 1882, M. le Ministre de l’Instruction publique a bien voulu m’autoriser à visiter les observatoires chronométriques de Hambourg et Liverpool, pour étudier l’organisation intérieure de ces établissements et recueillir tous les renseignements possibles sur la fabrication des chronomètres dans les deux grandes villes maritimes de l’Allemagne et de l’Angleterre.
J’ai quitté Besançon le 5 août. J’étais muni de la lettre ministérielle qui devait m’ouvrir toutes les portes officielles et de quelques recommandations bienveillantes de MM. Faye, Lœwy, Villarceau et Mascart pour plusieurs savants étrangers.
Je me suis d’abord rendu à Hambourg en passant par l’observatoire de Strasbourg, l’Université de Heidelberg et l’observatoire de Berlin ; puis à Liverpool en passant par les observatoires de Bruxelles et de Grennwich.
Partout j’ai été bien accueilli. Je rentrais à Paris le 30 août très satisfait d’un voyage dont voici le résumé rapide.
Je pars de Besançon à 3 heures 52 minutes du matin, le samedi 5 août 1882. Le train se dirige droit sur Belfort. Il remonte cette étroite vallée, gigantesque, aux bords dénudés et pittoresques, taillée à pic dans le roc, au fond de laquelle le Doubs coule tranquillement. Nous franchissons Baume-les-Dames, Clerval, l’Isle, Voujeaucourt, Montbéliard, Héricourt, avec leurs fabriques de fonte, de fer, de boulets, d’obus, d’horloges, de chronomètres, de tissus. A Belfort, changement de train.
A deux pas de là, à Petit-Croix, on n’est plus en France. Le cœur se serre à la vue des casques prussiens, de cette plaine alsacienne couverte de braves paysans et de belles maisons, de cette immense ville de Mulhouse avec ses fourneaux, ses usines, ses tissages, ses teintures, ses dessins industriels, ses cités ouvrières, ce canal qui réunit le Rhône au Rhin. De Mulhouse à Strasbourg, la tristesse se change en colère. La splendide et formidable chaîne des Vosges est à notre gauche, le Rhin est à notre droite à 12 ou 14 lieues. Les villages sont gros, drus, serrés, la population superbe, la richesse du sol éblouissante.
STRASBOURG.
L’observatoire de Strasbourg fait partie intégrante de cette grande Université née d’hier et dont l’éclat est si blessant pour des yeux français.
Il est très remarquable et certainement le plus beau de l’Allemagne.
Le directeur, M. Winnecke, recteur de l’Université pour la présente année 81-82, est gravement malade. Il a quitté Strasbourg, depuis quelques semaines déjà, accompagné de son astronome-adjoint, le Dr Schür. Je suis reçu par l’assistant, le Dr Hartwig. Il parle français presque aussi mal que moi l’allemand ; mais, avec de la bonne volonté, nous finissons par nous entendre passablement.
Pavillon de l’Equatorial.
La pièce principale est le pavillon du grand Equatorial formé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage.
Rez-de-chaussée. – On pénètre au rez-de-chaussée par une grande salle circulaire ornée avec luxe ; elle est destinée aux réceptions, réunions officielles, assemblées ou congrès d’astronomes. Autour de cette salle centrale rayonnent quatre autres salles plus petites, savoir :
1° La salle de travail pour les aides et élèves ; admirable par la propreté, la régularité, l’ordre et le classement des brochures, journaux et papiers divers.
Elle est fréquentée par 9 ou 10 étudiants en astronomie ou géodésie.
2° La bibliothèque purement astronomique et mathématique. Elle est riche en ouvrages de choix, remarquable par le soin extrême avec lequel les moindres brochures ou feuilles sont classées dans des cartons particuliers intitulés : Comètes, Planètes, Soleil, Etoiles, etc.
3° Le cabinet des instruments portatifs : Sextants, théodolites, boussoles, chronomètres, petites lunettes à main, etc. pour occultations, observations micrométriques des étudiants ; pour la physique, le magnétisme ou l’astronomie pure.
4° Le cabinet du Directeur, actuellement fermé.
Toutes ces salles sont ornées de dessins et photographies, représentant des instruments, des phénomènes, des astronomes, des constructeurs.
Malheureusement les murs sont couverts de salpêtre et les peintures déjà assez endommagées. On applique en ce moment un procédé de dessiccation dont le succès me paraît douteux.
Du rez-de-chaussée, on se rend, par un vaste escalier, au premier étage, c’est-à-dire à la grande coupole qui abrite l’équatorial. La coupole et l’équatorial reposent directement sur la voûte de la salle centrale du rez-de-chaussée.
L’équatorial est un 18 pouces de 7 mètres de distance focale. Il est monté à la manière ordinaire, mais rempli de détails minutieux. Il porte trois niveaux différents pour assurer sa bonne installation. Pour établir l’uniformité de température, la lunette peut être ventilée au moyen d’un soufflet ordinaire par deux ouvertures pratiquées à ses extrémités. Des toiles métalliques spéciales s’opposent à l’entrée des araignées. Une fenêtre pratiquée dans le haut de la lunette permet de nettoyer intérieurement l’objectif.
L’astronome qui observe à cet instrument a tout sous la main et peut à la rigueur se passer d’aide. Il est assis sur un excellent siège qu’il peut faire mouvoir dans tous les sens sans se déranger, en agissant sur un mécanisme spécial ; il trouve, dans le haut du siège un véritable bureau contenant tout ce qui lui est nécessaire pour écrire et calculer. Il n’a qu’à presser deux boutons voisins de l’oculaire pour découvrir ou recouvrir les objectifs de la lunette et du chercheur. Il a, sous les yeux, un petit chronomètre battant la seconde et suspendu à la lunette ; un petit appareil spécial, inventé par M. Winnecke, lui donne l’angle parallactique de l’astre observé. Il peut régler à volonté la lumière qui vient tomber, d’une lampe sur le cercle de position. Sur une bande de papier, passant sous sa main d’un premier rouleau à un second, il inscrit les observations faites. Il peut encore, de sa place, faire tourner la coupole en pressant un bouton électrique : l’électricité, suivant l’appareil de M. Zimmermann, de Berlin, enclanche ou déclanche le poids moteur de la coupole. Enfin il peut arroser la coupole, en tournant un robinet et produisant une pluie artificielle qui détruit les ondulations de l’air pendant les chaudes soirées de l’été. L’équatorial est mis en mouvement par un régulateur conique, à verges, de Repsold.
La coupole est éclairée par des becs de gaz américains qui permettent de masquer la flamme, sans l’éteindre, opération indispensable pour les recherches des astres très faibles. Dans une niche, une tablette vitrée éclaire en dessous la feuille de papier sur laquelle on dessine les nébuleuses. Toutes les précautions sont donc prises pour que l’œil de l’astronome conserve entièrement sa sensibilité.
La coupole s’ouvre de deux côtés à la fois. Elle est reliée à un paratonnerre par un contact à frottement pour conjurer la foudre qui pourrait, comme à Vienne, arracher et briser l’instrument.
Tout autour de la coupole, règne extérieurement une galerie circulaire, sorte de balcon qui est fort bien utilisé. On y voit, en effet, un petit chemin de fer sur lequel peut circuler un chercheur de comètes, et de distance en distance, quatre ou cinq bornes ou piliers de théodolite pour exercer les élèves. La monture du chercheur de comètes est curieuse ; c’est une chaise ordinaire sur laquelle l’observateur est assis et roule en chemin de fer. La lunette est portée par le dossier de la chaise et pivote autour de l’oculaire.
Au dessous de cette galerie circulaire se trouve une sorte d’entre-sol de même forme. Cet entre-sol est divisé en plusieurs petites cellules ou cabinets dans lesquels se trouvent : lampes, registres, cartes célestes, catalogues et généralement tout le matériel d’observations courantes. C’est là que sont installés un ou deux grands poëles à gaz et que viennent se chauffer de temps en temps, en hiver, les observateurs du grand équatorial et du petit chercheur. Tout le matériel est d’abord soigneusement rangé dans des petits buffets ressemblant à des stalles de chanoine et adossés à la paroi circulaire de l’entre-sol.
Sans l’humidité des murs, une grande pendule normale serait déjà placée là, réglant toutes celles de l’établissement par synchronisme.
Nous ne quitterons pas ce pavillon sans lui adresser quelques critiques. En hissant l’équatorial et sa coupole au premier étage, on a cherché uniquement un effet d’architecture et on a rencontré fatalement deux inconvénients graves. L’instrument, malgré les précautions prises à grands frais par l’architecte, est loin d’être stable, et son élévation même exige l’arrosage de la coupole. N’eût-il pas mieux valu le faire reposer directement sur le sol et entourer la coupole de gazons avec arbustes. Enfin, le pied de l’équatorial lui-même nous a paru un peu faible pour le poids qu’il supporte.
Pavillon des salles méridiennes.
Il y a deux salles méridiennes réunies en un seul pavillon.
La première salle est destinée aux élèves : on y voit une lunette de Cauchoix de 4 pouces, semblable à la lunette de Gambey à Paris ; une mauvaise pendule de Petit (Paris) dont la compensation est très défectueuse. Quelques thermomètres, placés aux fenêtres, extérieurement, se lisent de l’intérieur, à l’aide de petites lunettes. La trappe méridienne est ordinaire. Cette salle est beaucoup trop grande pour son usage.
La deuxième salle de même grandeur est réservée aux astronomes. On y voit un très beau cercle méridien de Repsold, muni de quatre collimateurs, dont deux dans la direction du méridien et deux autres suivant l’axe de rotation de la lunette.
L’usage des deux premiers se combine à celui de la mire et à l’observation des étoiles pour déterminer sûrement les erreurs instrumentales. Les deux autres collimateurs servent à déterminer les inégalités des tourillons, l’axe de rotation formant lunette dont la croisée des fils est pointée dans ces deux collimateurs.
A cause de l’humidité qui ruisselle le long des murs, les collimateurs sont renfermés dans des étuis de bois et le cercle méridien lui-même est recouvert par une grande vitrine roulant sur rails.
On observe les étoiles par réflexion, sur le mercure, au moyen d’un remarquable appareil à bascule.
Les observations s’inscrivent au chronographe de Hipp et sont relevées au moyen du releveur d’Appolzer.
Sans sortir de la salle méridienne, l’observateur peut ouvrir et fermer électriquement la porte de la mire ; celle-ci est éclairée par un miroir qui reçoit une lumière de la salle. Cette lumière sort de la salle par une fenêtre et y rentre par une autre, pour pénétrer dans la lunette méridienne.
Sur les ailes du pavillon méridien s’élèvent deux petites tourelles qui abritent, l’une un altazimut, l’autre un chercheur de comètes.
Altazimut.
La lunette de l’altazimut est un bon 4 pouces à court foyer. La graduation en azimut est tracée sur la face inférieure du cercle, pour éviter tout dépôt de poussière. Un mécanisme commode et élégant permet de manœuvrer à volonté le grand niveau. Un excellent système de contrepoids atténue les frottements. Les portes de la mire s’ouvrent et se ferment aussi électriquement à l’aide d’un bouton voisin de l’instrument. Une seule lampe, à l’aide de prismes et de réflecteurs, éclaire toutes les divisions du cercle et du niveau.
Chercheur de comètes.
C’est un petit équatorial de 4 pouces dont la monture présente, outre les 2 axes ordinaires, un 3e axe permettant de diriger à volonté l’axe de déclinaison, de manière à le rendre perpendiculaire au plan de l’orbite d’une comète. Une fois cet axe de déclinaison pointé normalement au plan d’un orbite, il reste dans cette situation, entraîné par le mouvement d’horlogerie et on peut, par un mouvement à la main de la lunette autour de cet axe, trouver facilement la comète cherchée.
Pavillon de l’héliostat.
Un petit pavillon spécial renferme un héliostat que je n’ai pas vu et qui était emballé pour le prochain passage de Vénus, la mission de Strasbourg allant à Brahia-Blanca (près de Buenos-Ayres) Amérique.
Tous ces instruments ont été construits à Hambourg, par les fils du célèbre Repsold, que nous rencontrerons plus tard à Berlin.
Tous les pavillons de l’observatoire correspondent entre eux par des galeries couvertes. Des pavillons d’habitation ont été construits, dans le voisinage de l’observatoire, pour loger le directeur et tout son personnel.
En quittant Strasbourg, je visite rapidement l’Université de Heidelberg et la ville de Francfort : je descends le Rhin de Mayence à Cologne en jetant un coup d’œil sur l’Université de Bonn. De Cologne je me rends sans arrêt à Berlin où j’arrive le 13 août.
BERLIN.
L’observatoire de Berlin est bien au-dessous de celui de Strasbourg, comme bâtiments, matériel et outillage. Le directeur, M. Forster, est en vacances, mais son adjoint, M. Knarre, me montre tout en détail.
Salle méridienne.
La salle méridienne est petite et n’a rien de particulier. La lunette est un 7 pouces et demi de Pistor et Martins. Les thermomètres extérieurs se lisent du dedans à l’aide de petites lunettes comme à Strasbourg. – Le niveau de la lunette ressemble aux niveaux français, mais son éprouvette présente un détail intéressant. La vis micrométrique, au lieu de se terminer par une pointe reposant sur le plan fixe, se termine par une patte qui repose sur deux petites billes sphériques, en agathe, placées librement sur le plan. Lorsqu’on manœuvre cette vis on n’a pas à craindre que sa pointe raie et détériore le plan ; on déplace seulement la position des billes.
Equatorial.
L’équatorial est en réparation. Il est ancien et célèbre ; c’est celui qui a servi à Gall et d’Arrest, pour trouver Neptune, la fameuse planète de Le Verrier.
La coupole se meut, comme à Strasbourg, sous l’action de poids ; mais c’est l’observateur et non l’électricité qui les déclanche et enclanche sans trop de peine.
Altazimut.
Il est de Pistor et Martins, bien inférieur à celui de Repsold à Strasbourg. La lunette est coudée comme dans le petit altazimut de Neuchâtel.
Pendules et chronographes.
Les observations du temps s’inscrivent comme à Strasbourg, sur un chronographe ; mais ce n’est plus le chronographe de Hipp qui est employé ; c’est celui de Fuess. La plume de Hipp y est remplacée par une pointe qui fait un trou, ce qui paraît bien meilleur au premier abord et plus précis, mais à la condition toutefois que la position des trous ne soit pas rendue douteuse par leur petitesse même, comme sur les papiers d’enregistrement que j’ai recueillis à Berlin.
Pendule normale. – Cette pendule a été installée avec les plus grandes précautions au fond d’une cave. On a soin de tenir toujours la porte de la cave bien fermée pour que la température ne varie pas autant que possible. La cave est sèche et peu profonde, de 5 à 6 mètres au plus. On a enfermé la pendule normale dans le vide d’un cylindre de verre.
On peut varier à volonté le degré de vide et un dispositif spécial permet de suivre jour par jour la constance ou les variations de l’amplitude des oscillations du balancier.
Il paraît que cette pendule est excellente et possède une marche supérieure ; aussi gouverne-t-elle par synchronisme toutes les autres pendules répandues dans les diverses salles de l’Observatoire. Le mode de synchronisation se présente sous une forme inverse de celle usitée en France ; le balancier porte une bobine creuse, traversée par un axe fixe en fer doux, tandis que chez nous la pièce en fer doux termine le balancier et oscille au-dessus de la bobine fixe.
Toutes les observations se font au chronographe, ainsi que la comparaison des pendules. La comparaison se fait même automatiquement, deux fois par jour, sans le secours de personne, à 3 h. 1/4 après midi et à 3 h. 1/4 du matin. Le dispositif qui réalise cette comparaison automatique est beaucoup trop compliqué pour trouver place ici.
HAMBOURG.
L’observatoire de Hambourg se compose de deux établissements, le Seewarte et le Sternwarte, le premier consacré à la météorologie maritime, le deuxième à l’astronomie et à la chronométrie, mais tous deux sous la direction unique de M. Neumayer.
SEEWARTE. – Le bâtiment est rectangulaire : cour intérieure, deux étages avec galeries, le tout neuf et luxueux. Nous sommes reçus par M. Neumayer qui nous fait visiter en détail : appareils enregistreurs de tout genre et de toute forme, bibliothèque, musée maritime, salles d’expériences, atelier de photographie pour nuages, cabinet de lecture, bureau de calcul.
Dans la cour intérieure, un arbre horizontal peut être mis en rotation par une machine à gaz. Ce[t] arbre sert à la graduation des anémomètres et à évaluer l’influence du mouvement du navire sur la marche d’un chronomètre.
Le Seewarte est superbement élevé sur une hauteur qui domine la ville et le port. Elle est en relation avec tous les observatoires de l’Allemagne et de l’Europe. Elle a un poste d’observateurs à l’embouchure de l’Elbe, chargés de lui signaler l’arrivée des fortes marées. Au premier signal, elle avertit les marins du port qui tirent le canon d’alarme ; aussitôt les Hambourgeois calfeutrent les caves et le rez-de-chaussée de leurs maisons. Bientôt un tiers de la ville sera submergé, mais les habitants n’en seront pas moins joyeux, ils pardonnent tout à l’eau qui fait leur fortune.
La tempête est aussi signalée par le poste de l’Elbe à la Seewarte qui avertit aussitôt les marins du port en dressant un grand mât à la cime de l’Observatoire.
STERNWARTE. – Le Sternwarte est formé de deux bâtiments : le bâtiment astronomique et le bâtiment chronométrique. Il est à peu de distance du Seewarte dans une position moins belle, mais bonne cependant et assez isolée.
1° Bâtiment astronomique.
L’astronome, M. Rumker, est absent ; nous sommes reçus par son aide, M. Seitzman qui nous fait visiter les différentes salles.
La bibliothèque est bien fournie en ouvrages astronomiques les plus variés et les plus utiles ; rien n’y manque.
La salle méridienne renferme une lunette de Repsold de 4 pouces et aussi un cercle méridien de 4 pouces 1/2 du même constructeur.
Je trouve dans cette salle, les deux fils de Repsold occupés à réparer le cercle méridien. M. Seitzman nous invite au silence, car l’heure à donner aux navires du port va bientôt sonner.
Il s’assure télégraphiquement si le fonctionnaire chargé de recevoir ce signal est à son poste et, quelques instants après, à 0 h. 0 m. 1 s., temps moyen de Greenvich, il appuie l’index sur un bouton. Le signal est donné. Une grosse boule de cuivre est tombée dans un bassin par déclanchement électrique. A ce moment, le fonctionnaire du port et tous les marins, avertis par lui quelques minutes à l’avance, ont noté l’heure de leurs chronomètres. Ils ont ainsi la correction à ce moment en temps de Greenvich. Lorsqu’ils passeront à Greenvich, ils auront, en comparant de nouveau leurs chronomètres au temps de l’observatoire, un excellent contrôle si la marche de leur chronomètre est connue ou cette marche même dans le cas contraire.
L’Equatorial est un 9 pouces 1/2 construit par Repsold père ; le verre est de Shrœder.
Il présente un dispositif particulier pour le micromètre. La tête de la vis micrométrique porte en relief le nombre de tours et fractions de tours correspondant à un index sur lequel s’enroule une bande de papier. En appuyant au moyen d’un levier l’index sur la tête de vis, on imprime le nombre sur la bande de papier.
Le régulateur de l’équatorial est un mouvement d’horlogerie avec simple régulateur à boules.
La monture est à tringles comme à Greenvich et à Liverpool.
Chercheur de comètes.
Il y a aussi à Hambourg, un joli petit chercheur de comètes, monté simplement comme à Strasbourg et pouvant circuler sur une terrasse.
Une pendule normale, dans le vide et dans une cave, comme à Berlin, synchronise toutes les pendules de l’Observatoire. Les secondes de toutes ces pendules peuvent être envoyées sur un chronographe de Fuess, ainsi que les instants des observations et l’heure des chronomètres que l’on voudrait comparer à la pendule normale.
Après cette visite, M. Seitzmann nous conduit au pavillon chronométrique, où nous sommes reçus par le Dr Baltermann, aide de M. Neumayer. Ce pavillon est seulement à quelques pas du pavillon astronomique.
Il a reçu le nom de Seewarte Abtheilung.
Chronométrie.
Le Dr Baltermann nous montre les deux petites salles qui forment l’Abtheilung.
1° Dans la première se trouve une bibliothèque chronométrique, où nous remarquons les publications périodiques, telles que The horlogical journal (London).
Annales hydrographies, and maritime météorologie (Berlin).
Revue chronométrique de Saunier (Paris).
Uhrmakerkunst (Leipzig).
Deutsche altmaker zeitung (Berlin).
Journal d’horlogerie (Genève).
Bulletino della sociéta chronomético-mécanica (dome) (alti les Cappaccini).
Une vitrine renferme environ 15 chronomètres suivis à la température ordinaire.
Nous y voyons encore quelques grands modèles des principaux échappements construits par N. Knoblet horloger de Hambourg, et quelques essais pour étudier l’influence du magnétisme sur les chronomètres.
La seconde salle renferme une grande étuve, partagée en deux parties. Chaque partie est isolée de l’autre par une cloison et peut être portée à une température qui lui est propre, au moyen de becs de gaz.
Il y avait dans cette sorte de vitrine-étuve près de 35 chronomètres.
Enfin, nous descendons à la cave, d’ailleurs peu profonde, où se trouve une troisième étuve, une étuve à glace. C’est une sorte de cabine fort étroite. Le plafond est en zinc, et sur ce zinc est accumulée extérieurement une grande quantité de glace qui s’introduit par un trou, pratiqué dans le sol du rez-de-chaussée des deux pièces précédentes.
La température, malgré la glace, descend rarement au-dessous de huit ou neuf degrés en été, dans l’intérieur de la cabine.
On peut déposer là 25 ou 30 chronomètres, mais il n’y en avait aucun au moment de notre visite.
Il faut prendre les plus grandes précautions avec le gaz dans les étuves, pour ne pas renouveler une explosion désastreuse qui a déjà eu lieu et avec l’eau de la glacière, pour ne pas mouiller les instruments.
On compare les chronomètres : 1° à la pendule normale du pavillon astronomique en envoyant leur seconde sur le même chronographe de ce pavillon ; 2° à une pendule située dans la deuxième pièce de l’Abtheilung et synchronisée par la pendule normale de la cave du pavillon astronomique.
Cette comparaison dure 15 minutes ; elle s’opère doublement, à l’ouie et au chronographe.
Les horlogers paient 20 marcs pour un chronomètre suivi à différentes températures et 10 marcs pour un chronomètre suivi seulement à la température ambiante. Ils reçoivent un bulletin de marche.
C’est là que M. Anvers a fait suivre 20 chronomètres pour l’expédition de Vénus. Habituellement on se sert peu de la glacière, c’est un tort. En revanche, on suit beaucoup la marche du chronomètre de l’hiver à l’été et de l’été à l’hiver parce qu’alors la température varie beaucoup.
Les Allemands construisent à peu près tous leurs chronomètres. Ils suivent le procédé de la fabrication anglaise dont nous parlerons plus tard. Tous les ans, en hiver, il y a, à Hambourg, un concours de chronomètres entre les horlogers allemands.
BRUXELLES.
L’observatoire de Bruxelles n’offre rien de curieux au point de vue chronométrique, mais l’astronomie et la météorologie y sont bien représentées.
Mentionnons : l’enregistreur universel de Van Rysselberge construit par Schubart de Gand, la lunette de 10 à 12 m. de longueur, pour photographier le soleil ; un énorme chronographe ayant coûté 10,000 fr., sans compter un supplément de 1,500 fr. pour quelques modifications ultérieures à l’acquisition ; la lunette méridienne de passage (5 pouces), le cercle mural de Gambey (4 pouces), un cercle méridien de Repsold, analogue à celui de Strasbourg, un petit équatorial de 4 pouces, de Repsold, et un de 3 pouces de Througthon.
Les enregistreurs magnétiques sont remarquablement installés dans les caves de l’établissement.
Enfin, des salles nombreuses et commodes sont affectées à la bibliothèque, aux expériences de physique, aux bureaux de l’administration.
En résumé, nous trouvons là une bonne installation dans son ensemble. Mais l’observatoire, isolé autrefois, est envahi aujourd’hui par les agrandissements de la ville et son transfert, qui coûtera 2 millions, aura lieu prochainement sur un terrain assez éloigné, où se trouve déjà installé, par avance, un magnifique réfracteur de 18 pouces.
GREENWICH.
Nous commençons notre visite à l’observatoire de Greenwich, par la salle des chronomètres.
L’observatoire ne reçoit pas, à l’étude, les chronomètres de poche, mais seulement les grands chronomètres de marine.
Les chronomètres sont soumis à l’épreuve du chaud et du froid, pendant 28 semaines ; l’Etat choisit et achète les meilleurs produits.
J’ai trouvé là, 46 chronomètres particuliers de MM. Isaac, Werqvter, Hennessy, Sewil, Sepherd, Partkinson, Mercer, Moore, Nelson, Lyster, Heys, Poott, et 60 chronomètres de l’Etat.
Nous visitons ensuite les instruments astronomiques et météorologiques.
L’altazimut a été construit surtout pour observer la lune, vers la néoménie, lorsqu’il est difficile de la prendre au méridien.
Cet altazimut est en mauvais état et bien inférieur à celui de Hambourg ; il paraît abandonné en ce moment.
Les autres instruments : cercle méridien de 12 pouces, équatoriaux n’ont rien d’extraordinaire. Le grand équatorial 12 pouces, est même fort mal inventé et entretenu, monture ancienne avec tringles, comme celui de Henri, et turbine pour faire marcher la lunette.
Le chronographe a servi de modèle à celui de Bruxelles. Tout cet outillage répond mal à l’idée que l’on se fait, à distance, du célèbre observatoire de Greenwich.
La météorologie est un peu mieux installée et au grand complet, avec le magnétisme ; mais tous les bâtiments en sont mal ordonnés, faits de pièces et morceaux.
Greenwich envoie l’heure à toute la ville de Londres pour les services publics et donne un signal au port, à midi précis, avec une grosse balle qui tombe par déclanchement électrique. Cette balle est installée sur la terrasse de l’Observatoire qui domine la Tamise.
Pour me rendre compte de la fabrication anglaise, je me suis rendu chez les deux premiers artistes de Londres ; Mercer et Kulberg.
M. Mercer est un ouvrier émérite qui travaille beaucoup et même trop ; près de 18 heures par jour, dans les moments de presse. Aussi sa santé en souffre parfois et au moment de notre visite il était à la campagne, à Saint-Alban, pour prendre un peu de repos. Nous fûmes reçus par son premier contre-maître.
L’atelier se compose de deux pièces seulement fort petites. Dans l’une travaillaient trois ouvriers et dans l’autre deux seulement. Le contre-maître, en réponse à nos questions, nous explique que la fabrication de M. Mercer était répandue ça et là dans toute la ville de Londres ; qu’il avait environ 200 ouvriers travaillant pour lui au sein de leur famille et confectionnant toujours la même pièce.
M. Mercer se réserve personnellement l’assemblage des pièces et la dernière main d’œuvre du chronomètre. Il fabrique ainsi environ 4 chronomètres de marine par semaine et en met toujours 3 douzaines à la fois sur chantier. L’ébauche se fait mécaniquement et le finissage à la main de Mercer, lui-même, seul et caché ; mais nous voyons là un excès de précautions inutiles.
Les chronomètres sont ensuite déposés à Greenwich gratuitement ou à Liverpool moyennant un droit léger.
Chez M. Kulberg, nous trouvons le même mode de fabrication et les mêmes renseignements.
Un bon chronomètre de marine ou de poche se vend de 40 à 50 livres sterling.
LIVERPOOL.
J’arrive à Liverpool vendredi 25 août 1882.
L’observatoire de Liverpool est peu connu ; cependant il est le premier des observatoires chronométriques. Il a été transféré en 1865 de la ville dans sa situation actuelle à Bidston à une distance de 5 à 6 milles environ. Il est dirigé par M. Hartnup, habile praticien, assisté de son fils. M. Hartnup ne parle nullement le français, mais heureusement son fils a pu nous servir d’interprête avec une grande intelligence. J’ai été admirablement reçu par ces deux astronomes.
L’observatoire de Liverpool-Bidston a coûté 600 livres sterling, soit 150,000 francs pour la construction seulement. L’architecte se proposait d’abord d’employer la brique, mais il a trouvé une belle et bonne pierre, en faisant les fondations sur le mamelon de Bridston, dominant Liverpool ; il a été heureux de s’en servir et a réalisé à peu de frais un splendide monument quoique assez petit. Tout est solide, propre, agréable et bien disposé.
Rez-de-chaussée. On pénètre dans l’observatoire par une vaste anti-chambre occupée par un garçon de service suffisamment lettré pour tenir quelques registres et faire de la copie. A la suite est une belle et vaste salle où l’on voit fort bien disposée une grande vitrine-étuve renfermant environ 50 chronomètres de marine. Cette vitrine repose sur un plancher spécial, au-dessous duquel, dans le sous-sol, sont allumés des becs de gaz à volonté. On évite ainsi toute chance d’explosion dans la vitrine même.
Avant l’adoption de ce dispositif, on chauffait la vitrine comme à Hambourg, en faisant arriver le gaz directement sous cette vitrine, mais on avait soin de l’envelopper d’une toile métallique pour éviter toute explosion ; c’est-à-dire qu’on employait des becs Humphry Davy.
Dans cette même salle se trouve un baromètre enregistreur et deux grandes pendules A et B.
L’une des pendules, A est synchronisée par la pendule normale que nous verrons bientôt et sert à la comparaison des chronomètres qui se fait avec un chronographe.
La pendule B sert à envoyer un signal au port de Liverpool ; tous les jours on la met à l’heure exacte en ajoutant ou en ôtant des petits poids à son balancier. 10 grains anglais font varier l’état de cette pendule de 1 heure en 24 heures.
A une heure précise du soir, cette pendule lance une étincelle électrique dans la poudre d’un canon établi sur le port. Ce signal sert aux marins de Liverpool absolument comme la balle de Greenwich ou le boulet de Hambourg.
La température ambiante de cette salle ne varie guère que de 70 à 85° Fahrenheit.
Le reste du rez-de-chaussée est occupé par les splendides appartements de M. Hartnup.
Sous-sol. – Nous descendons au sous-sol qui est très confortable et se compose de deux grandes salles.
La première salle est directement au-dessous de la grande vitrine-étuve que nous venons de visiter. Le plafond est construit en planches étagères à jour et la chaleur du gaz qui brûle au-dessous le pénètre facilement pour arriver jusqu’à l’étuve supérieure, sans aucune crainte d’explosion dans cette dernière dont le fond est hermétiquement fermé.
Cette salle renferme plusieurs appareils de physique, des piles électriques et des instruments sans grande importance.
A la suite est une deuxième salle un peu plus basse où sont disposés environ 30 chronomètres. Cette salle est à une température à peu près constante 58° Fahrenheit. Elle tient pour ainsi dire lieu d’une glacière qui manque à Liverpool, car la marine anglaise vogue surtout dans les mers chaudes. On voit dans cette salle une pendule, destinée à la comparaison des chronomètres et synchronisée par la pendule normale et une pendule spéciale, combinée par M. Hartnup, pour marcher dans une caisse à pression constante.
Les noms des fabricants que nous lisons sur les chronomètres ne sont pas ceux que nous avons lus à Londres, à l’observatoire de Greenwich. Aussi, nous croyons d’abord que Liverpool est encore un grand centre de fabrication, mais M. Hartnup me fait observer qu’à Liverpool il n’y a guère que deux ou trois fabricants sérieux, les autres sont des marchands qui mettent audacieusement leurs noms sur des chronomètres fabriqués à Londres, pour leur propre compte.
Il déplore ces procédés, qui enlèvent toute responsabilité aux véritables fabricants, et tendent à abaisser la valeur des produits à un degré qui commence déjà à inquiéter la marine.
Premier étage.
Nous quittons le sous-sol pour traverser de nouveau le rez-de-chaussée et nous élever jusqu’au premier étage, où nous trouvons la bibliothèque, le cabinet de travail de M. Hartnup, celui de son fils et une grande salle d’expérience. Dans le cabinet de travail de M. Hartnup se trouve la pendule sidérale normale qui synchronise la pendule de la lunette méridienne et celle de l’équatorial ; en outre des pendules que nous avons déjà rencontrées. Le système de synchronisation est celui que j’ai trouvé à Hambourg et à Berlin. Près de cette pendule sidérale, se trouve le chronographe américain de Boudesson, de Boston, qui a aussi construit la pendule sidérale et une curieuse pendule de gravitation dont la description serait ici déplacée et inutile.
Terrasse et coupoles. – Au-dessus du premier étage, j’admire deux belles coupoles séparées par une terrasse. L’une de ces coupoles abrite la lunette méridienne et l’autre un équatorial.
La terrasse donne asile à la météorologie.
Lunette méridienne.
C’est un petit 4 pouces qui n’offre rien de particulier et qui a été transféré avec l’observatoire de Liverpool à Bidston ; une pendule synchronisée l’accompagne. C’est la première fois que je vois une lunette méridienne abritée sous une coupole. La lunette est fort petite, à peine suffisante pour la chronométrie ; la coupole est belle ; elle a près de 10 mètres de diamètre. Elle est destinée à recevoir plus tard un équatorial proportionné à ses dimensions.
Trois piliers formant l’équerre permettent d’observer avec la lunette, soit dans le méridien pour obtenir l’heure, soit dans le premier vertical pour obtenir la latitude.
Equatorial.
L’autre coupole, de même dimension, abrite un bel équatorial, l’objectif a 8 pouces de diamètre et 12 pieds de distance focale. Les cercles ont été divisés par Througton et Siemens. La monture est curieuse ; elle consiste en un gros cylindre dirigé suivant l’axe du monde et pouvant tourner sur lui-même au moyen de pivots qui le terminent. Ce cylindre est coupé longitudinalement en deux moitiés égales reliées à leurs extrémités et assez espacées pour recevoir, dans leur intervalle, l’axe de déclinaison de la lunette perpendiculairement à leurs génératrices. Ces deux moitiés de cylindre, à base circulaire, sont creuses et construites en tôle épaisse.
Cet instrument vient, comme la lunette méridienne, de l’ancien observatoire où il était mû en ascension droite par une turbine, comme celui de Genève. Il est mû actuellement par un mouvement d’horlogerie avec régulateur à boules.
On l’emploie à l’observation des petites planètes et des comètes.
Météorologie.
Entre les deux coupoles se développe une terrasse sur laquelle sont installés la plupart des instruments météorologiques enregistreurs : anémomètre, pluviomètre, hygromètre, thermomètre, etc., mais je ne m’arrêterai pas à la description de ces appareils quoiqu’ils diffèrent presque toujours, par les détails d’un observatoire à l’autre.
Avant de quitter l’observatoire, je cause longuement avec M. Hartnup. M. Hartnup m’entretient des difficultés qu’il éprouve à faire tenir un registre, pour les marches des chronomètres, aux officiers de marine. Ce registre pourrait donner des indications précieuses dans les voyages où l’on passe aux températures extrêmes. M. Hartnup a réussi cependant près des directeurs de la compagnie du Pacifique qui se sont intéressés à ses recherches.
III.OBSERVATOIRES DE BALE, MUNICH ET VIENNE.
M. le Ministre de l’instruction publique a bien voulu m’autoriser à visiter, surtout au point de vue chronométrique, l’exposition électrique internationale de Vienne de 1883, et subvenir aux frais de voyage. En allant à Vienne, j’ai visité les observatoires et établissements scientifiques de Bâle et de Munich ; en revenant à Besançon, je me suis arrêté à Zurich à l’exposition générale de tous les cantons suisses, dont la section d’horlogerie avait pour moi un intérêt tout particulier.
Voici le résumé de ce voyage relativement aux observations astronomiques. Quant à la description sommaire des appareils qui m’ont paru susceptibles de devenir pour les horlogers de Besançon soit des objets de fabrication, soit des moyens de perfectionner l’outillage actuel, ils feront l’objet d’une publication spéciale.
BALE.
Le 4 septembre, à 9 heures 48 minutes du matin, j’ai quitté Besançon pour Bâle. Je traverse sans le voir un paysage ravissant, caché sous une pluie épaisse et persistante qui permet à peine, à l’arrivée, à 4 heures 45 minutes du soir, de distinguer sur le fronton de la façade de la gare les grandes figures et médaillons de Newton, Humboldt, Laplace, Euler. Je cherche l’un au moins des trois Bernoulli, mais inutilement ; ils sont ailleurs.
Observatoire. – Le lendemain j’ai visité l’Observatoire qui fait partie d’un grand et magnifique Institut de physique et de chimie. Cet Institut est situé à l’une des extrémités de la ville et suffisamment dégagé des habitations voisines. Il est formé d’un seul monument. Je suis reçu de la manière la plus cordiale et la plus aimable par M. X..., professeur de physique, qui a fait construire l’établissement il y a quelques années et qui le dirige aujourd’hui ; nous parcourons ensemble successivement les principales salles et les laboratoires.
Rez-de-chaussée. – Le rez-de-chaussée se compose des pièces suivantes :
1° Un beau vestibule orné des bustes d’Euler et des trois Bernoulli ;
2° Un atelier pour la construction des appareils de physique. Cet atelier est tenu par un mécanicien et deux aides. On y fabrique la plupart des appareils dont l’Institut a besoin soit pour les cours, soit pour les recherches personnelles des professeurs ;
3° Salle de la machine à vapeur. Cette machine, entre autres fonctions, sert à actionner un générateur Gramme et à fabriquer la lumière électrique pour les expériences courantes et l’éclairage de l’établissement. On voit encore dans cette salle l’ancienne pile qui produisait autrefois la lumière et une turbine qui a servi d’abord à faire marcher le générateur Gramme.
4° Un beau laboratoire pour le préparateur de physique ;
5° Une splendide et immense salle pour les cours publics. Un dispositif, aussi simple qu’ingénieux, permet de faire l’obscurité seulement au moment précis où le phénomène étudié est bien projeté sur le tableau ; et de ramener la lumière à l’instant même où l’on enlève la projection. Le professeur dirige toute cette manœuvre, sans interrompre son enseignement, au moyen d’un bouton électrique qu’il tient à la main. Grâce à ce dispositif, on n’a pas à redouter à Bâle le trouble qui se produit quelquefois ailleurs dans l’auditoire lorsque la durée de l’obscurité, avec interruption de la leçon, dépasse mal à propos et souvent de beaucoup la durée du phénomène projeté.
6° Une petite salle de cours pour les étudiants inscrits ;
7° Salle des balances et des produits chimiques ;
8° Laboratoire de chimie pour les élèves (30 ou 40) ;
9° Laboratoire de chimie pour le professeur et son préparateur.
Premier étage. – On trouve au premier étage :
1° Un vestibule orné d’une vieille horloge à balancier et roue de rencontre. Cette horloge, très ancienne, est fort bien conservée ; elle fonctionne passablement et elle a une véritable valeur historique et scientifique ;
2° Le cabinet du directeur ;
3° Un grand et beau laboratoire de physique ;
4° Un deuxième laboratoire de physique presque aussi grand et aussi beau que le premier ;
5° Un cabinet de physique très beau et très complet ;
6° Une salle méridienne. Cette salle est vaste. On y trouve : une petite lunette méridienne portative avec cercle de déclinaison finement divisé et muni de deux microscopes ; un appareil à retournement ; un bain de mercure pour les observations nadirales ; le tout bien construit par la Société de physique de Genève ; une pendule sidérale ; une pendule moyenne de Knoblig de Hambourg ; une pendule électrique de Hipp. Mais la lunette est installée sur un support dont la stabilité est pour le moins douteuse et la ligne des trappes, vu la mauvaise orientation de la salle, coupe le plafond en diagonales. Le premier défaut est grave, le second n’est que disgracieux ; tous deux auraient été évités si, au lieu de construire un monument considérable d’un seul bloc, on avait adopté le système des pavillons isolés et séparés suivant la nature des services.
7° Cabinet de l’aide-astronome. Il est très agréablement disposé. Il renferme une petite bibliothèque astronomique, une collection d’une douzaine de globes célestes ou terrestres, grands et petits, en cuivre, en bois, en carton, construits à différentes époques par des artistes de Bâle ; les appareils météorologiques et une foule d’autres pièces moins importantes.
Coupole. – Le premier étage est surmonté d’une coupole qui abrite un équatorial de 7 pouces. L’instrument est muni d’un mouvement d’horlogerie et de tous les accessoires nécessaires à la photographie et à la spectroscopie célestes. Il a été construit par la Société de physique de Genève et revient à 20,000 francs environ. Il est installé sur un énorme pilier carré qui traverse l’Institut de bas en haut et qui a dû coûter à lui seul une grosse somme, suffisante peut-être pour bâtir isolément, de plain-pied, une salle méridienne, plus une salle équatoriale, où les instruments eussent été cent fois mieux. Mais il eût fallu renoncer au couronnement de l’édifice par une coupole et sacrifier un effet architectural aux besoins de la science !
Outre le grand public des curieux et des amateurs, l’Institut compte 40 élèves en physique et 35 élèves en chimie.
Université, Musées, Jardin zoologique. – L’Institut est uniquement consacré à la physique et à la chimie. L’astronomie s’y est implantée d’abord comme un complément nécessaire de ces deux sciences ; mais elle y a son existence propre depuis la construction de l’équatorial. Les autres sciences sont enseignées ailleurs, dans la vieille Université de Bâle.
Le Musée de la ville, remarquable par quelques toiles de Rembrandt, Teniers, Bèqem, quelques Suisses enluminés, et surtout par l’unique et abondante collection des œuvres de d’Holbein : esquisses, gravures, peintures religieuses, portraits, possède en outre des collections complètes d’histoire naturelle : zoologie, minéralogie et géologie.
Le Musée de la cathédrale est consacré aux antiquités du moyen âge. Après avoir vu beaucoup de fusils, de canons, de lances, d’arbalètes, d’ustensiles, de meubles, de tourne-broches gigantesques, d’instruments de musique et autres arts ou métiers, j’ai eu le plaisir d’y rencontrer une belle collection de sabliers, de vieilles horloges, de vieilles montres de tous les systèmes. Il y a là des matériaux précieux à consulter pour une bonne histoire de l’horlogerie, ouvrage qui est encore à faire et que j’entreprendrai peut-être un jour. J’aurais bien voulu pouvoir examiner intérieurement les vieux mécanisme[s] ; mais il n’y fallait pas songer pour le moment ; j’ai dû me contenter de lire les étiquettes et d’apprendre que plusieurs de ces pièces ont appartenu à des personnages célèbres, tel qu’Erasme de Rotterdam.
En sortant du Musée, sous le promenoir gothique de la belle cathédrale, on distingue parmi les grands noms inscrits sur les tombeaux celui de Jacob Bernoulli.
Enfin, le Jardin zoologique complète très utilement la série des grands établissements scientifiques de Bâle. Il rappelle ceux que l’on rencontre dans toutes les villes importantes d’Allemagne.
MUNICH.
Observatoire. – Lorsqu’en sortant de la gare de Munich, la plus belle du monde, disent les Bavarois, après celle de Stuttgard, on parcourt les nombreux monuments, les Musées, l’Université, les principaux boulevards, les places où règnent les statues de Humboldt, Schiller, Gœthe, Liebig, Fraunhofer, Schilling, on s’attend à rencontrer bientôt un grand observatoire, digne de la ville. La déception est complète ; l’observatoire est petit et mal outillé ; mais hâtons-nous de dire qu’il est situé à une assez grande distance de la ville, sur un terrain favorable aux améliorations et aux agrandissements sérieux que le gouvernement a résolu depuis longtemps déjà de réaliser. Je l’ai visité dans l’ordre suivant :
1° Bibliothèque. – La salle est un peu petite ; mais on y a réuni avec soin les principaux ouvrages et les meilleures collections astronomiques ;
2° Salle méridienne. – La lunette est un simple quatre pouces ; l’objectif est de Fraunhofer et le cercle de Reichenbach. La salle est de dimensions moyennes. Les pendules sont très ordinaires ;
3° Salle des collections instrumentales. – On trouve là un certain nombre d’instruments portatifs tels que théodolites, sextants, petits chercheurs, et notamment un cercle, avec niveau et machine à retournement, pour observer dans le premier vertical ;
4° Une salle de travail, assez grande, pour les aides ;
5° Une coupole abritant un petit altazimut à lunette coudée de Reichenbach ;
6° Une deuxième coupole, inoccupée ; car je compte pour rien la petite lunette d’amateur que j’y ai vue ;
7° Une grande coupole, en construction, destinée à un équatorial de douze pouces, commandé à M. Merz, de Munich, pour les verres, et à M. Repsold, de Hambourg, pour le mécanisme ;
8° Un pavillon magnétique, renfermant les boussoles ordinaires.
Enfin un corps de bâtiment spécial, dans lequel je n’ai pu pénétrer, est réservé aux logements du personnel.
VIENNE.
Observatoire. – L’observatoire est situé à l’extrémité nord-ouest de la ville, sur une petite hauteur qui domine la plaine où jadis ont campé les Turcs. C’est un palais à quatre coupoles au milieu d’un grand jardin. Je rencontre à la porte M. Gylden, directeur de l’observatoire de Stockholm ; nous entrons ensemble. La température du jardin me paraît différer très sensiblement de celle des salles d’observatoire. C’est un défaut grave qui tient au caractère monumental de l’établissement et qui aurait été facilement évité par la construction de petits pavillons distincts et isolés. Le directeur, M. Weiss, nous reçoit d’ailleurs d’une manière charmante et nous présente à M. Auvers, président du congrès astronomique international, alors réuni à Vienne. Je visite les instruments dans l’ordre qui m’est indiqué.
1° Grand équatorial. – L’instrument est véritablement admirable. L’objectif a 27 pouces de diamètre et le tube 34 pieds anglais de longueur. Le mécanisme, construit par Grubb, de Dublin, ne laisse rien à désirer. La coupole tourne avec facilité et un siège gigantesque permet à l’astronome de prendre, sans peine, toutes les positions possibles. J’admirais encore cette splendide lunette qui n’a de rivale que le grand réfracteur de Washington, lorsque je fus rejoint par M. Palisa, ancien directeur de l’observatoire de Pola, et le docteur Meyer, dont j’avais fait précédemment la connaissance à l’observatoire de Genève. M. Meyer se propose de terminer à Vienne, avec le 27 pouces, un travail sur Saturne, commencé à Genève avec l’équatorial de M. Plantamour ;
2° Equatorial de 12 pouces. – Fort bien monté, cet instrument sert surtout à M. Palisa pour la découverte des petites planètes et des comètes ;
3° Equatorial de 7 pouces. – L’objectif est parfait ; il est de Fraunhofer ;
4° Chercheur de comètes. – L’objectif est de 6 pouces. La monture est du système Villarceau ;
5° Une salle méridienne. – On n’y voit qu’une petite lunette méridienne de 4 pouces ; un petit cercle dans le premier vertical, de Reichenbach et Fraunhofer, avec objectif de 4 pouces et une très petite lunette méridienne coudée ;
6° Une salle de collection, renfermant un grand nombre de petits instruments portatifs : équatoriaux, héliomètres, théodolites, sextants ;
7° Une grande et belle bibliothèque.
Le reste de l’établissement est consacré aux logements de tout le personnel.
On remarque avec étonnement que l’Observatoire de Vienne n’est pas encore muni d’un grand cercle méridien, indispensable pour mesurer avec précision les positions des astres.
Intérêt historique et botanique, rareté et richesse patrimoniale, cohérence, continuité remarquable des activités chronométriques, astronomiques et météorologiques sur le site depuis la décennie 1880, justifient une protection au titre des Monuments historiques.
- station météorologique
- bureau
- laboratoire d'essais
- mire
- maison
- conciergerie
- garage
- stationnement
- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, Monuments historiques












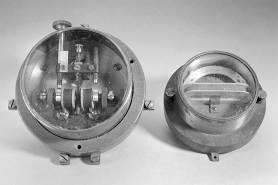








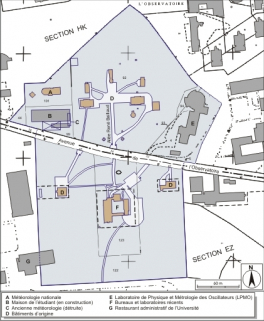
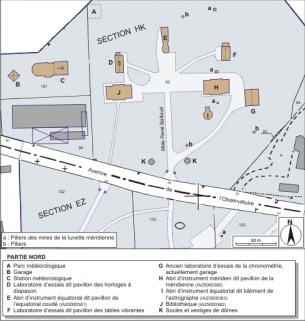
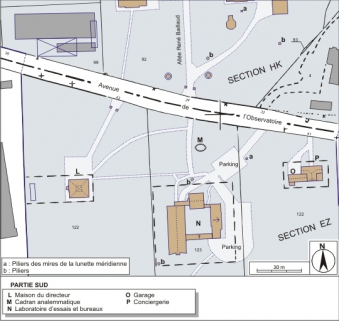
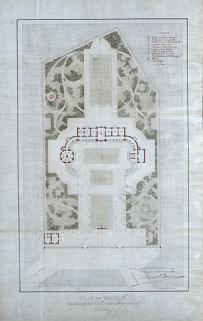
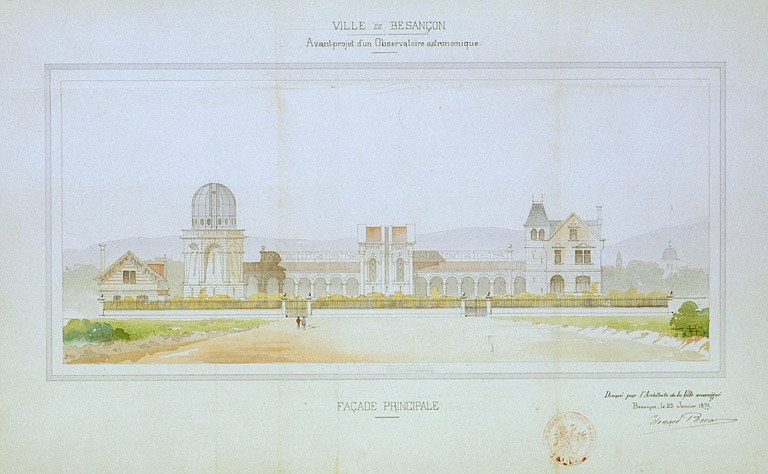
![[Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], [1881]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], [1881]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20052500001NUDA.jpg)
![Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, 1884. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, 1884. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20052500003X.jpg)
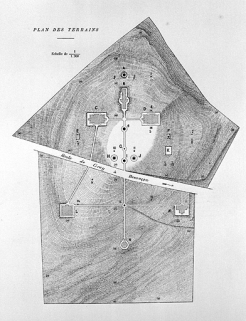
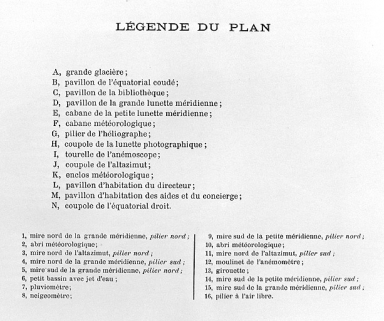
![Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], 1883. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], 1883. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_paysage/public/phototheque/IVR43_20042500216X.jpg)
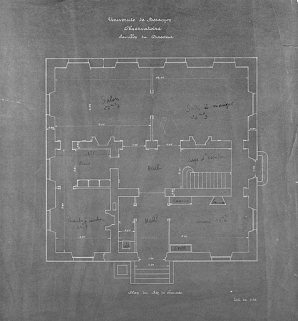
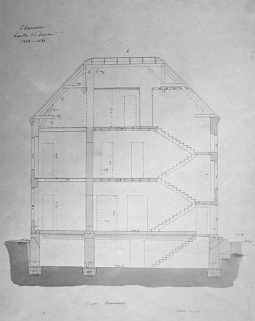
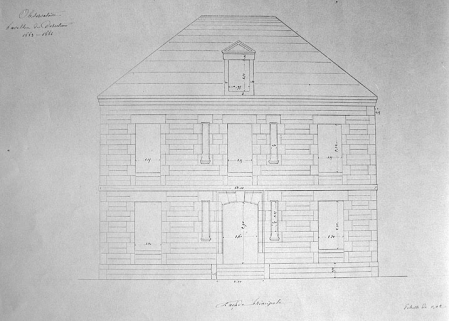
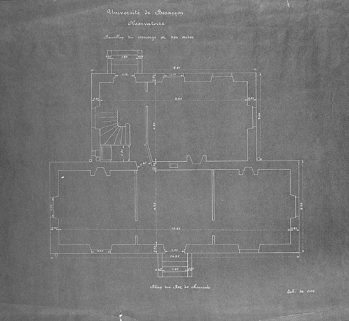
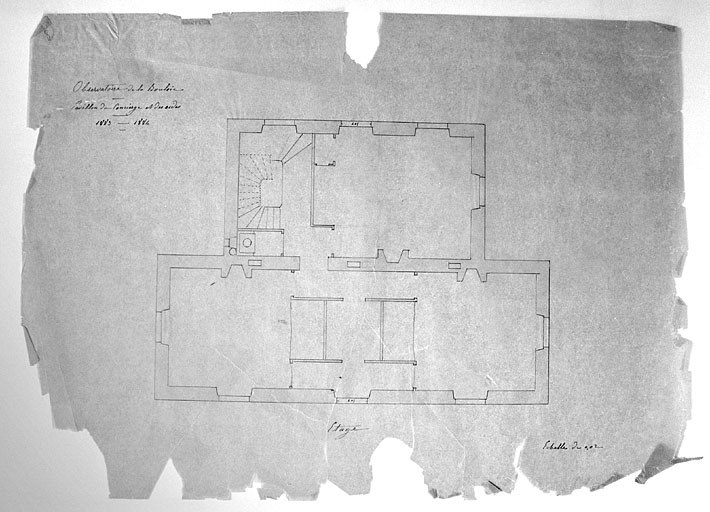
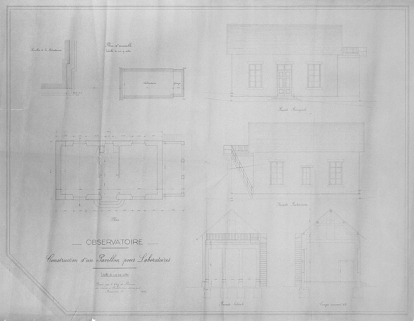
![Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, 1940. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, 1940. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500580V.jpg)

![[Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500126X.jpg)

![Pavillon de la petite méridienne [vu du sud-est], fin 19e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Pavillon de la petite méridienne [vu du sud-est], fin 19e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500571V.jpg)
![Coupoles. Altazimut, Anémoscope & Equatorial photographique [vues du nord-ouest], fin 19e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Coupoles. Altazimut, Anémoscope & Equatorial photographique [vues du nord-ouest], fin 19e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500577V.jpg)
![[Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500638X.jpg)



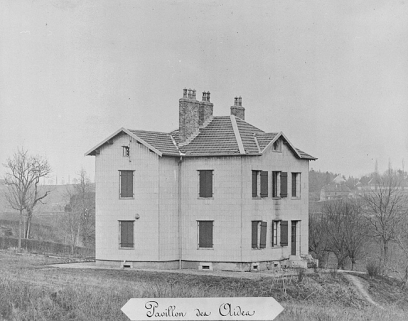
![[Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], 1911. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], 1911. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500122X.jpg)

![[Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], 1912. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], 1912. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_paysage/public/phototheque/IVR43_20042500149X.jpg)
![[Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 1922. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 1922. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500623X.jpg)


![[Poseurs de ligne sur un poteau électrique], 1913 ? © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Poseurs de ligne sur un poteau électrique], 1913 ? © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500112X.jpg)
![Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue générale des appareils prise du SW [membres de la mission de Cistierna], 1905. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue générale des appareils prise du SW [membres de la mission de Cistierna], 1905. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_paysage/public/phototheque/IVR43_20042500133XI.jpg)
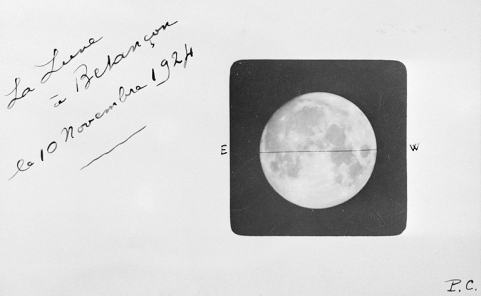
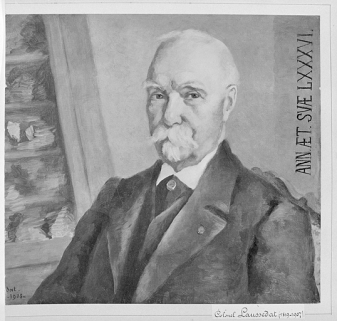
![[Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], 1912. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], 1912. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500124X.jpg)
![[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], 1909. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], 1909. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500166X.jpg)
![[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], 1909 ou 1910. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], 1909 ou 1910. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_paysage/public/phototheque/IVR43_20022501241X.jpg)
![[Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], 1916. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], 1916. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500582V.jpg)
![[Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500583V.jpg)

![Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500624X.jpg)
![[Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], 1907. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], 1907. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20042500197X.jpg)
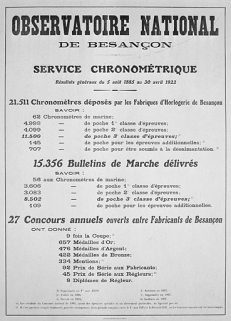
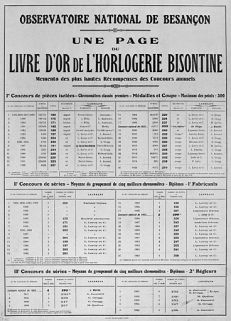
![[Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500144XI.jpg)
![Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500146XI.jpg)
![Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], 1948. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], 1948. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_paysage/public/phototheque/IVR43_20042500167X.jpg)
![[Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], années 1960. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], années 1960. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500160X.jpg)
![[Coupe chronométrique], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Coupe chronométrique], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500581V.jpg)
![[Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], 1er quart 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500168X.jpg)
![[Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, milieu 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, milieu 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500169X.jpg)
![[Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20042500119X.jpg)
![[Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500598VA.jpg)
![[Diplôme de régleur], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Diplôme de régleur], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500600VA.jpg)
![Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500610VA.jpg)
![Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail de la partie supérieure], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail de la partie supérieure], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500637XA.jpg)
![[Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20032500650XA.jpg)
![L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500616VA.jpg)
![L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail du cul de lampe], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail du cul de lampe], limite 19e siècle 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500666XA.jpg)
![Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500621VA.jpg)
![Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500662XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20032500604VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905 : détail du cul de lampe]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905 : détail du cul de lampe]. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500652XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], entre 1900 et 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], entre 1900 et 1904. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500602V.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500612VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500660XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20032500619VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail de la déesse à l'astrolabe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail de la déesse à l'astrolabe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500654XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500656XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500664XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500606VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20032500608VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500658XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20042500223XA.jpg)
![[Certificat de réglage d'une montre], décennie 1940. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Certificat de réglage d'une montre], décennie 1940. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500648X.jpg)
![[Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 2e moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 2e moitié 20e siècle. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500617V.jpg)
![[Bulletin de marche d'une montre-bracelet], décennie 2000. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'une montre-bracelet], décennie 2000. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste_portrait/public/phototheque/IVR43_20032500614VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'une montre-bracelet : détail de la partie supérieure], décennie 2000. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine [Bulletin de marche d'une montre-bracelet : détail de la partie supérieure], décennie 2000. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine](/sites/default/files/styles/inventaire_liste/public/phototheque/IVR43_20032500635XA.jpg)
















































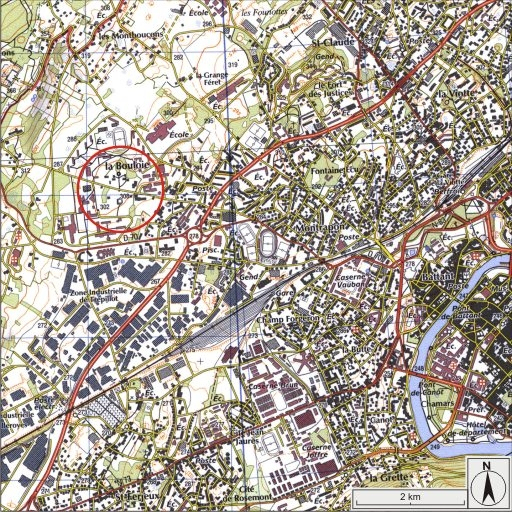
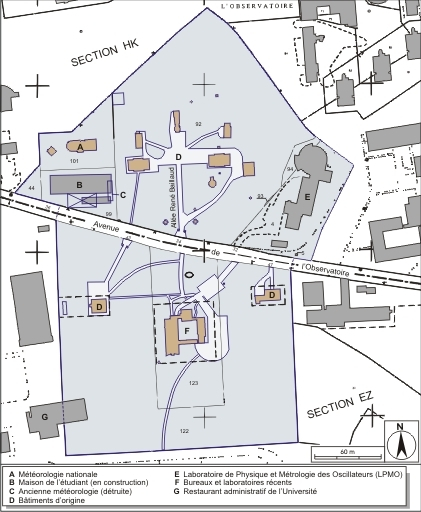
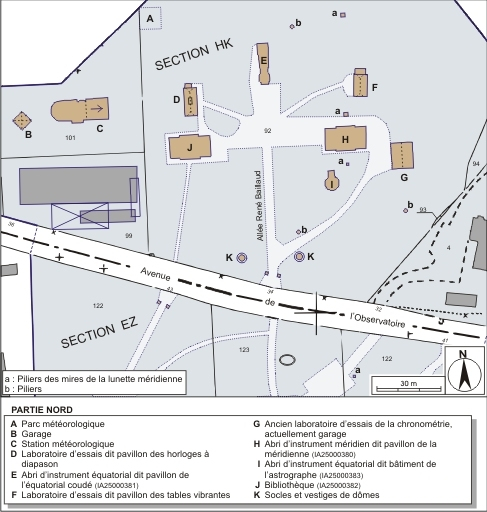
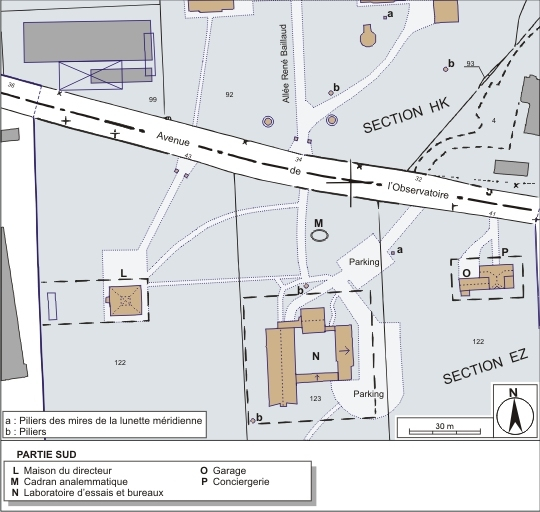

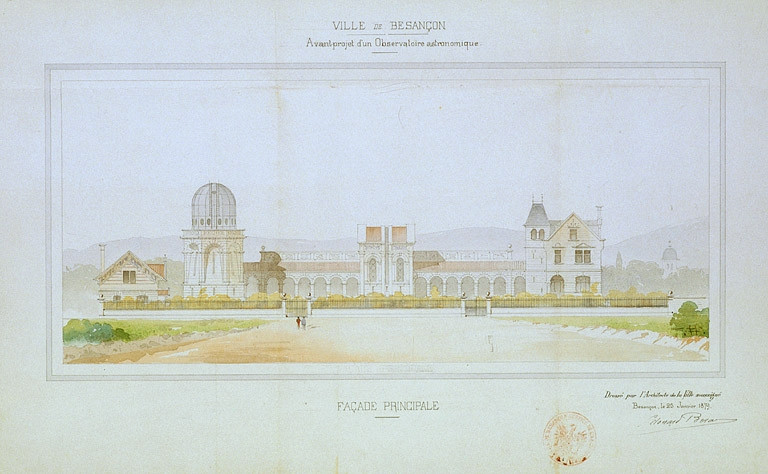
![[Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], [1881]. © André Céréza / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2005 [Plan général de distribution des bâtiments scientifiques : projet], [1881]. © André Céréza / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2005](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20052500001NUDA.jpg)
![Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, 1884. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2005 Observatoire de la Bouloie. Plan d'ensemble : Plan et projet de canalis[ati]on extérieure p[ou]r la distribution du gaz à la gazoline, 1884. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2005](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20052500003X.jpg)


![Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], 1883. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 Bâtiment du directeur [plan du rez-de-chaussée], 1883. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500216X.jpg)


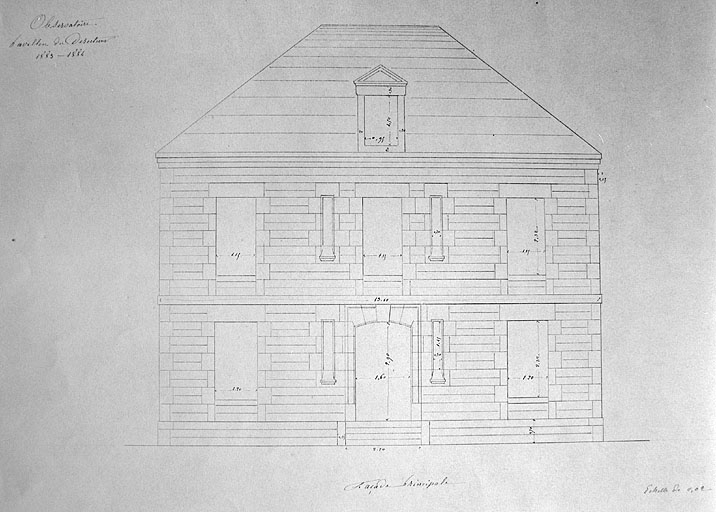



![Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, 1940. © Jérôme Mongreville, E. Dampenon / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Observatoire national de Besançon. Construction d'un pavillon. Façade principale, Pignon, Rez-de-chaussée [et] Etage, 1940. © Jérôme Mongreville, E. Dampenon / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500580V.jpg)

![[Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], limite 19e siècle 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Vue d'ensemble des terrains proches de la partie sud du site, vers Saint-Ferjeux], limite 19e siècle 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500126X.jpg)

![Pavillon de la petite méridienne [vu du sud-est], fin 19e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Pavillon de la petite méridienne [vu du sud-est], fin 19e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500571V.jpg)
![Coupoles. Altazimut, Anémoscope & Equatorial photographique [vues du nord-ouest], fin 19e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Coupoles. Altazimut, Anémoscope & Equatorial photographique [vues du nord-ouest], fin 19e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500577V.jpg)
![[Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Vue stéréoscopique d'ensemble des coupoles à l'entrée de la partie nord et des plantations], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500638X.jpg)




![[Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], 1911. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Vue d'ensemble des pavillons depuis la conciergerie (bâtiment des aides) au sud-est], 1911. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500122X.jpg)

![[Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], 1912. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Vue d'ensemble de la maison du directeur depuis le sud-est], 1912. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500149X.jpg)
![[Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 1922. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Vue d'ensemble de la bibliothèque et des pavillons du coudé et de la méridienne, depuis le logement du directeur au sud-ouest], 1922. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500623X.jpg)


![[Poseurs de ligne sur un poteau électrique], 1913 ? © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Poseurs de ligne sur un poteau électrique], 1913 ? © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500112X.jpg)
![Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue générale des appareils prise du SW [membres de la mission de Cistierna], 1905. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 Cistierna. Août 1905. Mission Hamy. Vue générale des appareils prise du SW [membres de la mission de Cistierna], 1905. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500133XI.jpg)


![[Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], 1912. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Portrait en pied d'Auguste Lebeuf, directeur de l'observatoire], 1912. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500124X.jpg)
![[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], 1909. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Le personnel de l'observatoire devant le pavillon de la méridienne], 1909. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500166X.jpg)
![[Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], 1909 ou 1910. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2002 [Le personnel de l'observatoire devant le pavillon du coudé], 1909 ou 1910. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2002](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20022501241X.jpg)
![[Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], 1916. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Portrait de groupe de la Commission industrielle américaine en France], 1916. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500582V.jpg)
![[Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], 1er quart 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Portrait de groupe avec Auguste Lebeuf], 1er quart 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500583V.jpg)

![Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Mme Bourdot épouse Lassus vers 1932 [en avant du pavillon du coudé]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500624X.jpg)
![[Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], 1907. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Position des chronomètres de poches pendant la première classe d'épreuves], 1907. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500197X.jpg)
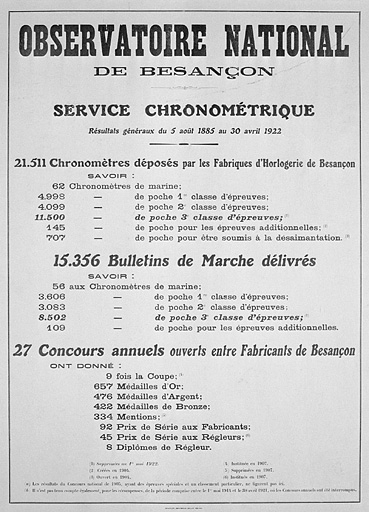

![[Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], 1er quart 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Contrôle des chronomètres dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée de la salle est], 1er quart 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500144XI.jpg)
![Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 Observation des montres sur le chronographe imprimant Prin [au sous-sol du pavillon de la méridienne], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500146XI.jpg)
![Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], 1948. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 Les calculatrices du Service officiel de contrôle [dans le pavillon de la méridienne, au rez-de-chaussée, salle est], 1948. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500167X.jpg)
![[Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], années 1960. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Contrôles de montres par les calculatrices de la chronométrie, dans le laboratoire à l'est du pavillon de la méridienne], années 1960. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500160X.jpg)
![[Coupe chronométrique], 1er quart 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Coupe chronométrique], 1er quart 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500581V.jpg)
![[Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], 1er quart 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Coupe chronométrique en devanture du magasin parisien de la maison Leroy], 1er quart 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500168X.jpg)
![[Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, milieu 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Nouvelle] Coupe chronométrique de l'Observatoire national de Besançon, milieu 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500169X.jpg)
![[Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Médaillon : dessin du temps sous forme d'un vieillard à la faux arrêtant le char de Phaéton], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20042500119X.jpg)
![[Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Diplôme du prix de l'Automobile-Club au concours chronométrique], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500598VA.jpg)
![[Diplôme de régleur], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Diplôme de régleur], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500600VA.jpg)
![Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500610VA.jpg)
![Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail de la partie supérieure], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Le temps arrête le soleil à l'heure de se coucher (profil de l'observatoire) [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail de la partie supérieure], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500637XA.jpg)
![[Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Le temps passé : projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500650XA.jpg)
![L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500616VA.jpg)
![L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail du cul de lampe], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 L'heure va passer, elle passe, elle est passée [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail du cul de lampe], limite 19e siècle 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500666XA.jpg)
![Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500621VA.jpg)
![Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 Nihil sub sole novum [rien de nouveau sous le soleil]. 1ère étude préliminaire [projet de décor pour un bulletin de marche, 1ère classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500662XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500604VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905 : détail du cul de lampe]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche au concours national de réglage des 4 avril-3 juin 1905 : détail du cul de lampe]. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500652XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], entre 1900 et 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], entre 1900 et 1904. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500602V.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500612VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, première classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500660XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500619VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail de la déesse à l'astrolabe], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail de la déesse à l'astrolabe], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500654XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500656XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500664XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre-bracelet, deuxième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500606VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500608VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail des armoiries de Besançon], 1ère moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500658XA.jpg)
![[Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004 [Bulletin de marche d'un chronomètre de poche, troisième classe d'épreuves : détail du cul de lampe], 1ère moitié 20e siècle. © Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2004](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20042500223XA.jpg)
![[Certificat de réglage d'une montre], décennie 1940. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Certificat de réglage d'une montre], décennie 1940. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500648X.jpg)
![[Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 2e moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Certificat de marche d'un chronomètre de poche, deuxième classe d'épreuves], 2e moitié 20e siècle. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500617V.jpg)
![[Bulletin de marche d'une montre-bracelet], décennie 2000. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'une montre-bracelet], décennie 2000. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque_vertical/public/phototheque/IVR43_20032500614VA.jpg)
![[Bulletin de marche d'une montre-bracelet : détail de la partie supérieure], décennie 2000. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003 [Bulletin de marche d'une montre-bracelet : détail de la partie supérieure], décennie 2000. © Jérôme Mongreville / Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine - 2003](/sites/default/files/styles/phototheque/public/phototheque/IVR43_20032500635XA.jpg)