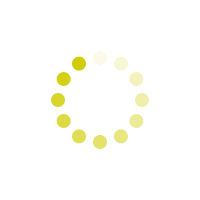PRÉAU, PUIS CHAPELLE DE LA CITÉ PLM, AUJOURD'HUI CENTRE DE FORMATION
89 - Migennes
16 rue Henri Surier
- Dossier IA89002120 réalisé en 2023
- Auteur(s) : Jo-Ann Campion

Historique
En 1905, une chapelle est aménagée dans le préau de la Cité de la Compagnie PLM (des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée). Ce préau construit en 1901 jouxte l’école et les bâtiments administratifs de la société ferroviaire dans ce quartier créé à la fin du 19e siècle à proximité de la gare.
La construction de cette chapelle s’inscrit dans un contexte de fortes rivalités entre les communes de Laroche et de Migennes, dont le canal et son port, la ligne ferroviaire et sa gare, constituent la pierre d’achoppement. L’anticléricalisme très présent sur le territoire icaunais est, lui aussi, un acteur à part entière de l’histoire de la création de cette chapelle. En 1845, la réalisation d’une ligne ferroviaire reliant Paris à Lyon et passant par le département de l’Yonne fait de Laroche, hameau de la commune de Saint-Cydroine, une gare ferroviaire importante. Les infrastructures ont également une emprise sur des terrains de la commune de Migennes. En 1880, la gare s’étend par la construction d’un nouveau dépôt, précédant de quelques années la construction d’un quartier d’habitation. Cette cité destinée à accueillir les familles des agents ferroviaires s’agrandit progressivement. Isolée de Laroche comme de Migennes, elle se veut autonome : des coopératives de consommation et des écoles sont créées. C’est dans ce contexte qu’en 1901 la compagnie demande une autorisation pour que le culte puisse avoir lieu dans le vestibule du préau de l’école située rue Maurice Berteaux (actuelle rue Henri Surier). Ce préau est alors en cours de construction sous la direction de monsieur Picard, ingénieur de la voie à Dijon. Le conseil municipal conditionne son accord à la satisfaction d’une demande faite de longue date : que la compagnie renomme la « gare de Laroche », « gare de Laroche-Migennes ». Semblant accéder à cette requête, la compagnie en profite pour préciser sa demande dans une lettre rédigée le 16 février 1902 : « Cette chapelle consiste en une petite pièce accolée à un grand préau dans lequel les 256 enfants de nos trois écoles prendront leurs récréations les jours de pluie et en est séparée par deux battants mobiles qu’on ouvrira lorsque l’on voudra procéder aux exercices du culte ». La chapelle, précise alors G. Noblemaire, le directeur de la compagnie, n’est pas exclusivement affectée aux enfants de la compagnie, mais ouverte à tous et « constituant ainsi pour le hameau de Migennes, une chapelle de secours à l’église paroissiale sous la surveillance de laquelle le culte sera célébré. ». Cette requête aurait pu être l’occasion pour les deux acteurs de régler plusieurs différends, la municipalité s’étant vu refuser à plusieurs reprises, outre le changement de nom, l’aménagement d’un passage sous les rails et d’une voie de communication facilitant ainsi l’accès à la gare pour les habitants de Migennes. C’est sans compter sur une partie du conseil municipal qui, lors du conseil du 19 octobre 1902, s’oppose fermement à la construction d’un lieu de culte. L’accord n’est finalement donné que le 6 avril 1906, sans qu’aucune des demandes de la municipalité ne soit satisfaite.
Dans cette démarche, la compagnie du PLM bénéficie du soutien de l’abbé Pierre-Joseph Magne, arrivé à Migennes en 1899. Ce dernier s’est installé dans une maison acquise par sa famille où il célèbre les messes et dont la proximité avec la gare lui permet d’être au plus près des cheminots et de leurs familles, et de développer une intense activité par la constitution de patronages de scouts et de jeunes filles, de sociétés de gymnastique, de cercles d’étude et d'une union catholique du personnel du chemin de fer. Les cartes postales anciennes montrent que le préau était fermé sur trois côtés (est, nord et sud). Les deux premières travées à l’ouest étaient ajourées par deux baies à arc en plein-cintre. Les travées 3 à 6 étaient ouvertes, séparées les unes des autres par des piliers en bois. Vers 1906, ce côté semble avoir été clos, par la construction d'un mur en appareil mixte alternant pierre et brique, et laissant un espace ouvert sous le toit. Plusieurs autres modifications du bâtiment sont visibles : deux travées ont été ajoutées, reprenant parfaitement matériaux, formes et rythmes des façades existantes. La façade ouest pourrait avoir été modifiée à ce moment-là, afin de réaliser un ensemble de baies symétriques à celles de la façade est. La baie de la façade nord, rectangulaire, a également a été remodelée pour adopter une forme d'arc en plein cintre. Une seconde extension, d'une travée cette fois, vient perturber la symétrie de l'ensemble à l'extrémité sud du bâtiment. Enfin, un petit bâtiment a été accolé au niveau du chœur, côté ouest (sacristie ?). La chapelle a par la suite été aménagée en salle de formation professionnelle par la SNCF : le chœur a été cloisonné pour y créer une salle faisant office de cuisine et de salle de repos ; la nef a été scindée en deux parties, formant deux salles d'enseignement. Les portes d'accès donnant sur la façade ouest et nord ont été condamnées.
- 1er quart 20e siècle
- 2e quart 20e siècle (?)
- 3e quart 20e siècle (?)
Picard. Ingénieur de la Voie à Dijon. Il dirige notamment les travaux du préau de l'école de la Cité PLM à Migennes.
Description
La chapelle est située dans une petite cité pavillonnaire constituée de maisons de jardins et d'un ensemble d'immeubles administratifs. La chapelle de plan allongé est tournée vers le sud. Ses murs sont à pans de bois avec un soubassement constitué d'un appareil régulier en pierre de taille. La nature du hourdis n'a pas pu être identifiée. La charpente en bois est visible sous le toit à longs pans en ardoise. Le campanile en bois est surmonté d'une croix. Son toit en ardoise est en pavillon à égout retroussé. Le bâtiment s'étend sur dix travées. Une extension est accolée à sa façade ouest, au niveau de la travée 8 et 9, recouverte d'un toit en appentis en acier. Le reste de la couverture est en ardoise. Un raccord sur le toit témoigne d'une extension de l'édifice.
- bois
- pierre
- pan de bois
- ardoise
- acier en couverture
- plan allongé
- en rez-de-chaussée
- toit à longs pans, demi-croupe
- pignon couvert
- toit en pavillon
- appentis
- baie avec arc plein cintre
Source(s) documentaire(s)
-
Archives historiques du diocèse de Sens et d'Auxerre : non coté. [1878-1946].
Archives historiques du diocèse de Sens et d'Auxerre, Auxerre : non coté. [archives anciennes de la chapelle de la Cité PLM et de l'église du Christ-Roi]. [1878-1946].Lieu de conservation : Archives historiques du diocèse de Sens et d'Auxerre, Auxerre - Cote du document : non coté
-
Laroche Migennes - Chapelle de la Cité. [1906?].
Laroche Migennes - Chapelle de la Cité. Carte postale par [s.n.]. [s.d.], [1906?]. Joigny : Imp-Lab. H. Hamelin, [s.d.].
-
Ribeill, Georges. PLM - City. Histoire d'une ville née du rail, Migennes. 1999.
Ribeill, Georges. PLM - City. Histoire d'une ville née du rail, Migennes. Du canal au TGV (XIXe - XXe siècle). Dixmont (89500) : G. Ribeill, 1999. 186 p. couv : ill. ; 24 cm.Lieu de conservation : Bibliothèque universitaire, Dijon - Cote du document : Mag : 944.4/1220
Informations complémentaires
- patrimoine religieux du 20e siècle en Bourgogne-Franche-Comté
- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine